Titre : Revue du Havre et de la Seine-Inférieure : marine, commerce, agriculture, horticulture, histoire, sciences, littérature, beaux-arts, voyages, mémoires, mœurs, romans, nouvelles, feuilletons, tribunaux, théâtres, modes
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1846-10-18
Contributeur : Morlent, Joseph (1793-1861). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859149v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 18 octobre 1846 18 octobre 1846
Description : 1846/10/18. 1846/10/18.
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k923473x
Source : Bibliothèque municipale du Havre, Y2-123
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 28/05/2014
I
LIS FRÈRES NORMANDS. ,
i.
Tout lecteur qui s’emparo d’uno relation de voyage est excité par l’es
pérance d’y puiser des sensations neuves et vives, espérance fondée sur
e contraste qui existe entro les mœurs de ceux qui l’entourent et qui sont
es siennes, et la vio des peuples éloignés dent le tableau va passer sous
ses yeux. Nous n’avons guère perdu do vue l’horizon de la patrie, par
compensation, nous avons laissé l’empreinte do nos pas, sur beaucoup do
ces longs rubans poudreux qui sillonnent en tous sens notre pittoresque
pays. Or, en observant çi et là, comme tout philosophe qui chemine à
pied, nous avons été souvent frappe de cette pansée que les coutumes,
res usages dans certaines localités, diffèrent do ceux do la capitale, quo
les habitudes d’un Cotre ou d'un Zélandais s’écartent do colles d’un dandy
habit nt entre le boulevarl de Italiens et la Madeleine, ou d’un pacifi
que bourgeois de la rue Chariot ot du Pont-aux-Choux.
Du plus en plus ému par cette réflexion, nous nous sommes dit qu’il
serait assez intéressant do raconter l’exislence d’individu: qui, pour être
dépourvus do l’avantage do vivre à deux mille lieues de la France et de
dévorer leurs frères dans un mouvement d’appétit condamnable, ne mé
riterait pas moins, sous d’autre; rapports, l’attention de l’observateur in
trépide et curieux. Sans nous égaler précisément à un Christophe Co
lomb ou à un Vasco de Gama, nous avons donc la prétention, dans, le
simple drame qui va suivre, de montrer au lecteur des êtres qui jure
raient beaucoup au milieu d’un peuple qui ne désire pas d’horizon plus
étendu que les limites d’une chambre du six pieds carrés, et d’autre na
ture que les lambeaux verdis d’une coulisse de théâtre. El pourtant,
nous avons la conscience qu’un y regardant de près , on reconnaîtra que
les héros de notre histoire sont lout à fait doués des mêmes organes quo
cenx qui nous permettent de satisfaire les besoins animaux et intellec
tuels cio nos natures parisiennes, généralement admises comme infini
ment plus civilisées.
A cinquante lieues de Paris environ, à droite ot h gaucho de la route
do Lizieux à Cien, s’étend la vallée remarquable connue sous le
nom de pays d’Auge. Quiconque a vu cette partie de h Basse-Nor
man e ers la fin do mai, par un ciel azuré et légèrement vaporeux,
peut ai ment se rendre compte des délices du jardin ou folâtrait lo
pèro du genre humain avant sa chute. A celle époque de la saison,
les pommiers sont en fleurs, et rien d'harmonieux et de doux comme
cos bouquets d'un blanc rozé qui apparaissent sur mille points épars du
feuillago. Les prés couverts de bestiaux et qui s’étendent à perle de vue,
sont alors formés do cetto première herbe lino, tendre, délicate, d’une ver
dure si fraîche et si appétissante que l’on se révolte au souvenir do l’a-
nathême lancé par le lion sur le pau\ re ânon do la fable, s’accusant d’a
voir succombé à la tentation. Des myriades de pâquerettes et de fleurs
des champs, belles comme la nature, montrent leurs tôles blanches ou
leurs grappes rouges au dessus de l’immense nappe de la prairie ainsi
brodée d’or, de pourpre et d’argent. Vous ne Irouvez point ici ces dé
plorables lignes blanches de moellons ci de plâtre, chéries du proprié
taire dos environs de Paris, grand amateur dus espaliers ; les encios sont
ormes par des haies d’épine blanche du sein desquelles s’élancent des
formes magnifiques dont la vigoureuse verdure tranche sur celle plus
douces do la prairie.Puis, sur le penchant des collines, vous apercevoir
plusieurs chaumières telles quo nous les a si bien représentées Pécha de ,
nos modernes paysagistes, c’est-à-dire au bord d’un ruisseau qui des
cend la pente en murmurant, et entourées de beaux arbres, gigantesques
ombrelles destinées à les préserver des ardeurs du soleil do juillet et d’août,
et à les envelopper dans cotte demi-teinte mystérieuse et poétique dont la
Adèle reproduction fait la convoitise de l’artiste.
Dans un de ces vallons enchanteurs habitaient, il y o une dixaino d’an
nées, deux frères dont l’aîné avait environ trente ans et le second vingt-
huil, c’étaient deux superbes rejetons de ce splendide sang normand qui
fournit constamment l’un des plus beaux comingeris du royaume à l’im
pôt de la conscription. Tous deux avaient six pieds moins quelques li
gnes et leurs muscles saiilans , la largeur herculéenne do leurs épaules
annonçaient une force peu commune , même au sein de cette population
qui possède tant d’hommes forts et robustes.
Pierre Gachelu , lo moins jeuno , avait une belle figuro grave, mais
dont 1 expression était adoucie par un caractère do bonhommie prononcée
lorsqu’aucune passion no l’agitait. Ses cheveux d’un noir de jais,. longs
par derrière et tombant en boucles naturelles sur ses épaules étaient
coupés courls sur son front large et bien développé. Ses yeux Bruns et
ombrages do sourcils parfaitement arqués ne manquaient pus du vivacité
clans l’occasion, quoique son regard offrit habituellement lo calme dosa
vio ot la rusticité de ceux qui l’entouraient, ses manières n’étaient point
dépourvues d’une certaine dignité. 111a devait sans doute à sa position
d’ainé,de la famille, titre qui, là où les mœurs d’un autre âge ont con
servé quelque puissance, donne encore à celui qui le possède une impor
tance véritable au milieu des siens, et à un sens naturellement droit,
intelligent, réfléchi qui l’élevait réellement au dessus des natures qui
l’environnaient, plus incultes que la sienne, moins bien organisées, et par
conséquent très disposées à subir une influence qui avait le droit et lo
fait pour elle lorsqu’elle s’imposait.
Jean Gachelu beau, robuste, comme son aîné, ne ressemblait pourtant
nullement à celui-ci. Sa physionomie se rapprochait davantage du typo
vulgaire normand. Sa chevelure blonde, ses yeux d’un gris clair, sa peau
blanche vivement colorée au visage, rappelaient bien en effet l’homme
du nord ; mais ses manières, ses allures, son caractère le faisaient
distinguer surtout du chef do la famille. Jean, de sa propre volonté du
reste, n’occupait quo la seconde place du logis, laissant à son ère la di
rection et la responsabilité du gouvernement domestique; il tait donc
toujours senti obligé à moins de réserve, de tenue, de gravité dans son
langage et dons sa conduite. Cet état do choses joint à son naturel plus
vif, pins impétueux, quoique moins intelligent quo celui de Pierrr, et a un
penchant plus décidé pour les plaisirs grossiers qui étaient à sa portée, fai
sait que, vis-à-vis des gens qui dépendaient de lui, auprès de ses connais
sances, il jouissait d’une considération moins étcuduo que son aîné. Mais
s’il était moins respecté, on l’aimait lout autant que ce dernier, à deux
lieues à la ronde, et il le méritait véritablement. Indépendamment d’uue
naïve boulé de cœur, il avait une gaîté d’humeur et une malice facétieuse
qui lui donnaient la puissance de répandre lo rire autour de lui, parti
culièrement lorsqu’à la fin d’un repas une consommation suffisante de
petits pots d’eau-du-vie et do gloria surexcitait sa verve joviale et très
bruyante.
Le sentiment qui chez lui dominait tous les autres était son dévoûment
inaltérable et profond pour son frère Pierre, qui, au surplus, n’était pas
homme à lui en devoir de ce côté ; aussi, dans lo pays, l’amitié des deux
Gachelu était-elle proverbiale. Indépendamment d’une sympathie natu
relle, celte amitié s’expliquait encore par les circonstances de leur vie.
Ils avaient perdu leurs parens de bonne heure; demeurés seuls à la tôle
d’un héritage considérable, au lieu do partager leurs herbages, ils réso
lurent de les exploiter ensemble. Depuis douze ans, ils se chauffaient au
même foyer; or, pendant ces douze ans, jamais on n’entendit Pierre adres
ser une parole d’humeur ou de rcprocho à Jean, et jamais on ne vit ce
lui-ci hésiter un moment à se roi cre au premier désir do son aîné. Sans
doute, avec leurs nerfs un peu rudts et leur cœur peu subtil, ils n’attei
gnaient pas aux délicatesses d’un sentiment mignard; mais si, témoins
de leurs relations intimes et journalières, on ( ûl pu douter de l’étendue
et de la profondeur de leur fraternelle amitié, il n’en était pas moins
vrai qu’aucun d’eux n’eût balancé à risquer sa vie pour éviter un péril à
l’autre.
Leur habitation s’élevait, comme toujours en Normandie, au milieu
d’un verger entouré de baies vives et fermée par une barrière cri bois
point, aux doux côtés do la maison qui n’avait qu’un étage, on aper
cevait plusieurs bâtimens séparés ; ils rontermaient le pressoir à ci
dre, les caves, la laiterie, les écuries et les appartenions particuliers des
innombrables hubitans de la basse-cour qui pendant la journée se répan
daient dans tous les coins du verger.
L’existence de nos propriétaires, rois dans leur vaste domaine, était
d’une simplicité biblique. Presque sans communication avec les faits de
notre civilisation avancée, ils pratiquaient immuablement les mœurs d’un '
auire temps très suffisantes à satisfaire les modestes désirs et les rares
besoins qu’ils devaient à leur lempéramment antique, lisse levaient à
huit heures en toute saison. Dans cetto partie de la France le paysan mè
ne une existence plus douce que dans les environs do Paris. Lo polit cul
tivateur de nos banlieues intéressé, cupide, m’exténue à tourmenter son
coin de (erre que lo voisinage de la capilale transforme en mine pré
cieuse. Ses sueurs enfantent des trésors, et si, à force d’efforts et d’abs-
linences, il parvient à un élat de maigreur et de déformation repoussan
tes, son avidité est salisfaite et son but atteint. Dans les pays de pâtu
rage la terre produit presque seule, l’homme peut ne pas s’épuiser pour
recueillir, et c’c3t assurément là une des causes de la beauté des popula-
lionsde ces contrées. Donc lorsque huit heures sonnaient à l’horloge à botte
de la salle du rez-de-chaussée, on entendait les pieds de Pierre et do Jean
retentir sut lo plancher de leurs chambres situées au premier et uni
que otage de la maison, et bientôt les deux frères paraissaient sur lo
seuil de la sallo. Les premiers mots qu’ils prononçaient alors témoi
gnaient qu’un exercice préliminaire était parfaitement superflu pour ou
vrir leur formidable appétil.
— Tôt! tôt! Margot ton, fais-nous déjeuner! s’écriaient-ils en chœur
en s’adressant à une vieille servante qui se démenait devant ses four
neaux.
Puis quand ils avaient terminé le premier de leurs trois copieux repas,
munis d’une petite houe en bois élégamment façonnée, ils commen
çaient leur ronde dans le verger. Ils donnaient le coup d’œil du maître
aux instruirions qui servaient à l’exploitation, aux provisions, aux pro
duits des diverses récolles, au peuple de la basse-cour, composée de ca
nards, poules, oies, porcs, agneaux, tous bêlant, gloussant, grognant à
l’envi, et se précipitant sur le passage de ceux dont la visite était tou
jours pour eux l’annonce d’un supplément à leur pitance habituelle.
Celle marche triomphale au travers de sujets aussi empressés et soumis
que voraces n’avait pourtant pas lieu lo jour du marché du bourg voisin.
Ce jour, vivement attendu chaque semaine, formait uno puissante dis
traction à la vie unie et réglée de nos propriétaires. C’élait au marché
qu’on apprenait des nouvelles de Poissy, ville bien plus intéressante
aux yeux des éleveurs ie Normandie quo Tlièbes, Home ou Paris. On
rencontrait là sos amis, on buvait, on jasait, on flânait sur la place, on
achetait des babioles qui servaient à décorer les murs de la chambre, on
s’approvisionnait de poisson et autres friandises ; pendant trois ou qua
ire heures enfin on se donnait des sensations et du plaisir de quoi dé
frayer par le souvenir lo resta de la semaine.
A deux heures on revenait pour lo dîner, suivi tous les jours d’uno
promenade dans les herbages. Ces deux frères se livraient alors à l’exa
men de leurs magnifiques élèves répandus dans les pâturages et aussi
libres, mais moins farouches que ces bœufs du Brésil confiés aux sauva
ges et fantastiques Péons. Ils badinaient souvent avec quelques-uns d’en-
tra eux sans craindre un excès de familiarité quo la force prodigieuse
des Gachelu les incitait toujours à même de réprimer victorieusement.
Après celte inspection importante, nos héros sortaient de leur habitation
et allaient rendre quelques visites aux voisins. Le malador ou la mou
che faisaient attendre patiemment le souper de huit heures, après lequel
Pierre et Jean s’abandonnaient aux douceurs d’un sommeil dont nul
souci, nul remords no troublaient la douce quiétude.
On nous fera sans doute observer que dans lo tableau précédent nous
ne nous sommes guère occupé que delà vie physique des individus: c’est
qu’en vérité les besoins moraux do nos amis tenaient si peu de place dans
leur existence quo nous nous faisons presque un cas do conscience do
nous y arrêter. En effet, ils ava : ont appris du curé de leur village une
espèce de langago qui ressemblait plus au français qu’à un idiôme quel
conque; ils lisaienl, écrivaient et chiffraient assez proprement; mais le
livre des offices était le seul ouvrage sérieux, les parades des bateleurs et
les facéties de polichinelle, au marché du bourg, la seule littérature lé
gère qu’ils possédassent passablement. Nous devons même dire que les doux
frères, abonnés à un journal, no le lisaient jamais , les combinaisons du
style moderne les forçant à un travail d’intelligence trop pénible pour
arriver à saisir le sons des périodes des écrivains de noire temps. Au
reste,ils en savaient assez; ils savaient que leurs herbages n’enfermaient
pas absolument la totalité du royaume de France; quo le maire de la
commune , le percepteur , le garde champêtre et les gendarmes sont les
principaux fonctionnaires des ordres civils et militaires dans le gouver
nement ; et cette science , avec la crainte do Dieu , dans laquelle ils vi
vaient pieusement, satisfaisait, et au-delà, ce besoin do savoir ot do con
naître qui, à ce qu’on prétend, est un des plus impérieux de l’humanité.
N’oublions pas pourtant de sanctionner encore une des grandes dis
tractions do Jean , occupé moins sérieusement quo son frère. Poil -
dant quo celui-ci donnait dos ordres dans la maison, lo plus jeune des
Gachelu se délassait en appelant autour de lui ses favoris. Ces privi
légiés do la race animale consistaient en une superbe nichée de cor
beaux et un porc de l’âge le plus tendre, et qui, par sos façons gen
tilles et prestes, son air intelligent et la douceur infinie de sa voix ,
méritait vérilablement de se voir distingué entre ses frères do la mô
me portée, moins bien doués que lui. Dès quo Jean , un instant oisif,
se laissait tomber sur une chaise dans la salle du rez-de-chaussée en
poussant un certain cri, les corbeaux et Lubin ( c’élait lo nom du
jeune porc) arrivaient aussitôt. Lubin no connaissait plus de mère, plus
de frères lorsque son maître l’appelait. Bien qu’il fut en Iraiu de se
vautrer dans le verger, au soleil, au milieu de sa famille, ou le voyait so
relever vivement, dresser les oreilles autant que la nature de celles-ci le
permetlait, répondre par un grognement d’une douceur infinie au cri de
Jean, et se séparant délibérément de la bande, se diriger vers la salle en
trottant et en dounnnt à sa queue, d’une courbe si originale, mille mou-
vomens pleins de caprice et de fantaisie.
Avec une vivacité toute juvénile, Lubin frétillait autour de son maître,
se tenait sur ses pieds de derrière, tournait sur lui-mômo comme un
baladin, se couchait, faisait le mort, se relevait et s’arrêtant court et re
muant la queue comme un chien, attendait en roucoulant à sa manière
la récompense accordée à tant do mérite cl d’amabilité. Les corbeaux,
moins séduisans, mais également affectueux, se perchaient sur les épau
les, sur les genoux, sur la lêfe de Jean, le regardant et lo becquetant par
intervalle, le tout par amitié. Puis, ils ouvraient bientôt un largo bec et
entamaient une musique composée d’une seule noie, mais répétée avec
tant de volubilité, que ce croassement à six voix pouvait passer pour
un chant suivi, quoiqu’un peu monotone et très étourdissant. Jean re
lirait un vif plaisir do celle mélodie plus qu’antique par sa simplicité. En
efet, rarement il écoutait ce concert étrange sans s’abandonner à un
rire qui croissait jusqu’à devenir larmoyant , convulsif, et dsnt l’éclat
couvrait même la voix des concertons. Honteux et confus do so voirsur-
jasser, ceux-ci se luisaient alors, et se bornaient à pétrir de leurs griffes
es épaules de leur maître, jusqu’à ce que ce dernier se décidât à leur
distribuer le prix accoutumé de leur talent musical.
Pour terminer ce préambule, disons enfin qu’au moment où commence
celte histoire, le bruit se répandait dans le pays que les visites hebdo
madaires do Pierre et do Jean au bourg voisin avaient encore une outre
cause que des spéculations à préparer ou une multitude de glorias à con
sommer en jouant au matador.On parlait des jolies filles d’un éleveur du
bourg, Catherine et Dorothée, dont le pèro accueillait nos héros avec un
empressement très significatif. Pierre et Jean n’ouvraient pas la bouche
de leurs dessins supposés, mais ils n’entendaient point prononcer le nom
des doux jeunes filles sans émotion, et il paraissait certain que chaque fois
qu’ils se présenlaient chez le père de celles-ci, elles rougissaient jusqu’au
blanc des yeux, se sauvaient aussitôt au fond du jardin et ne se remon
traient qu’après lo départ des visiteurs, ce qui annonçait une sympathie
naissante: il n’y avait pas à s’y tromper. D'ailleurs uno dernière ob
servation corroborait les conjectures générales: l’humeur de Margolton
devenait de jour en jour plus difficile. Or, Margotton, qui avait élevé les
fils Gachelu et gouvernait leur ménage depuis quinze ans, ne so serait
point abandonnée à uno âcretéo croissante do langage, à une ucerbilé
progressive de manières, sans pressentir que son pouvoir, jusque-là in
contesté et sans partage dans certaines limites, était menacé d’une ruine
prochaine et totale peut-être.
Le 5 juin de l’année 183..., la table élait dressée dans la vaste salle du
rez-de-chaussée. Pierre Gachelu prit place au haut bout de la table ,
ayant son frère Jean à sa droite , et successivement ensuite les gens de
service et les domestiques do la maison , à l’exception do Margotton e
d m o jeune aide qui avait préparé le ripas du matin. Ce tableau d’inté
rieur rappelait une de ces scènes moyen-âge si bien dépeintes par Wal
ler Scott. Pour ajouter encore à la vérité de l’imitation , tous semblaient
avoir conservé le secret do ce formidable appétit quo nos porcs devaienijà
leur vie active. Après la fameuse soupe normande aux poireaux , on vit
arriver une solide pièce de bœuf, flanquée d’un plat do porc bouilli,
lequel était entouré d'nno telle quantité do légumes qu’on aurait supposé
des estomacs anté-diluvions seuls capables de convoiter une pareille
masso alimentaire. Cependant, une denn-heure après, tout avait disparu;
les domestiques so levèrent aprèsjpour reprendre leurs travaux, et il n’y
eut que les deux frères qui restèrent en présence d’un pot de cette détes
table liqueur appelée cau-do-vie de cidre, qu’un vrai Normand place au
dessus du nectar lo plus exquis que le génie de l’homme ait jamais in-
cnlé.
Lorsque Pierre et son frère eurent pratiqué une demi-douzaine d’hon
nêtes libations, sans que leur cerveau en reçut la plus légère attointe,
et seulement, comme ils disaicnl, pour réchauffer le petit cidre
précédait l’eau-de-vie, Jean sortit de l’état de béatitude dans lequel il
laissait opérer la digestion ; il se renversa en arrière sur sa chaise afin
de jeter à travers les fenêtres un coup d’œil sur le ciel, puis, so retour
nant vers la vieille servante qui enlevait les rares débris du déjeôner, il
lui dit d’un air d’enjoûment toujours plus prononcé chez lui à la fin de
chaque repas:
— Puisque lu es do si accorlo et do si belle humour ce malin, Margot,
je vus risquer de te demander un service.
— Qu’est-ce que c’est encore ! réplique celle-ci d’un ton revêche qui
prouvait l’ironio de l’assertion de Jean ; vous voulez donc me mettre sur
les dents! c’cest-à-diro qu’ici on n’a pas le temps de se moucher quand
on est enrhumé i
— Allons, Margot, co qu’on te demande n’est ni long ni difficile. Exa
mine un peu le temps, et dis-nous si nous aurons de l’eau aujourd’hui.
— Pardine! les nuages viennent d’aval, ils courent sur St-Bonneins
et le soleil pique comme une ortie de mai. Il n’y a pas de doute qu’il
tombera plus d’une averse dans la journée.
— Ah !... Margot, tu ne veux pas quo nous allions au marché.
— Au marché! dit la vieillo fille d’un ton de plus en plus acariâtre
et en continuant d’encombrer ses bras de plats ot d’assiettes vides.
Qu’est-co qno ça mu fait quo vous alliez au bourg ? le garde-manger et
le cellier sont pleins comme un œuf ; il n’y a rien à acheter, c’est vrai ;
mais quand ou no sait que faire, on est bien libre do dépenser deux cou
ples d’heures à baguenauder.
— Oh libre ! oui, comme toi d’être la plus douce et la plus agréable
des filles du pays d’Auge, répond Jean qui trouve toujours du plaisir à
exciter la liilo de Margoton.
— Bon, bon ! dit la servante on colère, si je ne suis pas meilleure, j’ai
du bon sens au moins, et assez pour prédire que certaines gens do ma
connaissance qui no se contentent pas de ce qu’ils sont, se réveilleront
pires un jour!
— Eli bien ! Je connais ton caractère et je garantis que tu ne te réveil
leras jamais ainsi, toi, dit Jean en riant de tout son cœur de son sar
casme.
— Oui da! s’écria Margojon devenant pourpre ot so débarrant de sos
assietlos pour parler avec plus do facilité ; on croyait pourtant valoir
encore quolquo chose I... Où est-ce quo vous trouverez un ménage mieux
tenu quo lo mien I y a-t-il dans ma cuisine assez do poussière pour faire
cligner l’œil d’uno mésange! ma vaisselle ne servirait-elle pas de mi
roir ! connaissez-vous dos fromages qui seraient assez effrontés pour se
mettre sur un plat à côté des miens I Et mon pain i on dirait d’uno brio
che I et mes lessives!... La Maclou me disait encore l’autre jour : mais
Margot, que failcs-vous à votre linge pour qu’il devienne si blanc, et
qu’il embaume comme ça.
— Là ! là ! ne t’emportes pas ainsi ; il n’est pas question de tes talens.
— Sii si! je m’entends...On a un air do me dire quo je no suis
bonne à rien, afin do justifier certaines idées... Malgré les cacholeries,
je sais co que je sais, toril de môme; la maison marche bien, mais on
crie, ot çi pour avoir le droit do déballer un jour ici doux belles demoi
selles qui ont des atours, de la jeunesse et des pistoles.
— Assez 1 dit alors de sa voix imposante Pierre Gachelu, reslé indif
férent jusque-là au bavardage do la vieille; je n’aime pas qu’on cherche
à deviner des projets qui no sont point censés exister, tant quo je n’ai
pas juge à propos d’en parler.
En entendant cette voix, à laquelle tout lo monde obéissait sans tergi
verser dans la maison, Margot s’interrompit soudain, quitta sa physiono
mie chagrine et maugréante, et continua de desservir, sans oser souffler
désormais.
Après un instant do silence, Pierre so lova, alla à la porte de la salle
et ordonna à un dos gens de service qui passait dans le verger de seller
les bidets dont so servaient habituellement les deux frères pour leurs
courses dans les environs ; puis s’avançant vers Jean, et lui donnant sur
l’épaule et de sa large main, une lape qui eut fait tressaillir un bœuf, il
ajouta : Allons, l’heure s’avance, et nous n’avons que le temps de nous
habiller, montons à notre chambre, frère.
Mais comme Pierre mettait le pied sur l’csca.iur qui conduisait à l’é
tage supérieur, Margot qui allait ot vouait do sa cuisine à la salle, ren
fla, et d’un air empressé ot doucereux destiné à se faire pardonner sou
indiscret bavardage de tout à l’heure, elle dit eu regardant l’aîné des
Gachelu.
— Attendez un pou, monsieur Pierre, je crois que voici le facteur,
nous allons sans doute recevoir des nouvelles de Mlle Henriette I
Le facteur, répète Pierre en so retournant vivement et en regardant le
messager rural comme un homme qu’on aperçoit une ou deux fois par
an. Au fait, il y a au moins six mois que celte chère enfant ne nous a
éarit.
— Oui, ajouta Jean , en s’avançant aussi avec empressement vers la
porte de la sallo qui donnait sur lo" verger, ot m’est avis que ça me fera
un rude plaisir d’apprendre que la petite cousine est toujours joyeuse et
en santé.
Lo facteur entra et en effet remit uno lettre à l’aîné do la famille, ce
qui., à bon droit, pouvait passer pour un incident dos plus rares dans la
maison. Pierre s’approchant aussitôt d’une fenêtre, décacheta la missive-
et en lut quelques lignes avec une difficulté provenant d’un défaut d'ha
bitude do ces sortes d’occupations. Cependant, à mesure qu’il avançait
péniblement dans sa lecture, son front se rembrunissait, sos sourcils se
fronçaient, sou regard, ordinairement tranquille, s’animait sensiblement,
et bientôt son visage laissa voir les traces d’uno agitation violente et pro
fonde.
Malgré sa curiosité , Jean , par déférence pour son aîné , s’était rési
gné à attendre que ce dernier eût fini, pour lui demander des nouvel
les, et il amusait son impatience en versant quelques verres do cidre
que le facteur engloutissait successivement, sans craindre de compro
mettre sa dignité de fonctionnaire public. Pour Margot , les deux poings
appuyés sur la table, le corps penché en avant, clic dévorait des yeux lo
lecteur et la lettre , et son respect sans bornes pour Pierre Gachelu suf
fisait à peine pour l’empêcher de le questionner.
Mais, lorsque les signes du troublede celui-ci devinrent tellement évi-
dens qu’il fut impossible do n’en être pas frappé , la vieillo fille et Jean
ne purent contenir davantage leur impatience , et tous deux s’écrièrent
en même temps :
Qu’est-ce qu’il y a donc? Bon Dieu 1 qu’cst-co qu’il y a?
Pierre laissa tomber la lettre sur ses genoux, parut so recueillir un
instant et faire d’énergiques efforts pour recouvrer quelque caltno; puis,
s’adressant à Jean, il répondit d’uno voix un peu altérée :
— Bien... rien... la lettre n’est pas d’Henriette.
— Elle n’est pas do ma clièro petiote ! s’écrie la vieillo fille que cette
vague réponse ne saurait rassurer. Alors on écrit pour elle! alors elle est
malade I
— Serait-il, en effet, question do ça? ajoute Jean avec une émotion
qui preuve son intérêt pour cello dota on s’occupe.
— Non! non ! répond Pierre avec vivacité et comme importuné do ccg
interrogations. Elle se porte bien. Les nouvelles qu’on mo donno n’ont
aucun rapport à sa santé ; ainsi, Margot, pas de jérémiades... Quaut au
contem
frère, j
r- C
malade
— E
Voyons
reparle
d’heuri
Malg
parente
niait co
moins i
Quand
d’entre,
et qu’il
de son
qu’à so
sa blou
blemen
Un i]
Jean rc
à laillo
vert. L
ralo de
par un
droite >
minée
En i
était pi
l'avait
Bientôt
songer
quillité
10 prei
Margol
franch:
Jean
cet ap[
compa,
avait
pendai
gislral
à son i
race d
Mais, 1
à Fond
dissipe
infinin
qu’il h
agréab
— I
vous a
— A
ironiqi
— P
_ j
passe i
neut d
— à
chère
— 1
— A
— 1
ire n’e
on pot
— B
11 Iretn
— C
ser, m
l’ai jat
fairo d
Et .
courai
Pou
mardi
formel
quarts
monte
bientô
une pi
en sii
bouffé
alors i
ce fut
Marge
Voyoi
dans 1
père :
fier. 1
Fargr
co ton
indép
y a q
ost fai
pouss
Cepoi
j’ai vi
Voyoi
que t
petite
de ce
aura
tu n’t
roi ho
inênv
noire
Ire jo
Fargo
Plu nu
semb
Et
entre
mais
à un
paisse
j’ai p
chant
LIS FRÈRES NORMANDS. ,
i.
Tout lecteur qui s’emparo d’uno relation de voyage est excité par l’es
pérance d’y puiser des sensations neuves et vives, espérance fondée sur
e contraste qui existe entro les mœurs de ceux qui l’entourent et qui sont
es siennes, et la vio des peuples éloignés dent le tableau va passer sous
ses yeux. Nous n’avons guère perdu do vue l’horizon de la patrie, par
compensation, nous avons laissé l’empreinte do nos pas, sur beaucoup do
ces longs rubans poudreux qui sillonnent en tous sens notre pittoresque
pays. Or, en observant çi et là, comme tout philosophe qui chemine à
pied, nous avons été souvent frappe de cette pansée que les coutumes,
res usages dans certaines localités, diffèrent do ceux do la capitale, quo
les habitudes d’un Cotre ou d'un Zélandais s’écartent do colles d’un dandy
habit nt entre le boulevarl de Italiens et la Madeleine, ou d’un pacifi
que bourgeois de la rue Chariot ot du Pont-aux-Choux.
Du plus en plus ému par cette réflexion, nous nous sommes dit qu’il
serait assez intéressant do raconter l’exislence d’individu: qui, pour être
dépourvus do l’avantage do vivre à deux mille lieues de la France et de
dévorer leurs frères dans un mouvement d’appétit condamnable, ne mé
riterait pas moins, sous d’autre; rapports, l’attention de l’observateur in
trépide et curieux. Sans nous égaler précisément à un Christophe Co
lomb ou à un Vasco de Gama, nous avons donc la prétention, dans, le
simple drame qui va suivre, de montrer au lecteur des êtres qui jure
raient beaucoup au milieu d’un peuple qui ne désire pas d’horizon plus
étendu que les limites d’une chambre du six pieds carrés, et d’autre na
ture que les lambeaux verdis d’une coulisse de théâtre. El pourtant,
nous avons la conscience qu’un y regardant de près , on reconnaîtra que
les héros de notre histoire sont lout à fait doués des mêmes organes quo
cenx qui nous permettent de satisfaire les besoins animaux et intellec
tuels cio nos natures parisiennes, généralement admises comme infini
ment plus civilisées.
A cinquante lieues de Paris environ, à droite ot h gaucho de la route
do Lizieux à Cien, s’étend la vallée remarquable connue sous le
nom de pays d’Auge. Quiconque a vu cette partie de h Basse-Nor
man e ers la fin do mai, par un ciel azuré et légèrement vaporeux,
peut ai ment se rendre compte des délices du jardin ou folâtrait lo
pèro du genre humain avant sa chute. A celle époque de la saison,
les pommiers sont en fleurs, et rien d'harmonieux et de doux comme
cos bouquets d'un blanc rozé qui apparaissent sur mille points épars du
feuillago. Les prés couverts de bestiaux et qui s’étendent à perle de vue,
sont alors formés do cetto première herbe lino, tendre, délicate, d’une ver
dure si fraîche et si appétissante que l’on se révolte au souvenir do l’a-
nathême lancé par le lion sur le pau\ re ânon do la fable, s’accusant d’a
voir succombé à la tentation. Des myriades de pâquerettes et de fleurs
des champs, belles comme la nature, montrent leurs tôles blanches ou
leurs grappes rouges au dessus de l’immense nappe de la prairie ainsi
brodée d’or, de pourpre et d’argent. Vous ne Irouvez point ici ces dé
plorables lignes blanches de moellons ci de plâtre, chéries du proprié
taire dos environs de Paris, grand amateur dus espaliers ; les encios sont
ormes par des haies d’épine blanche du sein desquelles s’élancent des
formes magnifiques dont la vigoureuse verdure tranche sur celle plus
douces do la prairie.Puis, sur le penchant des collines, vous apercevoir
plusieurs chaumières telles quo nous les a si bien représentées Pécha de ,
nos modernes paysagistes, c’est-à-dire au bord d’un ruisseau qui des
cend la pente en murmurant, et entourées de beaux arbres, gigantesques
ombrelles destinées à les préserver des ardeurs du soleil do juillet et d’août,
et à les envelopper dans cotte demi-teinte mystérieuse et poétique dont la
Adèle reproduction fait la convoitise de l’artiste.
Dans un de ces vallons enchanteurs habitaient, il y o une dixaino d’an
nées, deux frères dont l’aîné avait environ trente ans et le second vingt-
huil, c’étaient deux superbes rejetons de ce splendide sang normand qui
fournit constamment l’un des plus beaux comingeris du royaume à l’im
pôt de la conscription. Tous deux avaient six pieds moins quelques li
gnes et leurs muscles saiilans , la largeur herculéenne do leurs épaules
annonçaient une force peu commune , même au sein de cette population
qui possède tant d’hommes forts et robustes.
Pierre Gachelu , lo moins jeuno , avait une belle figuro grave, mais
dont 1 expression était adoucie par un caractère do bonhommie prononcée
lorsqu’aucune passion no l’agitait. Ses cheveux d’un noir de jais,. longs
par derrière et tombant en boucles naturelles sur ses épaules étaient
coupés courls sur son front large et bien développé. Ses yeux Bruns et
ombrages do sourcils parfaitement arqués ne manquaient pus du vivacité
clans l’occasion, quoique son regard offrit habituellement lo calme dosa
vio ot la rusticité de ceux qui l’entouraient, ses manières n’étaient point
dépourvues d’une certaine dignité. 111a devait sans doute à sa position
d’ainé,de la famille, titre qui, là où les mœurs d’un autre âge ont con
servé quelque puissance, donne encore à celui qui le possède une impor
tance véritable au milieu des siens, et à un sens naturellement droit,
intelligent, réfléchi qui l’élevait réellement au dessus des natures qui
l’environnaient, plus incultes que la sienne, moins bien organisées, et par
conséquent très disposées à subir une influence qui avait le droit et lo
fait pour elle lorsqu’elle s’imposait.
Jean Gachelu beau, robuste, comme son aîné, ne ressemblait pourtant
nullement à celui-ci. Sa physionomie se rapprochait davantage du typo
vulgaire normand. Sa chevelure blonde, ses yeux d’un gris clair, sa peau
blanche vivement colorée au visage, rappelaient bien en effet l’homme
du nord ; mais ses manières, ses allures, son caractère le faisaient
distinguer surtout du chef do la famille. Jean, de sa propre volonté du
reste, n’occupait quo la seconde place du logis, laissant à son ère la di
rection et la responsabilité du gouvernement domestique; il tait donc
toujours senti obligé à moins de réserve, de tenue, de gravité dans son
langage et dons sa conduite. Cet état do choses joint à son naturel plus
vif, pins impétueux, quoique moins intelligent quo celui de Pierrr, et a un
penchant plus décidé pour les plaisirs grossiers qui étaient à sa portée, fai
sait que, vis-à-vis des gens qui dépendaient de lui, auprès de ses connais
sances, il jouissait d’une considération moins étcuduo que son aîné. Mais
s’il était moins respecté, on l’aimait lout autant que ce dernier, à deux
lieues à la ronde, et il le méritait véritablement. Indépendamment d’uue
naïve boulé de cœur, il avait une gaîté d’humeur et une malice facétieuse
qui lui donnaient la puissance de répandre lo rire autour de lui, parti
culièrement lorsqu’à la fin d’un repas une consommation suffisante de
petits pots d’eau-du-vie et do gloria surexcitait sa verve joviale et très
bruyante.
Le sentiment qui chez lui dominait tous les autres était son dévoûment
inaltérable et profond pour son frère Pierre, qui, au surplus, n’était pas
homme à lui en devoir de ce côté ; aussi, dans lo pays, l’amitié des deux
Gachelu était-elle proverbiale. Indépendamment d’une sympathie natu
relle, celte amitié s’expliquait encore par les circonstances de leur vie.
Ils avaient perdu leurs parens de bonne heure; demeurés seuls à la tôle
d’un héritage considérable, au lieu do partager leurs herbages, ils réso
lurent de les exploiter ensemble. Depuis douze ans, ils se chauffaient au
même foyer; or, pendant ces douze ans, jamais on n’entendit Pierre adres
ser une parole d’humeur ou de rcprocho à Jean, et jamais on ne vit ce
lui-ci hésiter un moment à se roi cre au premier désir do son aîné. Sans
doute, avec leurs nerfs un peu rudts et leur cœur peu subtil, ils n’attei
gnaient pas aux délicatesses d’un sentiment mignard; mais si, témoins
de leurs relations intimes et journalières, on ( ûl pu douter de l’étendue
et de la profondeur de leur fraternelle amitié, il n’en était pas moins
vrai qu’aucun d’eux n’eût balancé à risquer sa vie pour éviter un péril à
l’autre.
Leur habitation s’élevait, comme toujours en Normandie, au milieu
d’un verger entouré de baies vives et fermée par une barrière cri bois
point, aux doux côtés do la maison qui n’avait qu’un étage, on aper
cevait plusieurs bâtimens séparés ; ils rontermaient le pressoir à ci
dre, les caves, la laiterie, les écuries et les appartenions particuliers des
innombrables hubitans de la basse-cour qui pendant la journée se répan
daient dans tous les coins du verger.
L’existence de nos propriétaires, rois dans leur vaste domaine, était
d’une simplicité biblique. Presque sans communication avec les faits de
notre civilisation avancée, ils pratiquaient immuablement les mœurs d’un '
auire temps très suffisantes à satisfaire les modestes désirs et les rares
besoins qu’ils devaient à leur lempéramment antique, lisse levaient à
huit heures en toute saison. Dans cetto partie de la France le paysan mè
ne une existence plus douce que dans les environs do Paris. Lo polit cul
tivateur de nos banlieues intéressé, cupide, m’exténue à tourmenter son
coin de (erre que lo voisinage de la capilale transforme en mine pré
cieuse. Ses sueurs enfantent des trésors, et si, à force d’efforts et d’abs-
linences, il parvient à un élat de maigreur et de déformation repoussan
tes, son avidité est salisfaite et son but atteint. Dans les pays de pâtu
rage la terre produit presque seule, l’homme peut ne pas s’épuiser pour
recueillir, et c’c3t assurément là une des causes de la beauté des popula-
lionsde ces contrées. Donc lorsque huit heures sonnaient à l’horloge à botte
de la salle du rez-de-chaussée, on entendait les pieds de Pierre et do Jean
retentir sut lo plancher de leurs chambres situées au premier et uni
que otage de la maison, et bientôt les deux frères paraissaient sur lo
seuil de la sallo. Les premiers mots qu’ils prononçaient alors témoi
gnaient qu’un exercice préliminaire était parfaitement superflu pour ou
vrir leur formidable appétil.
— Tôt! tôt! Margot ton, fais-nous déjeuner! s’écriaient-ils en chœur
en s’adressant à une vieille servante qui se démenait devant ses four
neaux.
Puis quand ils avaient terminé le premier de leurs trois copieux repas,
munis d’une petite houe en bois élégamment façonnée, ils commen
çaient leur ronde dans le verger. Ils donnaient le coup d’œil du maître
aux instruirions qui servaient à l’exploitation, aux provisions, aux pro
duits des diverses récolles, au peuple de la basse-cour, composée de ca
nards, poules, oies, porcs, agneaux, tous bêlant, gloussant, grognant à
l’envi, et se précipitant sur le passage de ceux dont la visite était tou
jours pour eux l’annonce d’un supplément à leur pitance habituelle.
Celle marche triomphale au travers de sujets aussi empressés et soumis
que voraces n’avait pourtant pas lieu lo jour du marché du bourg voisin.
Ce jour, vivement attendu chaque semaine, formait uno puissante dis
traction à la vie unie et réglée de nos propriétaires. C’élait au marché
qu’on apprenait des nouvelles de Poissy, ville bien plus intéressante
aux yeux des éleveurs ie Normandie quo Tlièbes, Home ou Paris. On
rencontrait là sos amis, on buvait, on jasait, on flânait sur la place, on
achetait des babioles qui servaient à décorer les murs de la chambre, on
s’approvisionnait de poisson et autres friandises ; pendant trois ou qua
ire heures enfin on se donnait des sensations et du plaisir de quoi dé
frayer par le souvenir lo resta de la semaine.
A deux heures on revenait pour lo dîner, suivi tous les jours d’uno
promenade dans les herbages. Ces deux frères se livraient alors à l’exa
men de leurs magnifiques élèves répandus dans les pâturages et aussi
libres, mais moins farouches que ces bœufs du Brésil confiés aux sauva
ges et fantastiques Péons. Ils badinaient souvent avec quelques-uns d’en-
tra eux sans craindre un excès de familiarité quo la force prodigieuse
des Gachelu les incitait toujours à même de réprimer victorieusement.
Après celte inspection importante, nos héros sortaient de leur habitation
et allaient rendre quelques visites aux voisins. Le malador ou la mou
che faisaient attendre patiemment le souper de huit heures, après lequel
Pierre et Jean s’abandonnaient aux douceurs d’un sommeil dont nul
souci, nul remords no troublaient la douce quiétude.
On nous fera sans doute observer que dans lo tableau précédent nous
ne nous sommes guère occupé que delà vie physique des individus: c’est
qu’en vérité les besoins moraux do nos amis tenaient si peu de place dans
leur existence quo nous nous faisons presque un cas do conscience do
nous y arrêter. En effet, ils ava : ont appris du curé de leur village une
espèce de langago qui ressemblait plus au français qu’à un idiôme quel
conque; ils lisaienl, écrivaient et chiffraient assez proprement; mais le
livre des offices était le seul ouvrage sérieux, les parades des bateleurs et
les facéties de polichinelle, au marché du bourg, la seule littérature lé
gère qu’ils possédassent passablement. Nous devons même dire que les doux
frères, abonnés à un journal, no le lisaient jamais , les combinaisons du
style moderne les forçant à un travail d’intelligence trop pénible pour
arriver à saisir le sons des périodes des écrivains de noire temps. Au
reste,ils en savaient assez; ils savaient que leurs herbages n’enfermaient
pas absolument la totalité du royaume de France; quo le maire de la
commune , le percepteur , le garde champêtre et les gendarmes sont les
principaux fonctionnaires des ordres civils et militaires dans le gouver
nement ; et cette science , avec la crainte do Dieu , dans laquelle ils vi
vaient pieusement, satisfaisait, et au-delà, ce besoin do savoir ot do con
naître qui, à ce qu’on prétend, est un des plus impérieux de l’humanité.
N’oublions pas pourtant de sanctionner encore une des grandes dis
tractions do Jean , occupé moins sérieusement quo son frère. Poil -
dant quo celui-ci donnait dos ordres dans la maison, lo plus jeune des
Gachelu se délassait en appelant autour de lui ses favoris. Ces privi
légiés do la race animale consistaient en une superbe nichée de cor
beaux et un porc de l’âge le plus tendre, et qui, par sos façons gen
tilles et prestes, son air intelligent et la douceur infinie de sa voix ,
méritait vérilablement de se voir distingué entre ses frères do la mô
me portée, moins bien doués que lui. Dès quo Jean , un instant oisif,
se laissait tomber sur une chaise dans la salle du rez-de-chaussée en
poussant un certain cri, les corbeaux et Lubin ( c’élait lo nom du
jeune porc) arrivaient aussitôt. Lubin no connaissait plus de mère, plus
de frères lorsque son maître l’appelait. Bien qu’il fut en Iraiu de se
vautrer dans le verger, au soleil, au milieu de sa famille, ou le voyait so
relever vivement, dresser les oreilles autant que la nature de celles-ci le
permetlait, répondre par un grognement d’une douceur infinie au cri de
Jean, et se séparant délibérément de la bande, se diriger vers la salle en
trottant et en dounnnt à sa queue, d’une courbe si originale, mille mou-
vomens pleins de caprice et de fantaisie.
Avec une vivacité toute juvénile, Lubin frétillait autour de son maître,
se tenait sur ses pieds de derrière, tournait sur lui-mômo comme un
baladin, se couchait, faisait le mort, se relevait et s’arrêtant court et re
muant la queue comme un chien, attendait en roucoulant à sa manière
la récompense accordée à tant do mérite cl d’amabilité. Les corbeaux,
moins séduisans, mais également affectueux, se perchaient sur les épau
les, sur les genoux, sur la lêfe de Jean, le regardant et lo becquetant par
intervalle, le tout par amitié. Puis, ils ouvraient bientôt un largo bec et
entamaient une musique composée d’une seule noie, mais répétée avec
tant de volubilité, que ce croassement à six voix pouvait passer pour
un chant suivi, quoiqu’un peu monotone et très étourdissant. Jean re
lirait un vif plaisir do celle mélodie plus qu’antique par sa simplicité. En
efet, rarement il écoutait ce concert étrange sans s’abandonner à un
rire qui croissait jusqu’à devenir larmoyant , convulsif, et dsnt l’éclat
couvrait même la voix des concertons. Honteux et confus do so voirsur-
jasser, ceux-ci se luisaient alors, et se bornaient à pétrir de leurs griffes
es épaules de leur maître, jusqu’à ce que ce dernier se décidât à leur
distribuer le prix accoutumé de leur talent musical.
Pour terminer ce préambule, disons enfin qu’au moment où commence
celte histoire, le bruit se répandait dans le pays que les visites hebdo
madaires do Pierre et do Jean au bourg voisin avaient encore une outre
cause que des spéculations à préparer ou une multitude de glorias à con
sommer en jouant au matador.On parlait des jolies filles d’un éleveur du
bourg, Catherine et Dorothée, dont le pèro accueillait nos héros avec un
empressement très significatif. Pierre et Jean n’ouvraient pas la bouche
de leurs dessins supposés, mais ils n’entendaient point prononcer le nom
des doux jeunes filles sans émotion, et il paraissait certain que chaque fois
qu’ils se présenlaient chez le père de celles-ci, elles rougissaient jusqu’au
blanc des yeux, se sauvaient aussitôt au fond du jardin et ne se remon
traient qu’après lo départ des visiteurs, ce qui annonçait une sympathie
naissante: il n’y avait pas à s’y tromper. D'ailleurs uno dernière ob
servation corroborait les conjectures générales: l’humeur de Margolton
devenait de jour en jour plus difficile. Or, Margotton, qui avait élevé les
fils Gachelu et gouvernait leur ménage depuis quinze ans, ne so serait
point abandonnée à uno âcretéo croissante do langage, à une ucerbilé
progressive de manières, sans pressentir que son pouvoir, jusque-là in
contesté et sans partage dans certaines limites, était menacé d’une ruine
prochaine et totale peut-être.
Le 5 juin de l’année 183..., la table élait dressée dans la vaste salle du
rez-de-chaussée. Pierre Gachelu prit place au haut bout de la table ,
ayant son frère Jean à sa droite , et successivement ensuite les gens de
service et les domestiques do la maison , à l’exception do Margotton e
d m o jeune aide qui avait préparé le ripas du matin. Ce tableau d’inté
rieur rappelait une de ces scènes moyen-âge si bien dépeintes par Wal
ler Scott. Pour ajouter encore à la vérité de l’imitation , tous semblaient
avoir conservé le secret do ce formidable appétit quo nos porcs devaienijà
leur vie active. Après la fameuse soupe normande aux poireaux , on vit
arriver une solide pièce de bœuf, flanquée d’un plat do porc bouilli,
lequel était entouré d'nno telle quantité do légumes qu’on aurait supposé
des estomacs anté-diluvions seuls capables de convoiter une pareille
masso alimentaire. Cependant, une denn-heure après, tout avait disparu;
les domestiques so levèrent aprèsjpour reprendre leurs travaux, et il n’y
eut que les deux frères qui restèrent en présence d’un pot de cette détes
table liqueur appelée cau-do-vie de cidre, qu’un vrai Normand place au
dessus du nectar lo plus exquis que le génie de l’homme ait jamais in-
cnlé.
Lorsque Pierre et son frère eurent pratiqué une demi-douzaine d’hon
nêtes libations, sans que leur cerveau en reçut la plus légère attointe,
et seulement, comme ils disaicnl, pour réchauffer le petit cidre
précédait l’eau-de-vie, Jean sortit de l’état de béatitude dans lequel il
laissait opérer la digestion ; il se renversa en arrière sur sa chaise afin
de jeter à travers les fenêtres un coup d’œil sur le ciel, puis, so retour
nant vers la vieille servante qui enlevait les rares débris du déjeôner, il
lui dit d’un air d’enjoûment toujours plus prononcé chez lui à la fin de
chaque repas:
— Puisque lu es do si accorlo et do si belle humour ce malin, Margot,
je vus risquer de te demander un service.
— Qu’est-ce que c’est encore ! réplique celle-ci d’un ton revêche qui
prouvait l’ironio de l’assertion de Jean ; vous voulez donc me mettre sur
les dents! c’cest-à-diro qu’ici on n’a pas le temps de se moucher quand
on est enrhumé i
— Allons, Margot, co qu’on te demande n’est ni long ni difficile. Exa
mine un peu le temps, et dis-nous si nous aurons de l’eau aujourd’hui.
— Pardine! les nuages viennent d’aval, ils courent sur St-Bonneins
et le soleil pique comme une ortie de mai. Il n’y a pas de doute qu’il
tombera plus d’une averse dans la journée.
— Ah !... Margot, tu ne veux pas quo nous allions au marché.
— Au marché! dit la vieillo fille d’un ton de plus en plus acariâtre
et en continuant d’encombrer ses bras de plats ot d’assiettes vides.
Qu’est-co qno ça mu fait quo vous alliez au bourg ? le garde-manger et
le cellier sont pleins comme un œuf ; il n’y a rien à acheter, c’est vrai ;
mais quand ou no sait que faire, on est bien libre do dépenser deux cou
ples d’heures à baguenauder.
— Oh libre ! oui, comme toi d’être la plus douce et la plus agréable
des filles du pays d’Auge, répond Jean qui trouve toujours du plaisir à
exciter la liilo de Margoton.
— Bon, bon ! dit la servante on colère, si je ne suis pas meilleure, j’ai
du bon sens au moins, et assez pour prédire que certaines gens do ma
connaissance qui no se contentent pas de ce qu’ils sont, se réveilleront
pires un jour!
— Eli bien ! Je connais ton caractère et je garantis que tu ne te réveil
leras jamais ainsi, toi, dit Jean en riant de tout son cœur de son sar
casme.
— Oui da! s’écria Margojon devenant pourpre ot so débarrant de sos
assietlos pour parler avec plus do facilité ; on croyait pourtant valoir
encore quolquo chose I... Où est-ce quo vous trouverez un ménage mieux
tenu quo lo mien I y a-t-il dans ma cuisine assez do poussière pour faire
cligner l’œil d’uno mésange! ma vaisselle ne servirait-elle pas de mi
roir ! connaissez-vous dos fromages qui seraient assez effrontés pour se
mettre sur un plat à côté des miens I Et mon pain i on dirait d’uno brio
che I et mes lessives!... La Maclou me disait encore l’autre jour : mais
Margot, que failcs-vous à votre linge pour qu’il devienne si blanc, et
qu’il embaume comme ça.
— Là ! là ! ne t’emportes pas ainsi ; il n’est pas question de tes talens.
— Sii si! je m’entends...On a un air do me dire quo je no suis
bonne à rien, afin do justifier certaines idées... Malgré les cacholeries,
je sais co que je sais, toril de môme; la maison marche bien, mais on
crie, ot çi pour avoir le droit do déballer un jour ici doux belles demoi
selles qui ont des atours, de la jeunesse et des pistoles.
— Assez 1 dit alors de sa voix imposante Pierre Gachelu, reslé indif
férent jusque-là au bavardage do la vieille; je n’aime pas qu’on cherche
à deviner des projets qui no sont point censés exister, tant quo je n’ai
pas juge à propos d’en parler.
En entendant cette voix, à laquelle tout lo monde obéissait sans tergi
verser dans la maison, Margot s’interrompit soudain, quitta sa physiono
mie chagrine et maugréante, et continua de desservir, sans oser souffler
désormais.
Après un instant do silence, Pierre so lova, alla à la porte de la salle
et ordonna à un dos gens de service qui passait dans le verger de seller
les bidets dont so servaient habituellement les deux frères pour leurs
courses dans les environs ; puis s’avançant vers Jean, et lui donnant sur
l’épaule et de sa large main, une lape qui eut fait tressaillir un bœuf, il
ajouta : Allons, l’heure s’avance, et nous n’avons que le temps de nous
habiller, montons à notre chambre, frère.
Mais comme Pierre mettait le pied sur l’csca.iur qui conduisait à l’é
tage supérieur, Margot qui allait ot vouait do sa cuisine à la salle, ren
fla, et d’un air empressé ot doucereux destiné à se faire pardonner sou
indiscret bavardage de tout à l’heure, elle dit eu regardant l’aîné des
Gachelu.
— Attendez un pou, monsieur Pierre, je crois que voici le facteur,
nous allons sans doute recevoir des nouvelles de Mlle Henriette I
Le facteur, répète Pierre en so retournant vivement et en regardant le
messager rural comme un homme qu’on aperçoit une ou deux fois par
an. Au fait, il y a au moins six mois que celte chère enfant ne nous a
éarit.
— Oui, ajouta Jean , en s’avançant aussi avec empressement vers la
porte de la sallo qui donnait sur lo" verger, ot m’est avis que ça me fera
un rude plaisir d’apprendre que la petite cousine est toujours joyeuse et
en santé.
Lo facteur entra et en effet remit uno lettre à l’aîné do la famille, ce
qui., à bon droit, pouvait passer pour un incident dos plus rares dans la
maison. Pierre s’approchant aussitôt d’une fenêtre, décacheta la missive-
et en lut quelques lignes avec une difficulté provenant d’un défaut d'ha
bitude do ces sortes d’occupations. Cependant, à mesure qu’il avançait
péniblement dans sa lecture, son front se rembrunissait, sos sourcils se
fronçaient, sou regard, ordinairement tranquille, s’animait sensiblement,
et bientôt son visage laissa voir les traces d’uno agitation violente et pro
fonde.
Malgré sa curiosité , Jean , par déférence pour son aîné , s’était rési
gné à attendre que ce dernier eût fini, pour lui demander des nouvel
les, et il amusait son impatience en versant quelques verres do cidre
que le facteur engloutissait successivement, sans craindre de compro
mettre sa dignité de fonctionnaire public. Pour Margot , les deux poings
appuyés sur la table, le corps penché en avant, clic dévorait des yeux lo
lecteur et la lettre , et son respect sans bornes pour Pierre Gachelu suf
fisait à peine pour l’empêcher de le questionner.
Mais, lorsque les signes du troublede celui-ci devinrent tellement évi-
dens qu’il fut impossible do n’en être pas frappé , la vieillo fille et Jean
ne purent contenir davantage leur impatience , et tous deux s’écrièrent
en même temps :
Qu’est-ce qu’il y a donc? Bon Dieu 1 qu’cst-co qu’il y a?
Pierre laissa tomber la lettre sur ses genoux, parut so recueillir un
instant et faire d’énergiques efforts pour recouvrer quelque caltno; puis,
s’adressant à Jean, il répondit d’uno voix un peu altérée :
— Bien... rien... la lettre n’est pas d’Henriette.
— Elle n’est pas do ma clièro petiote ! s’écrie la vieillo fille que cette
vague réponse ne saurait rassurer. Alors on écrit pour elle! alors elle est
malade I
— Serait-il, en effet, question do ça? ajoute Jean avec une émotion
qui preuve son intérêt pour cello dota on s’occupe.
— Non! non ! répond Pierre avec vivacité et comme importuné do ccg
interrogations. Elle se porte bien. Les nouvelles qu’on mo donno n’ont
aucun rapport à sa santé ; ainsi, Margot, pas de jérémiades... Quaut au
contem
frère, j
r- C
malade
— E
Voyons
reparle
d’heuri
Malg
parente
niait co
moins i
Quand
d’entre,
et qu’il
de son
qu’à so
sa blou
blemen
Un i]
Jean rc
à laillo
vert. L
ralo de
par un
droite >
minée
En i
était pi
l'avait
Bientôt
songer
quillité
10 prei
Margol
franch:
Jean
cet ap[
compa,
avait
pendai
gislral
à son i
race d
Mais, 1
à Fond
dissipe
infinin
qu’il h
agréab
— I
vous a
— A
ironiqi
— P
_ j
passe i
neut d
— à
chère
— 1
— A
— 1
ire n’e
on pot
— B
11 Iretn
— C
ser, m
l’ai jat
fairo d
Et .
courai
Pou
mardi
formel
quarts
monte
bientô
une pi
en sii
bouffé
alors i
ce fut
Marge
Voyoi
dans 1
père :
fier. 1
Fargr
co ton
indép
y a q
ost fai
pouss
Cepoi
j’ai vi
Voyoi
que t
petite
de ce
aura
tu n’t
roi ho
inênv
noire
Ire jo
Fargo
Plu nu
semb
Et
entre
mais
à un
paisse
j’ai p
chant
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 87.91%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 87.91%.
- Auteurs similaires Morlent Joseph Morlent Joseph /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Morlent Joseph" or dc.contributor adj "Morlent Joseph")La Revue du Havre illustrée : littérature, beaux-arts, romans, modes, théâtres, feuilletons, anecdotes /ark:/12148/bd6t542576976.highres Revue du Havre et de l'arrondissement, Courrier de Graville : industrie, commerce, agriculture, sciences, nouvelles, théâtres, feuilletons, tribunaux, modes ["puis" politique, industrie, commerce, agriculture, sciences, nouvelles, théâtres, feuilletons, tribunaux, modes] /ark:/12148/bd6t54257597v.highres
-
-
Page
chiffre de pagination vue 2/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k923473x/f2.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k923473x/f2.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k923473x/f2.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k923473x
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k923473x
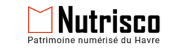


Facebook
Twitter