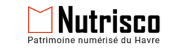-11 -
Ces conseillers écoutent ce jour-là le long rapport d'un des leurs, M. Ravier qui
parle au nom de la Commission des finances : les dépenses présentent deux chapitres
nouveaux, d'abord l'assurance pour garantir les risques d'accidents sur la voie publique,
Bléville en ayant connu un lors d'une dernière fête de la St-Jean ; puis une participa
tion à l'assurance de la Ville du Havre en faveur de ses vaillants sapeurs-pompiers qui
n'hésitent pas à se déranger dès qu'on a besoin d'eux.
Tout en déplorant l'absence de crédits pour acheter des fournitures scolaires
gratuites aux enfants de familles nombreuses, il veut croire que le Conseil voudra bien
s'inspirer de l'expérience des grandes communes voisines qui tirent des revenus impor
tants, des centimes additionnels, «source très légitime - précise-t-il - puisqu'elle ne
provient que de l'aisance et de la fortune acquise».
Quant à la taxe sur l'alcool, elle «ne frappe que la gourmandise des uns ou le
vice des autres». Et il ajoute : «N'est-ce pas, en effet, à la consommation immodérée
de l'alcool que sont dûs la plupart des maux qui obligent prématurément l'humanité
et cause en grande partie les importantes dépenses des services d'assistance ?».
Enfin, si le Conseil émet un avis favorable à la création d'une foire à Criquetot-
l'Esneval, le 16 septembre de chaque année, il refuse de donner son feu vert pour
l'achat d'une machine à écrire pour la Mairie.
Début 1913, les Conseillers se voient dans l'obligation d'adresser des félicitations
à l'un des leurs, M. Farcis, qui vient d'être nommé Chevalier dans l'Ordre du Mérite
Agricole. Le 9 mars, ils écoutent un nouveau rapport de M. Ravier qui déplore le
trop grand nombre d'illettrés et le nombre encore plus considérable de «quasi-
ignorants», malgré 30 ans d'enseignement obligatoire. Pour lui, c'est le pharisaïsme
qui en est la cause : la plupart des Conseillers Municipaux dans le pays de Caux appar
tiennent à des familles puissantes peu enclines à voter des crédits suffisants au bon
fonctionnement de l'école. Il trouve navrant pour la démocratie que les électeurs
ruraux ne sachant de la politique que ce que veut bien leur dire le curé. Ce bon répu
blicain sait trouver des accents convaincants puisque le Conseil décide aussitôt un
crédit de 100 F pour la caisse des écoles.
Et l'on arrive à la mémorable séance du 7 septembre, quelque peu agitée, une
fois n'est pas coutume : le Maire subit un «véritable réquisitoire» pour reprendre sa
propre expression, il est vrai que les griefs formulés contre lui sont nombreux et va
riés : ne lui reproche-t-on pas sa négligence, sa légèreté, son manque de surveillance,
son impéritie, sa mauvaise foi ef les insultes qu'il profère ? Ne l'accuse-t-on pas d'être
un farceur, de jouer les Valentino ? Il y a même une proposition de lui voter un
blâme. Inutile de dire que ce Conseil vit sa dernière séance. Inutile également de
chercher pourquoi il n'y a jamais eu de rue Petitot à Bléville.
Il faut attendre le 2 novembre pour que la commune ait un nouveau Maire. Il
s'agit tout bonnement d'Henri Labay, élu avec 13 voix tandis que 7 se portent toute
fois sur Alexandre Petitot. Le nouveau Conseil examine alors les statistiques : 52 nais
sances de garçons et 43 de filles ont été enregistrées alors que 47 hommes et 40 fem
mes sont décédés.
Après avoir décidé une taxe de 15 F par hectolitre d'acool, il vote un crédit de
15 F pour acheter un portrait du Président Poincaré ainsi que 3 isoloirs à 20 F pièce.
Le début de l'année 1914 ne semble pas voir d'amélioration dans la distribution
du courrier: le Conseil demande en effet le déplacement du facteur dont on a remarqué
les « singuliers agissements ».
Ce premier semestre connaît à nouveau quelques rebondissements dans l'élection
du Maire, on a un peu l'impression d'un feuilleton à épisodes. C'est ainsi que le 28 mars,
il faut procéder à plusieurs opérations : élu, Henri Labay refuse ; successivement élus
deux fois de suite, Eugène Morisse et Edouard Arquis refusent également. Le 12 avril,
même scénario, Eugène Morisse décline encore deux fois l'honneur d'être Maire. Le
18 avril enfin, Henri Labay est à nouveau élu et accepte cette fois. L'examen des
recettes de 1913 laisse apparaître un excédent de 5.939 F.
Ces conseillers écoutent ce jour-là le long rapport d'un des leurs, M. Ravier qui
parle au nom de la Commission des finances : les dépenses présentent deux chapitres
nouveaux, d'abord l'assurance pour garantir les risques d'accidents sur la voie publique,
Bléville en ayant connu un lors d'une dernière fête de la St-Jean ; puis une participa
tion à l'assurance de la Ville du Havre en faveur de ses vaillants sapeurs-pompiers qui
n'hésitent pas à se déranger dès qu'on a besoin d'eux.
Tout en déplorant l'absence de crédits pour acheter des fournitures scolaires
gratuites aux enfants de familles nombreuses, il veut croire que le Conseil voudra bien
s'inspirer de l'expérience des grandes communes voisines qui tirent des revenus impor
tants, des centimes additionnels, «source très légitime - précise-t-il - puisqu'elle ne
provient que de l'aisance et de la fortune acquise».
Quant à la taxe sur l'alcool, elle «ne frappe que la gourmandise des uns ou le
vice des autres». Et il ajoute : «N'est-ce pas, en effet, à la consommation immodérée
de l'alcool que sont dûs la plupart des maux qui obligent prématurément l'humanité
et cause en grande partie les importantes dépenses des services d'assistance ?».
Enfin, si le Conseil émet un avis favorable à la création d'une foire à Criquetot-
l'Esneval, le 16 septembre de chaque année, il refuse de donner son feu vert pour
l'achat d'une machine à écrire pour la Mairie.
Début 1913, les Conseillers se voient dans l'obligation d'adresser des félicitations
à l'un des leurs, M. Farcis, qui vient d'être nommé Chevalier dans l'Ordre du Mérite
Agricole. Le 9 mars, ils écoutent un nouveau rapport de M. Ravier qui déplore le
trop grand nombre d'illettrés et le nombre encore plus considérable de «quasi-
ignorants», malgré 30 ans d'enseignement obligatoire. Pour lui, c'est le pharisaïsme
qui en est la cause : la plupart des Conseillers Municipaux dans le pays de Caux appar
tiennent à des familles puissantes peu enclines à voter des crédits suffisants au bon
fonctionnement de l'école. Il trouve navrant pour la démocratie que les électeurs
ruraux ne sachant de la politique que ce que veut bien leur dire le curé. Ce bon répu
blicain sait trouver des accents convaincants puisque le Conseil décide aussitôt un
crédit de 100 F pour la caisse des écoles.
Et l'on arrive à la mémorable séance du 7 septembre, quelque peu agitée, une
fois n'est pas coutume : le Maire subit un «véritable réquisitoire» pour reprendre sa
propre expression, il est vrai que les griefs formulés contre lui sont nombreux et va
riés : ne lui reproche-t-on pas sa négligence, sa légèreté, son manque de surveillance,
son impéritie, sa mauvaise foi ef les insultes qu'il profère ? Ne l'accuse-t-on pas d'être
un farceur, de jouer les Valentino ? Il y a même une proposition de lui voter un
blâme. Inutile de dire que ce Conseil vit sa dernière séance. Inutile également de
chercher pourquoi il n'y a jamais eu de rue Petitot à Bléville.
Il faut attendre le 2 novembre pour que la commune ait un nouveau Maire. Il
s'agit tout bonnement d'Henri Labay, élu avec 13 voix tandis que 7 se portent toute
fois sur Alexandre Petitot. Le nouveau Conseil examine alors les statistiques : 52 nais
sances de garçons et 43 de filles ont été enregistrées alors que 47 hommes et 40 fem
mes sont décédés.
Après avoir décidé une taxe de 15 F par hectolitre d'acool, il vote un crédit de
15 F pour acheter un portrait du Président Poincaré ainsi que 3 isoloirs à 20 F pièce.
Le début de l'année 1914 ne semble pas voir d'amélioration dans la distribution
du courrier: le Conseil demande en effet le déplacement du facteur dont on a remarqué
les « singuliers agissements ».
Ce premier semestre connaît à nouveau quelques rebondissements dans l'élection
du Maire, on a un peu l'impression d'un feuilleton à épisodes. C'est ainsi que le 28 mars,
il faut procéder à plusieurs opérations : élu, Henri Labay refuse ; successivement élus
deux fois de suite, Eugène Morisse et Edouard Arquis refusent également. Le 12 avril,
même scénario, Eugène Morisse décline encore deux fois l'honneur d'être Maire. Le
18 avril enfin, Henri Labay est à nouveau élu et accepte cette fois. L'examen des
recettes de 1913 laisse apparaître un excédent de 5.939 F.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 89.19%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 89.19%.
- Auteurs similaires Société havraise d'études diverses Société havraise d'études diverses /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Société havraise d'études diverses" or dc.contributor adj "Société havraise d'études diverses")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 11/42
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k32142342/f11.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k32142342/f11.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k32142342/f11.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k32142342
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k32142342