Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1918-07-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 juillet 1918 01 juillet 1918
Description : 1918/07/01 (A85)-1918/09/30. 1918/07/01 (A85)-1918/09/30.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58082641
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/01/2012
— 315 —
graphe serait-il conduit à donner la même portée à des thèmes
moins faciles à identifier à première vue (le sagittaire, les
damnés....) Mais, après ces enquêtes, ce qu'il continuerait
d'affirmer c'est que rares sont les symboles et très fréquentes
les « fantaisies » qui se refusent à tout essai d'interprétation
rationnelle.
Au XIIe siècle, des sculpteurs de Languedoc ou de Bourgogne
savent, à la vérité, développer sur un tympan, sur un cham-
branle, enrouler à un chapiteau, des ensembles ordonnés qui
sont des illustrations de textes essentiels. Ils donnent ainsi
comme les premiers feuillets « incunables » des grands livres
d'enseignement sacré que seront les cathédrales du XIIIe siècle.
Mais, en Bourgogne aussi et en Languedoc, entre ces
feuillets de doctrine, que de croquis, que de graffites, que de
« fantaisies » pour nous sans portée, mais que les hommes les
plus éminents de l'Église n'hésitaient pas à condamner! Ils
n'avaient donc ni suggéré, ni même surveillé ces décorations.
Une page d'un de ces docteurs, le plus grand du XIIe siècle,
saint Bernard, a été souvent produite (1) : « Coeterum in
claustris coram legentibus fratribus quid facit ridicula monstruositas
mira quoedam de for mis formositas ac formosa deformitas ? Quid ibi
immundoe simioe ? Quid feri leones ? Quid monstruosi centauri ? Quid
semi-hommes ? Quid maculosoe tigrides ? Quid milites pugnantes ?
Quid venatores tibicinantes ? Videas sub capite multa corpora e
rursus in uno corpore capita multa Proh Deo ! si non pudet
ineptiarum, cur vel non piget expensarum ? » On a pu reconnaître
dans ce texte plusieurs des motifs sculptés aux chapiteaux de
Graville : semi-homines, milites pugnantes, sub capite multa cor-
pora... C'est en 1124 que saint Bernard condamnait, sept siècles
d'avance, toute interprétation symbolique de l'ensemble de
l'iconographie romane. Ces sculptures ne sont pas des hiéro-
glyphes dont l'archéologue peut s'efforcer d'être le Champollion ;
ce ne sont, le plus souvent, que les jeux d'une imagination
jeune, ardente, mais encombrée de réminiscences confuses,
tourmentée du souci de reproduire des modèles étranges et
pour elle inintelligibles. Ces fantaisies, ces souvenirs et ces
(1) Apologia ad Guillelmum Sancti Theodoriri Remensis abbatem, dans
Patrologia latina de MIGNE, tome CLXXXII, colonne 916. Reproduit dans V. MORTET.
Recueil de textes relatifs à l'histoire de l'Architecture, p. 369.
4
graphe serait-il conduit à donner la même portée à des thèmes
moins faciles à identifier à première vue (le sagittaire, les
damnés....) Mais, après ces enquêtes, ce qu'il continuerait
d'affirmer c'est que rares sont les symboles et très fréquentes
les « fantaisies » qui se refusent à tout essai d'interprétation
rationnelle.
Au XIIe siècle, des sculpteurs de Languedoc ou de Bourgogne
savent, à la vérité, développer sur un tympan, sur un cham-
branle, enrouler à un chapiteau, des ensembles ordonnés qui
sont des illustrations de textes essentiels. Ils donnent ainsi
comme les premiers feuillets « incunables » des grands livres
d'enseignement sacré que seront les cathédrales du XIIIe siècle.
Mais, en Bourgogne aussi et en Languedoc, entre ces
feuillets de doctrine, que de croquis, que de graffites, que de
« fantaisies » pour nous sans portée, mais que les hommes les
plus éminents de l'Église n'hésitaient pas à condamner! Ils
n'avaient donc ni suggéré, ni même surveillé ces décorations.
Une page d'un de ces docteurs, le plus grand du XIIe siècle,
saint Bernard, a été souvent produite (1) : « Coeterum in
claustris coram legentibus fratribus quid facit ridicula monstruositas
mira quoedam de for mis formositas ac formosa deformitas ? Quid ibi
immundoe simioe ? Quid feri leones ? Quid monstruosi centauri ? Quid
semi-hommes ? Quid maculosoe tigrides ? Quid milites pugnantes ?
Quid venatores tibicinantes ? Videas sub capite multa corpora e
rursus in uno corpore capita multa Proh Deo ! si non pudet
ineptiarum, cur vel non piget expensarum ? » On a pu reconnaître
dans ce texte plusieurs des motifs sculptés aux chapiteaux de
Graville : semi-homines, milites pugnantes, sub capite multa cor-
pora... C'est en 1124 que saint Bernard condamnait, sept siècles
d'avance, toute interprétation symbolique de l'ensemble de
l'iconographie romane. Ces sculptures ne sont pas des hiéro-
glyphes dont l'archéologue peut s'efforcer d'être le Champollion ;
ce ne sont, le plus souvent, que les jeux d'une imagination
jeune, ardente, mais encombrée de réminiscences confuses,
tourmentée du souci de reproduire des modèles étranges et
pour elle inintelligibles. Ces fantaisies, ces souvenirs et ces
(1) Apologia ad Guillelmum Sancti Theodoriri Remensis abbatem, dans
Patrologia latina de MIGNE, tome CLXXXII, colonne 916. Reproduit dans V. MORTET.
Recueil de textes relatifs à l'histoire de l'Architecture, p. 369.
4
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.98%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.98%.
- Auteurs similaires Société havraise d'études diverses Société havraise d'études diverses /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Société havraise d'études diverses" or dc.contributor adj "Société havraise d'études diverses")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 49/68
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k58082641/f49.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k58082641/f49.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k58082641/f49.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k58082641
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k58082641
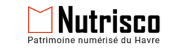


Facebook
Twitter