Titre : Le Petit Havre : organe républicain, démocratique, socialiste ["puis" organe républicain démocratique "puis" bulletin d'informations locales]
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1913-12-26
Contributeur : Fénoux, Hippolyte (1842-1913). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836500g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 26 décembre 1913 26 décembre 1913
Description : 1913/12/26 (A33,N11830). 1913/12/26 (A33,N11830).
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t52638676b
Source : Bibliothèque municipale du Havre, PJ5
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/04/2023
35“ Annee — Ne 11,8301
Administraleur -Délégué- Gérant
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Adninistration
à M. 0. RANDOLET
35, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havre
Administration, Impressions et Annonces, TEL. 10.47
(6 Pages) 5 Cenumes— 1011 ION DU MATIN — B Centimes (c Pages) Vendredi 96 Boons.., Hi?
as2q4278725-2427-8.2272A2AS)E2E94S:C22TNGNC/N:sE1FRCRT*Z2s*tA@SSSRcLSNz*RERNYRRE=R#RYRRRRTzzWacai=NNSm======" C V -V UrUOMfC 1.10
" '——~—*———----------===%===%%=2*= 2=nas=sarnaszsnsaaser se
RDACTION
Adresser tout ce qui concerne la Rédaction
35, Rue Fontenelle, 35
TLLPHONE 8 N 3.G0
pR
AU HAVRE.
A PARIS
ANN ON CES
Bureau du Journal, 112, bould de Strasbourg.
( L'AGENOE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
’ seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
ORGANE REPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
ABONNEMENTS
Trois Mois
Six Mois
UN AN
18 PETIT HAVRE est désigné pour les Annonces Judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
Le Havre, la Seine-Inférieure, l’Eure,
l’Ois® et la Somme ’
Autres Départements
Union Postale
G Fr.
10 »
• Fr.
« so
16 Fr.
2090 " f$P — 2 A •
On s’abonna également, SANS FRAIS, dans tous les Bureaux da Poste
— »
0 »
da France
Paris, trois heures matin
======= —= . . - == — = ==========
LES AFFAIRES DU MAROC
Vapeur attaqué par les Marocains
GIBRALTAR. — Des Marocains
zontre le vapeur britannique
Londres, échoué sur le littoral
face de Tarifa. Un homme de
été tué. Les autres, ainsi que
ont fait feu
Ludgate, de
africain, en
l’équipage a
la cargaison
qui a une grande valeur, courent de grands
dangers.
Il a fallu suspendre les tentatives de ren-
flouement en présence de l'hostilité des Ma
rocains.
Un vapeur de sauvetage est parti avec
deux mitrailleuses et an détachement naval.
Le croiseur anglais Roxbargh et le croiseur
espagnol Pelayo se rendent sur les lieux.
UNE MESURE DE CLÉMENCE DEMANDÉE
M. Charles Humbert a écrit au ministre de
la guerre une lettre dans laquelle is séna
teur de la Meuse lui demande de proposer
au gouvernement la grâce entière de tous
les militaires condamnés . punis à la suite
des manifestations occasionnées par l’annon-
co du maintien sous les drapeaux de la
classe 1910.
UN DRAME PASSIONNEL
TROYES. — On signale qu’au pont Sainte-
Marie, un nommé Vialet, âgé de 30 ans, ma-
ouvrier, a, par jalousie, tué sa femme d’un
coup de fusil.
La victime, qui était âgée de 28 ans, laisse
rois enfants en bas âge.
VOYAGE AÉRIEN
BERNE. — L’aviateur suisse Rider qui se
trouvait à Paris avec la commission suisse
de l'aviation militaire, a quitté hier matin, à
0 heures l'aérodrome de Bac, sur monoplan
?t a atterri à Berne dans l’après-midi, à
7 h. 13.
L’aviateur s’est maintenu presque cons
tamment à une altitude de deux mille mè-
très, afin de se tenir au-dessus du brouillard.
Il passa le Jura sans le voir. Il dut s’orienter
sur les sommets des Alpes bernoises, la
Jungfrau, I E ger et le Monch qu’il aperçut
9 ne heure et demie avant d’arriver à Berne.
. - • - 5 '
UN NOUVEL HYDRAVION ITALIEN
ROME. — Ou expérimentera prochaine
ment au camp d’aviation de Mirafiori un hy-
dravion dont la stabilité serait assurée de fa
çon absolue et dont la vitesse dépasserait
deux cents kilomètres à l'heure.
L’EXPLOSION DE TORRE ANNUNZIATA
Naples, — On a fini de déblayer les dé-
sombres de l’établissement de Torre-Annun-
ziata.
Les morts seraient au nombre de quatorze.
Il y a cinq blessés dont l’état est aussi satis-
faisant que possible.
OFFICIERS FUSILLÉS EN CHINE
. MARSEILLE. — Le courrier de Chine, arrivé
par le Transsibérien, apporte les nouvelles
suivantes :
Pékin, 2 décr nbre. — Par ordre du prési
dent Yuan-Shi-Kaï, le commandant Kono et
dix officiers, dont les troupes se sont muti
nées à Kiang-Yun et à Tchang-Seng, ont été
fusillés.
Environ deux cents soldats seront égale
ment passés par les armes.
LA CRISE MINISTÉRIELLE
EH BULGARIE
Sofia. — Dans les milieux renseignés le
bruit court qu’à la suite de sa mise en accu
sation et pour éviter la chute du Cabinet en-
ier,M. Ghenadieft, ministre des affaires étran
gères, aurait décidé de démissionner.
Sa retraite serait imminente et M. Radosla-
voff, président du Conseil, prendrait le por
tefeuille des affaires étrangères.
LA PESTE ER SIBÉRIE
KITARBIE, 2 décembre. — La peste et le
choléra ont fait leur apparition ; les deux
fléaux ravagent le pays.
DERNIÉRE HEURE SPORTIVE
Football Association
Football Club Rouennais (mixte) bat Union
Sportive Suisse (mixte) par 3 buts à 1.
LES AFFAIRES D'ORIENT
La Turquie et les Réformes
Berlin, 23 décembre.
Selon une dépêche de Constantinople à la
Gazette de Francfort, le grand-vizir recevra
aujourd’hui les ambassadeurs d’Allemagne
et de Russie. Le grand-vizir leur déclarera
solennellement l’intention ferme de la Porte
d’entreprendre des réformes dans les pro
vinces arméniennes avec la collaboration des
grandes puissances. Le grand-vizir exposera
ensuite le programme des réformes qui dif-
1ère sur quelques points de celui qui fut
convenu, il y a quelques mois, par le Conseil
des ambassadeurs réuni à Constantinople.
La Délimitation Serbo-Grecque
Salonique, 85 décembre.
La Commission gréco-serbe,chargée de dé
limiter la nouvelle frontière, a terminé ses
travaux.
Elle a laissé aux deux gouvernements le
soin de résoudre deux points sur lesquels
l’accord n’a pu s’établir.
LES
M. de Freycinet vient de publier le se
cond volume de ses Souvenirs, sur la pé
riode qui s’étend de 1878 à 1893. Gambetta
disait de son ancien collaborateur de Tours :
« Comme intelligence, c’est un filtre ». La
formule apparaît merveilleuse d'exactitude
au lecteur de ces 500 pages, si vite finies et
d’une si séduisante limpidité.
Si l’on veut connaître et surtout com
prendre la période confuse de notre histoire
politique qui va du 16 mai à la chute de
Ferry, il ne faut pas chercher d’autre guide
que M. de Freycinet. Sans avoir l’air d’y
toucher, sans artifice apparent, par la seule
vertu d’une étonnante lucidité, cet incom
parable écrivain sème partout de la clarté.
Avant de l’avoir lu je n’avais pas vraiment
compris la géographie morale de ces pre
miers parlements du régime, qui furent le
creuset de nos partis actuels.
Les républicains, qui s’étaient unis pour
combattre la tentative réactionnaire de Mac-
Mahon se séparèrent quand ils furent vain
queurs. On discerna de suite, dans la majo
rité,quatre groupes répondant à quatre tem
péraments. Il y avait d'abord, formant l’aile
droite, les fameux Centre-Gauche, républi
cains sincères, mais d’esprit conservateur,
vrais continuateurs de l’Orléanisme bour
geois ; c’étaient les seuls républicains avec
lesquels Mac-Mahon consentit à causer :
quand le maréchal eut démissionné, ces
grands doctrinaires de cabinet,qui n’avaient
pas de force électorale, furent presque im
médiatement jetés par-dessus bord.
Venaient ensuite les membres de la Gau
che républicaine, dont Jules Ferry symboli
sait la personnalité: ce furent de suite et
essentiellement des modérés gouvernemen
taux, largement ouverts à la politique des
réformes, mais avant tout gouvernemen
taux. Ils ne se distinguaient que par cette
nuance — importante il est vrai — du
groupe de Gambetta, Y Union républicaine:
les amis du grand tribun faisaient d’abord
figure de démocrates, mais c’étaient des
démocrates de gouvernement, se rendant
compte que la responsabilité du pouvoir
comporte le sens de l’opportunité, de l'équi-
libre et de la sagesse. C'est justement parce
qu’il était gouvernemental que Gambetta
vit, très vite, se former sur sa gauche une
sorte d’escadron de cavalerie légère, tou
jours prêt à le harceler, le groupe des intran
sigeants : démocrates, parfois démagogues,
qui ne tenaient plus, eux, aucun compte
des nécessités éternelles d’un gouverne
ment.
Tant que Gambetta vécut, il y eut riva
lité non dissimulée entre ses amis et ceux
de Ferry. Les amis de Gambetta soute
naient sans doute Ferry au pouvoir, mais
sans chaleur et sans qu’il pût vraiment
compter sur eux. Lorsqu’à son tour Gam
betta fut ministre — pendant six semaines
— la plupart des ferrystes se réservèrent,
bien que leur chef se fût toujours montré
très correct envers le grand tribun. C’est
seulement après la mort de Gambetta que
Ferry réussit à unifier les deux équipes en
un grand parti de gouvernement, qui fut la
base de sa majorité pendant son grand mi.
nistère (1883-1883) et qui reste dans l'llis-
toire sous le nom de parti opportuniste.
Telle est l'origine des républicains de
gouvernement. C’est eux qui, contre les
violents stériles de l'Extrême-Gauche, con
tre les timorés du Centre-Gauche et les
irréconciliables de la Droite, ont conçu et
réalisé les réformes qui font vraiment l’ar
mature du régime.
- A distance, après un quart de siècle
écoulé, l’unité de l’œuvre apparaît brillante
et solide. Mais ne cherchons pas à nous
dissimuler qu’elle fut accomplie au milieu
de rivalités personnelles violentes et de
luttes intestines presque continuelles. A
cet égard, le récit de M. de Freycinet nous
révèle des dessous bien intéressants. Je re
grette cependant, en curieux incorrigible,
qu'il laisse non résolus deux ou trois pro
blèmes historiques qu’il serait pourtant
bien utile de tirer au clair.
M. de Freycinet me semble, tout d’abord,
faire la lumière complète sur ce qu’on a ap-
pelé, à l’époque, « le gouvernement occulte»
de Gambetta. Ce gouvernement occulte a
certainement été une réalité. Il y avait des
ministres, des présidents du Conseil, mais
tout se faisait dans le cabinet de Gambetta.
Quand un homme politique constituait un
ministère, il ne pouvait réussir qu’en se
tenant en communication constante avec
celui qui était le grand chef de la majorité.
« Prenez un tel. je ne veux pas de tel au
tre », disait Gambetta : et il fallait tenir
compte de ces indications ou de ces « ex
clusives », sous peine de manquer la com
binaison ou d’en faire une combinaison
mort-née. C’est ainsi que le général Farre
fut ministre de la guerre ; c’est encore
ainsi que Waddington, lors du premier
ministère Freycinet, ne rentra pas au quai
d’Orsay. Dans l’exercice du gouvernement,
c’était la même dépendance des détenteurs
apparents du pouvoir. Pour avoir voulu, en
1880, faire sa propre politique, M. de Frey
cinet tomba, en pleines vacances parlemen
taires et sans même avoir été mis en mino
rité par la Chambre : comme dans les tra
gédies de palais, il avait suffi de l’opposi
tion même silencieuse de Gambetta pour
le tuer.
. Pourquoi Gambetta n’était-il donc pas
premier ministre, au lieu de créer la plus
fausse des situations en gouvernant du
haut de son fauteuil de président de la
Chambre? M. de Freycinet montre très
bien que Grévy, qui n’aimait pas Gambetta,
ne lui offrit jamais le pouvoir avant l’épo
que du « grand ministère ». L’Elysée était
jaloux du Palais-Bourbon. Mais notre si
limpide historien ne nous dit pas si Gam
betta désira vraiment être premier ministre
et s’il fit ce qu’il fallait pour le devenir.
Les adversaires du « dictateur » ne man
quent pas de dire, aujourd’hui encore, qu’il
n’avait aucune envie de prendre la respon
sabilité de la présidence du Conseil ; ils le
montrent au contraire désireux d’exercer
en sous main la réalité du pouvoir, comme
chef de la majorité, par l’intermédiaire de
ministres qu’il inspirait. Les Gambettistes
protestent contre une pareille accusation.
Mais j’avoue rester hésitant entre les deux
affirmations contraires : Grévy, sans doute,
n’offrit le ministère à son rival qu’à la
dernière extrémité ; mais quelle hâte sin
gulière avait mis ce dernier, lors de la no
mination de Grévy, à se faire élire au fau
teuil de la Chambre ! Peut-être est-il encore
trop tôt pour être renseigné sur ce point
d’histoire. Evidemment, si M. do Freycinet
ne fait pas à ce sujet la lumière, c’est qu’il
ne le désire pas.
L’impression que laisse la vue de ces
coulisses d’une époque déjà presque histo
rique est en somme à la fois attristante et
consolante. Il est attristant de voir ces
grands hommes, qui firent une si belle
œuvre, se jalouser et s’user mutuellement
en des rivalités qu’on pourrait appeler ri
valités de couloirs. Il est consolant de pen
ser qu’aucune période — même la nôtre —
n’a le monopole de ces petitesses, et que
les meilleurs hommes d’Etat ont dû tra
vailler dans les rudes et médiocres condi
tions du terroir humain.
André Siegfried.
Une Convocation d’Homme politiques
La convocation suivante a été adressée à
un certain nombre de sénateurs et députés :
Paris, 22 décembre 1913.
a Nous avons l’honneur dé vois prier de
vouloir bien vous trouver vendredi soir 26
décembre, à huit heures et demie, rue d’Ea-
ghien, 16, dans le but de nous entretenir,
entre républicains, de la situation politique,
st d’envisager une organisation à établir en
vue des prochaines élections législatives. »
Aristide Briand, Louis Barthou, Jean
Dupuy, Stéphen Pichon, Pierre Bau
din, Lourties, Jean Morel, Ratier, Vi-
gier, Charles Dumont, Eugène Etienne,
Guist’hau, L.-L. Klotz, Alexandre Mille-
rand, Joseph Thierry, Henry Chéron,
Paul Bourely, de Monzie, Paul Morel,
Léon Barbier, Henry Bérenger, Bonde-
noot, Goy, Poicrier, Bénazet, Jules Bru-
net, Dalaroche-Vernat, Delpierre, Marc
Fryssinet, Pierre Goujon, Haguenin,
Honnorat, Landry, Charles Leboucq, H.
Mutean, Noël, Henri Paté, Joseph Rei-
nach, Roden, Trouvé.
*
* #
Le Bulletin Officiel du Parti Républicain
Démocratique, parlant de cette réunion dont
MM. Briand, Barthou, Pichon, etc., ont pris
l’mnitiativo, s’exprime ainsi :
« Bien que parmi ces noms se trouvent
ceux d’un grand nombre de nos amis, il est
manifeste que la réunion annoncée pour
vendredi, en vue d’une entente électorale,
est due à l’initiative des républicains du Par
lement, et de toutes nuances. La liste des
signataires est décisive à cet égard.
» L’œuvro n’est donc pas ceile d’un grou
pe politique agissant pour son compte, mais
celle de républicains appartenant à tous les
groupements républicains, et désireux de
voir s'opérer, en vue de la lutte électorale et
sur un programme commun, le rapproche
ment de toutes les forces démocratiques.
» Dans la pensée d’aucun d’eux il ne peut
être question de substituer un organisme
nouveau à ceux existants et de créer un parti
nouveau, mais, bien au contraire, de déve
lopper l’action de ces organismes extra-par
lementaires dont l’autonomie et la liberté
d’action dans le pays doivent être respectés
et garantis, et de les unir pour une action
commune immédiate, essentiellement répu
blicaine et patriotique ».
Les Radicaux-Socialistes
et le Banquet de Saint-Etienne
La fédération radicale de la Seine a tenu
lundi soir, une assemblée plénière, sous la
présidence de M. J.-L. Bonnet.
L’examen de la situation politique aboutit
au vote à l’unanimité de motions de confian-
ce au ministère Doumergue et de protesta
tion « contre les manœuvres tentées par les
partisans de MM. Aristide Briand, L. Barthou
et Millerand, pour ramener au pouvoir ces
personnalités hostiles au programme du par
ti radical et radical socialiste. »
Cette unanimité surprit M. Emile Desvaux,
conseiller municipal de Paris. En effet, dans
la salle, voici MM. Leboucq et Puech, dépu
tés, qui étaient auprès de M. Briand au ban
quet de Saint-Etienne. M. Desvaux demanda
à M. Leboucq de s’expliquer, et l’adjura de
choisir entre la politique du parti radical et
celle de M. Briand.
M. Leboucq répondit aussitôt en expliquant
son attitude sur le projet d’impôt et sur l’im
munité de la rente, dans lesquels il est resté
logique avec ses votes passes. Quant à sa
présence à Saint-Etienne, il ne la renie pas;
c’est au titre d’ami personnel de M. Briand
qu’il s’est rendu à Saint-Etienne. Il considé
rerait comme une lâcheté de regretter au
jourd’hui sa présence. Il estime d’ailleurs
que le discours de M. Briand est une balle
manifestation de politique nationale et d’u
nion républicaine. Il n’entend abdiquer, ni
sa liberté, ni sa dignité personnelles.
M. Puech, ancien ministre du cabinet
Briand, présenta à son tour ses explications.
A son avi n le discours de M. Caillaux et ce
lui de M. Briand se compétent sans s'ex-
dure ; personnellement, il a ea vue tout le
parti republiciin qu'i{ ne veut pas désunir;
d’ailleurs la politique de M. Briand a été
trouvée exceliente par de purs radicaux.
Ou proposa un vote de protestation contre
la présence de MM. Puech et Leboucq au
banquet de Saint-Etienne.
Après une discussion tamultueuse, la mo-
tion suivante fut adoptée :
La Fédération de la Seine, après avoir entendu
les explications des députés Louis Puech et Char
les Leb ucq, invite les élus de la Seine adhérents
au parti a s’abstenir de participer à toute manifes
tation publique organisée par des hommes politi
ques hostiles au programme du parti radical et
radical socialiste.
s
* #
A la suite de cette séance et du vote de la
motion que nous reproduisons plus haut,
M. Leboucq, député, qui avait été mis direc-
tement en cause, a fait les déclarations sui
vantes :
La Fédération radicale socialiste m’a demandé
des explications sur ma présence à Saint Etienne.
On aurait voulu me voir exprimer des regrets.
Quelle idée a-t-on donc de l’indépendance d’un
élu et de l’esercice de son droit parlementaire? Je
ne me vois pas bien, le lendemain du jour où je
me suis assis à la tabie d’un ami, m’excusant
d’avoir accepté son invitation. C’eût été, je l’ai
dit, une lâchelé indigne de la Fédération et de
moi-même. Il faut avoir le courage de ses actes.
J’ai entendu, à Saint-Étienne, un discours de
haute éloquence et ce superbe tenue politique.
Ai-je en cela été infidèle au parti radical ? Le par
ti a sa doctrine, je l’accepte intégralement ; mais
à une condition, c’est qu’on ne la travestisse pas
pour en faire un instrument de cissociation
nationale. Briand n’a pas dit autre chose.
Ceux qui lui reprochent do faire de ta désunion
n’ont non compris à son discours. C’est aux prè-
cheurs de haine, aux tyranneaux d’arrondissement,
à ceux qui ne connaissent, pour appliquer les lois,
que le procédé de la trique, qu’il a adressé les
plus justifiés reproches Ceux ta font la désunion;
et c’est contre leur action dissolvante, irritante
et.ré arbative, que toute l’action de Briand est
dirigée. Acte de foi nationale, appel à la concor
de, ardent désir de réformes sociales ; tels sont
les trois termes d’un discours qui — si on le dé
gage des questions de personnes auxquelles il ne
nous appartient pas do nous mêer — apparaît
comme un superbe morceau denseignement po
sitif.
Nouvelles du Sénat
L’Impôt sur le revenu
M. Aimond, rapporteur de la Commission
sénatoriale de l’impôt sur le revenu, a fait
distribuer les premières épreuves de son
rapport. Ce document forme un ensemble
compact de 370 pages.
M. Aimond retrace d’abord l’historique de
la réforme qui est proposée à l’heure ac-
tuelle au Sénat. Il rappelle que tour à tour
MM. Ribot, Cochery, Doumar, Peytral, Cail
laux, Bouvier, de nouveau M. Caillaux dépo
sèrent comme ministres des finances des pro-
jets d’impôt sur le revenu. Il expose le pro
jet voté par la Chambre, documents à l’ap
pui, il rappelle toutes les réserves qui furent
laites alors sur l’ensemble du projet, L’œu
vre de la Chambre ne fut accueillie au Sénat
qu’a titre d’indication, avec l’espoir, selon
l’expression de M. Th. Reinach, que la haute
Assemblée la reprendrait en sous-œuvre. On
formait le vœu que le Sénat procédât par
étapes et qu’il détachât d’un projet touffu
trois ou quatre chapitres qui, tout en faisant
équilibre au point de vue du rendement, ré-
formeraient quelques abus.
C’est dans ces conditions et dans cet esprit
que la Commission sénatoriale s’est mise à
l’ouvrage.
M. Aimond résume ainsi le programme de
la Commission :
1° Recherche des conséquences financiè
res du projet voté par la Chambre ;
2o Etendue de ia réforme a accomplir ;
3® Bases et assiette de l’impôt général sur
le revenu.
M. Aimond examine comment surces trois
points la Commission s’est mise d’accord.
Sur ce premier point — recherche dos con
séquences financières du projet — le rappor
teur constate que l’équilibre de la réforme
à la suite des votes de la Chambre est pro-
fondément troublé, que le déficit visible dès
aujourd’hui dépasse 74 millions et qu’un a -
tre déficit, inv/sible actuellement, vienri
s’ajouter au premier du fait de la fuite des
coupons internationaux, du développement
extraordinaire que prendront les cotes irré-
couvrables et des frais considérables qu’exi
geront l’assiette et le recouvrement des nou
veaux impôts.
Sur le second point — étendue de la ré
forme à accompir — le rapporteur écrit que
la Chambre elle-même a manifesté son opi
nion, lorsque, en votant les amendements
Renard et Malvy, elle a retenu dans le cadre
actuel de la réforme l’étude de :
1» Un impôt général sur le revenu en rem
placement de la personnelle-mobilière et des
portes et fenêtres supprimées ;
2o La révision des impôts cédulaires fon
cier bâti, foncier non bâti, valeurs mobi-
Hères.
Il y aura lieu de poursuivre dans aneautre
étape la réforme des patentes et d’étudier la
création de nouvelles cédules pour les reve
nus qui ne sont pas encore à l’heure actuelle
directement frappés.
Sur le troisième point — base et assiette
de l’impôt — les principes sur lesquels la
Commission a édifié son œuvre sont ainsi
définis :
lo Base aussi large que possible, le nom
bre des assujettis ne devant être limité que
par un minimum d’existence non imposable.
Ce minimum non imposable, la Commission
l’a fixé :
A 3,000 francs dans les communes
2,000 habitants et au-dessous ;
communes
A 1,230 francs dans les
2,001 à 3,000 habitants ;
A 1,500 francs dans les
communes
3,001 à 40,000 habitants;
A 1,750 francs dans les communes
de
de
de
de
10,000 habitants et au-dessus ;
A 2,000 francs à Paris.
En outre, la Commission a prévu l’appli-
cation, par personne à la charge de chaque
contribuable, enfant de moins de 16 ans et
ascendants sans ressources, d’une réduction
variant de 100 francs dans les petites com
munes à 200 francs à Paris ;
2° Dégression de l’impôt. La Commission
a adopté le principe qui consiste à diminuer
l'impôt à mesure que diminue l© revenu ;
3° Déclaration facultative combinée avec
une évaluation administrative et l’emploi
d’un certain nombre de signes extérieurs.
A ce propos le rapporteur rappelle que la
Chambre, a la suite de M. Caillaux, s’était
prononcée pour la déclaration obligatoire.
La Commission a considéré que les mesures
de contrôle proposées étaient insuffisantes, et
une, de ce fait, un tiers de U matière impo
sable échapperait à l'impôt. D'autre part, la
déclaration obligatoire, dit M. Aimond, au
rait pour effet certain de faire retomber la
plus grande partie du poids de l'impôt sur
les revenus qu’on ne peut pas dissimuler,
revenus industriels et commerciaux, traite"
ments des fonctiondaires, revenus mobiliers
des mineurs, etc.
La déclaration facultative des revenus
évalués par l’administration d’après les si
gnes extérieurs, serait au contraire, un
moyen suffisamment efficace pour assurer le
rendement de l'impôt.
Le rapporteur conclut :
Le système que nous soumettons au Sénat
tient compte de tous les tempéraments uti
les, des traditions, des habitudes, voire mê-
me des préjuges de nos concitoyens.
Nous avons mis à la bise de notre impôt
général cinq millions de contribuables, c'est-à-
dire tous ceux qui n’en sont pas réduits au
strict minimum de l’existence. C'est là la
pierre angulaire de l'œuvre.
A la place de la personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres, nous proposons un
impôt général sur le revenu qui s’adapte
mieux à nos mœurs et à nos institutions
que les systèmes d'importation étrangère
dont certains se font les protagonistes.
A la place de l’impôt foncier, nous éta
blissons un impôt fondé d’après la dernière
révision sur les bases de la valeur locative
réelle diminuée de 20 0/0 ; l’agriculture voit
ses charges diminuées de façon considéra
ble.
Aux 30 ou 40 milliards de fonds étrangers
qui bénéficient de notre crédit après avoir
acquitté un simple droit de douane, nous
demandons de prendre une part du fardeau
général.
Malgré un très large dégrèvement agri
cole, et en nous en tenant au taux modéré
de 4 0/0, l’ensemble de la réforme laisse en
core un boni de plus de 200 millions pour le
budget.
--------—-----
M. Doumergue à la Commission
Nous avons donné hier une analyse des
déclarations de M. Doumergue, président du
Conseil, devant la Commission des affaires
étrangères. Il y a lieu de compléter cette
première information par un nouveau dé
veloppement.
Au sujet de l’influence morale de la Fran
ce en Syrie, M. Doumergue a tenu à faire la
déclaration suivante :
Notre tâche, pour aider à la mise en valeur de
cette partie de l’Empire ottoman, sera singulière
ment facilitée par les assurances données, en dé
cembre 1912, à l’ambassadeur de la Républigue à
Londres, par le gouvernement britannique : qu’il
n’avait en ces régions ni intention d’agir, ni des
seins, ni aspirations politiques.
Je crois inutile de vous assurer que, souciera,
comme tous mes
rien
me tous mes prédécesseurs, do ne laissex
perdre du patrimoine moral de la France, je
prêterai mon concours à toutes les œuvres qui
travaillent à la diffusion de notre langue, au déve
loppement de notre influence et qui font aimer el
respecter le génie généreux de la France et que je
soutiendrai tous ceux qui peuvent se dire, sous
quelque habit qu’ils se présentent, les ouvriers de
l œuvre française.
Les intérêts financiers français en Turquie
Voici, sur ce sujet, les déclarations de
M. Doumergue :
L’épargne française a, de tout temps joué un rô
le important en Turquie, où déjà au moyen âge
les banquiers de Provence et de Languedoc ex
portaient et plaçaient l’or français. A l’heure ac
tuelle les capitaux français engagés en Turquie,
presque entièrement investis dans les emprunts
du gouvernement ottoman, s’élèvent en gros au
chiffre de trois milliards de francs
Les conséquences financières de la guerre bal
kanique, le détachement deFempiro ottoman des
provinces sinon riches, du moins suffisamment
prospères pour contribuer au service de la dette
de l’Etat, ne pouvaient laisser indifférent le gou
vernement de la Républque.
Dès que les résultats des premières batailles ont
fait paraître inévitable un démembrement de la
Turquie d’Europe, c’est de Paris que sont parties
ses initiatives tendant à protéger les intérêts
financiers et économiques européens engagés en
Turquie ; c’est une Commission interministérielle
française qui a étudié les mesures à prendre en
faveur des créanciers de la Turquie, et c’est elle
qui a préparé les travaux de la Commission inter
nationale réunie à Paris en juin dernier pour indi
quer les solutions à donner a toutes les questions
financières et économiques posées par la guerre.
La première session de cette Commission a été
interrompue par la guerre entre la Bulgarie et ses
anciens alliés. Le travail de mise au point, d‘é-
claircissement fait dans cette session ne sera pas
perdu, et je saisirai une occasion, prochaine je
l’espère, d’inviter à revenir à Paris les commis
saires des puissances pour les convier, aujour
d’hui que la paix est signée entre tous les belligé
rants, à terminer leur tâche, si nécessaire au re
lèvement financier de la Turquie et de ses adver
saires et à la garantie de leurs prêteurs.
Le ministre des affaires étrangères fait connaître
que notre diplomatie a fait tous ses efforts — sui
vis de succès auprès de la Serbie — pour que les
Etals balkaniques participent à la dette extérieure
de la Turquie, e participation devant être réduite
d’ailleurs, au chiffre strictement nécessaire à la
sauvegarde de tous les porteurs de titres otto
mans. »
Le ministre a de « sérieuses raisons de croire »
que ta Grèce notamment ne refusera pas son
adhésion à ce principe.
L’accord franco-turc
LES AVANTAGES RÉSERVÉS A LA FRANCE
De même, déclare le ministre, que nous nous
sommes efforcés de préserver les intérêts maté
riels franç is vis-à-vis des vainqueurs de la guerre
balkanique, de même vis-a-vis delà Turquie, en
échange des ressources douanières et fiscales que
le consentement du gouvernement de la Républi
que pourrait permettre à la Porte de trouver pour
faire face à ses charges financières, nous avons
cherché à obtenir et avons obtenu pour le com
merce et pour l’industrie français des avantages
concrets »
Ces avantages consistent, en faveur de nos na
tionaux, dans la promesse d’améliorations du ré
gime douanier ottoman et du régime des analyses
et dans celle d’une étude en commun des mesures
propres à assurer la garantie de la propriété in
dustrielle.
Je crois pouvoir vous donner l’assurance que
l’industrie française obtiendra de son côté d’im
portantes commandes, dont bénéficiera le travail
national.
D’autre part, nos compatriotes oât obtenu la
promesse d’un important réseau de chemins de
fer à construire, tant en Anatolie du Nord qu’en
Arménie et en Syrie. La longueur de ce réseau se
rait supérieur à 2 403 kilomètres. A ces conces
sions s’ajouteraient la construction et l’exploita
tion des ports de Jaffa, de Caïffa et de Tripoli en
Syrie, et de ceux d’Héraclée et dIneboli sur la
mer Noire.
Vis-à-vis des États de la péninsule balkanique,
qui ont pu trouver auprès de notre épargne un
concours nécessaire au cours de cette crise, notre
diplomatie a suivi sa ligne de conduite habituelle
et a insisté auprès d’eux pour obtenir des avanta
ges en faveur de notre commerce et de notre in
dustrie. Je poursuis des négociations dans ce sens
en Serbie et je ne doute pas que d’importantes
commandes ne soient passées pr le gouverne-
ment serbe aux industriels français dont Certains
oui déjs obtenu des promesses.
En Grèce, une grande partie des commandes
faites au cours de la guerre ont été exéoulées en
France. Je tiendrai la main à ce que ce marché resté
ouvert à notre industrie. L’action de notre légs-
ton a cet égard sera appuyée par l’influence qu’a
prise notre mission militaire, dont le contrat a été
récemment renouvelé avc une extension des
pouvoirs conférés à nos officiers.
L’Etat Albanais
La question qui offre le plus d'urgence est eelte
du nouv.1 État qui va sortir des délibérations des
rep esentanis des puissances à Londres et dont
la création a été la conséquence de la volonté dès
grandes puissances de maintenir entre elles la
paix et l équilibre.
Les puissances sont toutes tombée? d'accord
pour offrir la couronne d’Albanie au prince de
wied, apparenté à la famille royale de Roumanie.
La France s’est associée, d'autant plus volontiers
a cette désignation qu’elle y trouve une occasion
de reconnaître le rôle utile joué par la nation rou-
maine comme facteur de l’equilbre e mro les ! eu-
pies ba kaniques, et son action pacificatrice dans
le dernier conflit.
Ce rôle politique de la Roumanie a rencontré
1 approbation de l’opinion publique fra-ciise et je
suis heureux de signaler que nos relations tou
jours bonnes avec ce pays en ont été amsliorées.
De part et d’autre a été marifesté un sincère désir
de relations plus frequentes, et des appels ré-
cents faits à notre industrie pour la préparation
d’importantes commandes peuvent Dous faire es-
pérer des résultats intéressants.
Après avoir signalé l’état des (rivaux de
délimitation de l'Albanie, le ministre traite
de
La Question Arménienne
La question des réformes a faire en Arménie
afin de parer à l’état misérable et anarchique de
cette province turque n’a cessé vous le savez, de
préoccuper les grandes puissances. Au cours de
l’été dernier, un projet de réformes avait été pré
senté par le gouvernement ru se et soutenu par
la France et l’Angleterre. Ce projet fut soumis à
une commission formée par les ambassadeurs des
puissances à Constantinople.
Le 29 octobre, le gouvernement ottoman, per
suadé qu’‘i échapperait a la pression des puissan-
ces en devançant leurs propositions, non mait
deux inspecteurs généraux ottomans pour les six
provinces arméniennes. La Russie, avec l’appui de
la France et de l’Angleterre et l’assentimer | ces
autres Puissances,' poursuit les démarches com-
mencées pour faire donner à l Arménie un statut
assurant la sûreté des personnes et des biens.
Fidèle aux principes d'humanité qui ontlouj ours
guide la politique française à l'égard des p pula-
bons victimes d’abus en Orient, je second roi les
a ss
efforts de notre alliée pour arriver à l’établisse-
ment de l’ordre et au respect des droits de tous
dans les provinces armeniennes.
NOS COLONIES
TUNISIE
l.e Commerce extérieur de la régence
La statistique générale de la Tunisie, an
nexée au rapport de 1912, vient d'être publiée
par les soins du ministère des affaires étran-
gères Elle permet d'apprécier notamment
les progrès rapides accomplis en vingt
ans par le commerce extérieur de la ré
gence.
Ce commerce, exportations et importations
comprises, n'ateignait en 4893 que 68,068,555
francs. Dix ans plus tard, en 1903, il avait
déjà plus que doublé, atteignant 233,011.520
francs. Depuis cette année, à part un fléchis
sement de 11 millions en 1905, l’essor ne
s’est pas ralenti. Le mouvement commer
cial a encore doublé et se chiffre en 1912
par 310,919,188 francs.
Détail digne de remarqué : les échanges
de li Tunisie-avec la France ont suivi la mê-
me marche ascendante. De 88 millions en
1903 ils ont passé à 148 millions en 1912.
C'est dire que la France occupe dans le com-
marce de la Tunisie une place sans donte
moins considérable que dans le commerce
algérien, égale pourtant à la moitié du
commerce total de la régence. L’Italie, qui
vient au second rang, se contente du mo-
deste chiffre de 33 millions ; l’Angleterre
suit avec 28 millions. L'Algérie est au qua
trième rang avec 7,700,000 francs aux expor-
talions et 17,800,000 francs aux importations,
soit un total d’environ 25 millions.
ANGLETERRE
Médecins et Clergymen balayent les rues
Une scène extraordinaire s’est déroulée la
nuit de lundi à mardi dans les rues de
Leeds, ville où, ainsi que nous l’avons déjà
relaté, les employés de la municipalité sont
eu grève depuis près de quinze jours. La plu-
part des services ont été cependant rétablis,
grâce au concours d’une association dite
Ligue des Citoyens, composée de gens de
bonne volonté qui font le travail des grévis
tes. Seuls les balayeurs des rues n’avaient
pu être remplacés et les immondices com
mençaient à s’accumuler de façon inquié
tante.
Prenant leur courage à deux mains, une
soixantaine de membres de la Ligue des Ci
toyens prit rendez-vous pour lundi soir,
minuit, dans une salle appelée, de façon ap
propriée, salle des Philosophes. A ‘heure
dite, les volontaires arrivèrent au lieu du
rendez-vous, beaucoup d’entre eux dans
leur propre automobile, conduite par leur
chaufeur. Il y avait parmi eux des avocats,
des médecins, plusieurs clergymen et un
architecte des plus connus, qui portait en
bandoulière un revolver de fort calibre.
Escortés par des policemen à cheval, les
soixante se rendirent au dépôt central, où
on leur distribua pelles et balais, puis ils
commencèrent leur travail, ne l’interrom
pant que quelques minutes pour repousser,
à l’aide des policemen montés, une charge
des grévistes. Un second détachement de
ligueurs passa avec des tombereaux dans les
principaux hôtels pour y récolter les pou-
belles qui s’y accumulaient. Réconfortés par
des rafraîchissements variés que transportait
l’automobile do l’un d’eux, les travailleurs
volontaires continuèrent leur tâche jusqu’à
la pointe du jour.
HOLLANDE
Un déraillement
Une catastrophe de chemins de fer s’est
produite dans la province de Groninguen, a
Beilen. . ,
L’express de Groninguen à Amsterdam a
déraillé pour des causes qui ne sont pas en-
core ét.blies.
D’après les dernières nouvelles n y a sept
personnes tueeset plusieurs sont grièvement
blessées.
Le fils du ministre de l’Intérieur de Hol-
lande, M. Cort Van der Linden, se trouve au
nombre des victimes. Il a été tué dans la
compartiment de Are classe qu’il occupait.
Il reste quelques cadavres qui n’ont pu sis
I core être identifiés.
Administraleur -Délégué- Gérant
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Adninistration
à M. 0. RANDOLET
35, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havre
Administration, Impressions et Annonces, TEL. 10.47
(6 Pages) 5 Cenumes— 1011 ION DU MATIN — B Centimes (c Pages) Vendredi 96 Boons.., Hi?
as2q4278725-2427-8.2272A2AS)E2E94S:C22TNGNC/N:sE1FRCRT*Z2s*tA@SSSRcLSNz*RERNYRRE=R#RYRRRRTzzWacai=NNSm======" C V -V UrUOMfC 1.10
" '——~—*———----------===%===%%=2*= 2=nas=sarnaszsnsaaser se
RDACTION
Adresser tout ce qui concerne la Rédaction
35, Rue Fontenelle, 35
TLLPHONE 8 N 3.G0
pR
AU HAVRE.
A PARIS
ANN ON CES
Bureau du Journal, 112, bould de Strasbourg.
( L'AGENOE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
’ seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
ORGANE REPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
ABONNEMENTS
Trois Mois
Six Mois
UN AN
18 PETIT HAVRE est désigné pour les Annonces Judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
Le Havre, la Seine-Inférieure, l’Eure,
l’Ois® et la Somme ’
Autres Départements
Union Postale
G Fr.
10 »
• Fr.
« so
16 Fr.
2090 " f$P — 2 A •
On s’abonna également, SANS FRAIS, dans tous les Bureaux da Poste
— »
0 »
da France
Paris, trois heures matin
======= —= . . - == — = ==========
LES AFFAIRES DU MAROC
Vapeur attaqué par les Marocains
GIBRALTAR. — Des Marocains
zontre le vapeur britannique
Londres, échoué sur le littoral
face de Tarifa. Un homme de
été tué. Les autres, ainsi que
ont fait feu
Ludgate, de
africain, en
l’équipage a
la cargaison
qui a une grande valeur, courent de grands
dangers.
Il a fallu suspendre les tentatives de ren-
flouement en présence de l'hostilité des Ma
rocains.
Un vapeur de sauvetage est parti avec
deux mitrailleuses et an détachement naval.
Le croiseur anglais Roxbargh et le croiseur
espagnol Pelayo se rendent sur les lieux.
UNE MESURE DE CLÉMENCE DEMANDÉE
M. Charles Humbert a écrit au ministre de
la guerre une lettre dans laquelle is séna
teur de la Meuse lui demande de proposer
au gouvernement la grâce entière de tous
les militaires condamnés . punis à la suite
des manifestations occasionnées par l’annon-
co du maintien sous les drapeaux de la
classe 1910.
UN DRAME PASSIONNEL
TROYES. — On signale qu’au pont Sainte-
Marie, un nommé Vialet, âgé de 30 ans, ma-
ouvrier, a, par jalousie, tué sa femme d’un
coup de fusil.
La victime, qui était âgée de 28 ans, laisse
rois enfants en bas âge.
VOYAGE AÉRIEN
BERNE. — L’aviateur suisse Rider qui se
trouvait à Paris avec la commission suisse
de l'aviation militaire, a quitté hier matin, à
0 heures l'aérodrome de Bac, sur monoplan
?t a atterri à Berne dans l’après-midi, à
7 h. 13.
L’aviateur s’est maintenu presque cons
tamment à une altitude de deux mille mè-
très, afin de se tenir au-dessus du brouillard.
Il passa le Jura sans le voir. Il dut s’orienter
sur les sommets des Alpes bernoises, la
Jungfrau, I E ger et le Monch qu’il aperçut
9 ne heure et demie avant d’arriver à Berne.
. - • - 5 '
UN NOUVEL HYDRAVION ITALIEN
ROME. — Ou expérimentera prochaine
ment au camp d’aviation de Mirafiori un hy-
dravion dont la stabilité serait assurée de fa
çon absolue et dont la vitesse dépasserait
deux cents kilomètres à l'heure.
L’EXPLOSION DE TORRE ANNUNZIATA
Naples, — On a fini de déblayer les dé-
sombres de l’établissement de Torre-Annun-
ziata.
Les morts seraient au nombre de quatorze.
Il y a cinq blessés dont l’état est aussi satis-
faisant que possible.
OFFICIERS FUSILLÉS EN CHINE
. MARSEILLE. — Le courrier de Chine, arrivé
par le Transsibérien, apporte les nouvelles
suivantes :
Pékin, 2 décr nbre. — Par ordre du prési
dent Yuan-Shi-Kaï, le commandant Kono et
dix officiers, dont les troupes se sont muti
nées à Kiang-Yun et à Tchang-Seng, ont été
fusillés.
Environ deux cents soldats seront égale
ment passés par les armes.
LA CRISE MINISTÉRIELLE
EH BULGARIE
Sofia. — Dans les milieux renseignés le
bruit court qu’à la suite de sa mise en accu
sation et pour éviter la chute du Cabinet en-
ier,M. Ghenadieft, ministre des affaires étran
gères, aurait décidé de démissionner.
Sa retraite serait imminente et M. Radosla-
voff, président du Conseil, prendrait le por
tefeuille des affaires étrangères.
LA PESTE ER SIBÉRIE
KITARBIE, 2 décembre. — La peste et le
choléra ont fait leur apparition ; les deux
fléaux ravagent le pays.
DERNIÉRE HEURE SPORTIVE
Football Association
Football Club Rouennais (mixte) bat Union
Sportive Suisse (mixte) par 3 buts à 1.
LES AFFAIRES D'ORIENT
La Turquie et les Réformes
Berlin, 23 décembre.
Selon une dépêche de Constantinople à la
Gazette de Francfort, le grand-vizir recevra
aujourd’hui les ambassadeurs d’Allemagne
et de Russie. Le grand-vizir leur déclarera
solennellement l’intention ferme de la Porte
d’entreprendre des réformes dans les pro
vinces arméniennes avec la collaboration des
grandes puissances. Le grand-vizir exposera
ensuite le programme des réformes qui dif-
1ère sur quelques points de celui qui fut
convenu, il y a quelques mois, par le Conseil
des ambassadeurs réuni à Constantinople.
La Délimitation Serbo-Grecque
Salonique, 85 décembre.
La Commission gréco-serbe,chargée de dé
limiter la nouvelle frontière, a terminé ses
travaux.
Elle a laissé aux deux gouvernements le
soin de résoudre deux points sur lesquels
l’accord n’a pu s’établir.
LES
M. de Freycinet vient de publier le se
cond volume de ses Souvenirs, sur la pé
riode qui s’étend de 1878 à 1893. Gambetta
disait de son ancien collaborateur de Tours :
« Comme intelligence, c’est un filtre ». La
formule apparaît merveilleuse d'exactitude
au lecteur de ces 500 pages, si vite finies et
d’une si séduisante limpidité.
Si l’on veut connaître et surtout com
prendre la période confuse de notre histoire
politique qui va du 16 mai à la chute de
Ferry, il ne faut pas chercher d’autre guide
que M. de Freycinet. Sans avoir l’air d’y
toucher, sans artifice apparent, par la seule
vertu d’une étonnante lucidité, cet incom
parable écrivain sème partout de la clarté.
Avant de l’avoir lu je n’avais pas vraiment
compris la géographie morale de ces pre
miers parlements du régime, qui furent le
creuset de nos partis actuels.
Les républicains, qui s’étaient unis pour
combattre la tentative réactionnaire de Mac-
Mahon se séparèrent quand ils furent vain
queurs. On discerna de suite, dans la majo
rité,quatre groupes répondant à quatre tem
péraments. Il y avait d'abord, formant l’aile
droite, les fameux Centre-Gauche, républi
cains sincères, mais d’esprit conservateur,
vrais continuateurs de l’Orléanisme bour
geois ; c’étaient les seuls républicains avec
lesquels Mac-Mahon consentit à causer :
quand le maréchal eut démissionné, ces
grands doctrinaires de cabinet,qui n’avaient
pas de force électorale, furent presque im
médiatement jetés par-dessus bord.
Venaient ensuite les membres de la Gau
che républicaine, dont Jules Ferry symboli
sait la personnalité: ce furent de suite et
essentiellement des modérés gouvernemen
taux, largement ouverts à la politique des
réformes, mais avant tout gouvernemen
taux. Ils ne se distinguaient que par cette
nuance — importante il est vrai — du
groupe de Gambetta, Y Union républicaine:
les amis du grand tribun faisaient d’abord
figure de démocrates, mais c’étaient des
démocrates de gouvernement, se rendant
compte que la responsabilité du pouvoir
comporte le sens de l’opportunité, de l'équi-
libre et de la sagesse. C'est justement parce
qu’il était gouvernemental que Gambetta
vit, très vite, se former sur sa gauche une
sorte d’escadron de cavalerie légère, tou
jours prêt à le harceler, le groupe des intran
sigeants : démocrates, parfois démagogues,
qui ne tenaient plus, eux, aucun compte
des nécessités éternelles d’un gouverne
ment.
Tant que Gambetta vécut, il y eut riva
lité non dissimulée entre ses amis et ceux
de Ferry. Les amis de Gambetta soute
naient sans doute Ferry au pouvoir, mais
sans chaleur et sans qu’il pût vraiment
compter sur eux. Lorsqu’à son tour Gam
betta fut ministre — pendant six semaines
— la plupart des ferrystes se réservèrent,
bien que leur chef se fût toujours montré
très correct envers le grand tribun. C’est
seulement après la mort de Gambetta que
Ferry réussit à unifier les deux équipes en
un grand parti de gouvernement, qui fut la
base de sa majorité pendant son grand mi.
nistère (1883-1883) et qui reste dans l'llis-
toire sous le nom de parti opportuniste.
Telle est l'origine des républicains de
gouvernement. C’est eux qui, contre les
violents stériles de l'Extrême-Gauche, con
tre les timorés du Centre-Gauche et les
irréconciliables de la Droite, ont conçu et
réalisé les réformes qui font vraiment l’ar
mature du régime.
- A distance, après un quart de siècle
écoulé, l’unité de l’œuvre apparaît brillante
et solide. Mais ne cherchons pas à nous
dissimuler qu’elle fut accomplie au milieu
de rivalités personnelles violentes et de
luttes intestines presque continuelles. A
cet égard, le récit de M. de Freycinet nous
révèle des dessous bien intéressants. Je re
grette cependant, en curieux incorrigible,
qu'il laisse non résolus deux ou trois pro
blèmes historiques qu’il serait pourtant
bien utile de tirer au clair.
M. de Freycinet me semble, tout d’abord,
faire la lumière complète sur ce qu’on a ap-
pelé, à l’époque, « le gouvernement occulte»
de Gambetta. Ce gouvernement occulte a
certainement été une réalité. Il y avait des
ministres, des présidents du Conseil, mais
tout se faisait dans le cabinet de Gambetta.
Quand un homme politique constituait un
ministère, il ne pouvait réussir qu’en se
tenant en communication constante avec
celui qui était le grand chef de la majorité.
« Prenez un tel. je ne veux pas de tel au
tre », disait Gambetta : et il fallait tenir
compte de ces indications ou de ces « ex
clusives », sous peine de manquer la com
binaison ou d’en faire une combinaison
mort-née. C’est ainsi que le général Farre
fut ministre de la guerre ; c’est encore
ainsi que Waddington, lors du premier
ministère Freycinet, ne rentra pas au quai
d’Orsay. Dans l’exercice du gouvernement,
c’était la même dépendance des détenteurs
apparents du pouvoir. Pour avoir voulu, en
1880, faire sa propre politique, M. de Frey
cinet tomba, en pleines vacances parlemen
taires et sans même avoir été mis en mino
rité par la Chambre : comme dans les tra
gédies de palais, il avait suffi de l’opposi
tion même silencieuse de Gambetta pour
le tuer.
. Pourquoi Gambetta n’était-il donc pas
premier ministre, au lieu de créer la plus
fausse des situations en gouvernant du
haut de son fauteuil de président de la
Chambre? M. de Freycinet montre très
bien que Grévy, qui n’aimait pas Gambetta,
ne lui offrit jamais le pouvoir avant l’épo
que du « grand ministère ». L’Elysée était
jaloux du Palais-Bourbon. Mais notre si
limpide historien ne nous dit pas si Gam
betta désira vraiment être premier ministre
et s’il fit ce qu’il fallait pour le devenir.
Les adversaires du « dictateur » ne man
quent pas de dire, aujourd’hui encore, qu’il
n’avait aucune envie de prendre la respon
sabilité de la présidence du Conseil ; ils le
montrent au contraire désireux d’exercer
en sous main la réalité du pouvoir, comme
chef de la majorité, par l’intermédiaire de
ministres qu’il inspirait. Les Gambettistes
protestent contre une pareille accusation.
Mais j’avoue rester hésitant entre les deux
affirmations contraires : Grévy, sans doute,
n’offrit le ministère à son rival qu’à la
dernière extrémité ; mais quelle hâte sin
gulière avait mis ce dernier, lors de la no
mination de Grévy, à se faire élire au fau
teuil de la Chambre ! Peut-être est-il encore
trop tôt pour être renseigné sur ce point
d’histoire. Evidemment, si M. do Freycinet
ne fait pas à ce sujet la lumière, c’est qu’il
ne le désire pas.
L’impression que laisse la vue de ces
coulisses d’une époque déjà presque histo
rique est en somme à la fois attristante et
consolante. Il est attristant de voir ces
grands hommes, qui firent une si belle
œuvre, se jalouser et s’user mutuellement
en des rivalités qu’on pourrait appeler ri
valités de couloirs. Il est consolant de pen
ser qu’aucune période — même la nôtre —
n’a le monopole de ces petitesses, et que
les meilleurs hommes d’Etat ont dû tra
vailler dans les rudes et médiocres condi
tions du terroir humain.
André Siegfried.
Une Convocation d’Homme politiques
La convocation suivante a été adressée à
un certain nombre de sénateurs et députés :
Paris, 22 décembre 1913.
a Nous avons l’honneur dé vois prier de
vouloir bien vous trouver vendredi soir 26
décembre, à huit heures et demie, rue d’Ea-
ghien, 16, dans le but de nous entretenir,
entre républicains, de la situation politique,
st d’envisager une organisation à établir en
vue des prochaines élections législatives. »
Aristide Briand, Louis Barthou, Jean
Dupuy, Stéphen Pichon, Pierre Bau
din, Lourties, Jean Morel, Ratier, Vi-
gier, Charles Dumont, Eugène Etienne,
Guist’hau, L.-L. Klotz, Alexandre Mille-
rand, Joseph Thierry, Henry Chéron,
Paul Bourely, de Monzie, Paul Morel,
Léon Barbier, Henry Bérenger, Bonde-
noot, Goy, Poicrier, Bénazet, Jules Bru-
net, Dalaroche-Vernat, Delpierre, Marc
Fryssinet, Pierre Goujon, Haguenin,
Honnorat, Landry, Charles Leboucq, H.
Mutean, Noël, Henri Paté, Joseph Rei-
nach, Roden, Trouvé.
*
* #
Le Bulletin Officiel du Parti Républicain
Démocratique, parlant de cette réunion dont
MM. Briand, Barthou, Pichon, etc., ont pris
l’mnitiativo, s’exprime ainsi :
« Bien que parmi ces noms se trouvent
ceux d’un grand nombre de nos amis, il est
manifeste que la réunion annoncée pour
vendredi, en vue d’une entente électorale,
est due à l’initiative des républicains du Par
lement, et de toutes nuances. La liste des
signataires est décisive à cet égard.
» L’œuvro n’est donc pas ceile d’un grou
pe politique agissant pour son compte, mais
celle de républicains appartenant à tous les
groupements républicains, et désireux de
voir s'opérer, en vue de la lutte électorale et
sur un programme commun, le rapproche
ment de toutes les forces démocratiques.
» Dans la pensée d’aucun d’eux il ne peut
être question de substituer un organisme
nouveau à ceux existants et de créer un parti
nouveau, mais, bien au contraire, de déve
lopper l’action de ces organismes extra-par
lementaires dont l’autonomie et la liberté
d’action dans le pays doivent être respectés
et garantis, et de les unir pour une action
commune immédiate, essentiellement répu
blicaine et patriotique ».
Les Radicaux-Socialistes
et le Banquet de Saint-Etienne
La fédération radicale de la Seine a tenu
lundi soir, une assemblée plénière, sous la
présidence de M. J.-L. Bonnet.
L’examen de la situation politique aboutit
au vote à l’unanimité de motions de confian-
ce au ministère Doumergue et de protesta
tion « contre les manœuvres tentées par les
partisans de MM. Aristide Briand, L. Barthou
et Millerand, pour ramener au pouvoir ces
personnalités hostiles au programme du par
ti radical et radical socialiste. »
Cette unanimité surprit M. Emile Desvaux,
conseiller municipal de Paris. En effet, dans
la salle, voici MM. Leboucq et Puech, dépu
tés, qui étaient auprès de M. Briand au ban
quet de Saint-Etienne. M. Desvaux demanda
à M. Leboucq de s’expliquer, et l’adjura de
choisir entre la politique du parti radical et
celle de M. Briand.
M. Leboucq répondit aussitôt en expliquant
son attitude sur le projet d’impôt et sur l’im
munité de la rente, dans lesquels il est resté
logique avec ses votes passes. Quant à sa
présence à Saint-Etienne, il ne la renie pas;
c’est au titre d’ami personnel de M. Briand
qu’il s’est rendu à Saint-Etienne. Il considé
rerait comme une lâcheté de regretter au
jourd’hui sa présence. Il estime d’ailleurs
que le discours de M. Briand est une balle
manifestation de politique nationale et d’u
nion républicaine. Il n’entend abdiquer, ni
sa liberté, ni sa dignité personnelles.
M. Puech, ancien ministre du cabinet
Briand, présenta à son tour ses explications.
A son avi n le discours de M. Caillaux et ce
lui de M. Briand se compétent sans s'ex-
dure ; personnellement, il a ea vue tout le
parti republiciin qu'i{ ne veut pas désunir;
d’ailleurs la politique de M. Briand a été
trouvée exceliente par de purs radicaux.
Ou proposa un vote de protestation contre
la présence de MM. Puech et Leboucq au
banquet de Saint-Etienne.
Après une discussion tamultueuse, la mo-
tion suivante fut adoptée :
La Fédération de la Seine, après avoir entendu
les explications des députés Louis Puech et Char
les Leb ucq, invite les élus de la Seine adhérents
au parti a s’abstenir de participer à toute manifes
tation publique organisée par des hommes politi
ques hostiles au programme du parti radical et
radical socialiste.
s
* #
A la suite de cette séance et du vote de la
motion que nous reproduisons plus haut,
M. Leboucq, député, qui avait été mis direc-
tement en cause, a fait les déclarations sui
vantes :
La Fédération radicale socialiste m’a demandé
des explications sur ma présence à Saint Etienne.
On aurait voulu me voir exprimer des regrets.
Quelle idée a-t-on donc de l’indépendance d’un
élu et de l’esercice de son droit parlementaire? Je
ne me vois pas bien, le lendemain du jour où je
me suis assis à la tabie d’un ami, m’excusant
d’avoir accepté son invitation. C’eût été, je l’ai
dit, une lâchelé indigne de la Fédération et de
moi-même. Il faut avoir le courage de ses actes.
J’ai entendu, à Saint-Étienne, un discours de
haute éloquence et ce superbe tenue politique.
Ai-je en cela été infidèle au parti radical ? Le par
ti a sa doctrine, je l’accepte intégralement ; mais
à une condition, c’est qu’on ne la travestisse pas
pour en faire un instrument de cissociation
nationale. Briand n’a pas dit autre chose.
Ceux qui lui reprochent do faire de ta désunion
n’ont non compris à son discours. C’est aux prè-
cheurs de haine, aux tyranneaux d’arrondissement,
à ceux qui ne connaissent, pour appliquer les lois,
que le procédé de la trique, qu’il a adressé les
plus justifiés reproches Ceux ta font la désunion;
et c’est contre leur action dissolvante, irritante
et.ré arbative, que toute l’action de Briand est
dirigée. Acte de foi nationale, appel à la concor
de, ardent désir de réformes sociales ; tels sont
les trois termes d’un discours qui — si on le dé
gage des questions de personnes auxquelles il ne
nous appartient pas do nous mêer — apparaît
comme un superbe morceau denseignement po
sitif.
Nouvelles du Sénat
L’Impôt sur le revenu
M. Aimond, rapporteur de la Commission
sénatoriale de l’impôt sur le revenu, a fait
distribuer les premières épreuves de son
rapport. Ce document forme un ensemble
compact de 370 pages.
M. Aimond retrace d’abord l’historique de
la réforme qui est proposée à l’heure ac-
tuelle au Sénat. Il rappelle que tour à tour
MM. Ribot, Cochery, Doumar, Peytral, Cail
laux, Bouvier, de nouveau M. Caillaux dépo
sèrent comme ministres des finances des pro-
jets d’impôt sur le revenu. Il expose le pro
jet voté par la Chambre, documents à l’ap
pui, il rappelle toutes les réserves qui furent
laites alors sur l’ensemble du projet, L’œu
vre de la Chambre ne fut accueillie au Sénat
qu’a titre d’indication, avec l’espoir, selon
l’expression de M. Th. Reinach, que la haute
Assemblée la reprendrait en sous-œuvre. On
formait le vœu que le Sénat procédât par
étapes et qu’il détachât d’un projet touffu
trois ou quatre chapitres qui, tout en faisant
équilibre au point de vue du rendement, ré-
formeraient quelques abus.
C’est dans ces conditions et dans cet esprit
que la Commission sénatoriale s’est mise à
l’ouvrage.
M. Aimond résume ainsi le programme de
la Commission :
1° Recherche des conséquences financiè
res du projet voté par la Chambre ;
2o Etendue de ia réforme a accomplir ;
3® Bases et assiette de l’impôt général sur
le revenu.
M. Aimond examine comment surces trois
points la Commission s’est mise d’accord.
Sur ce premier point — recherche dos con
séquences financières du projet — le rappor
teur constate que l’équilibre de la réforme
à la suite des votes de la Chambre est pro-
fondément troublé, que le déficit visible dès
aujourd’hui dépasse 74 millions et qu’un a -
tre déficit, inv/sible actuellement, vienri
s’ajouter au premier du fait de la fuite des
coupons internationaux, du développement
extraordinaire que prendront les cotes irré-
couvrables et des frais considérables qu’exi
geront l’assiette et le recouvrement des nou
veaux impôts.
Sur le second point — étendue de la ré
forme à accompir — le rapporteur écrit que
la Chambre elle-même a manifesté son opi
nion, lorsque, en votant les amendements
Renard et Malvy, elle a retenu dans le cadre
actuel de la réforme l’étude de :
1» Un impôt général sur le revenu en rem
placement de la personnelle-mobilière et des
portes et fenêtres supprimées ;
2o La révision des impôts cédulaires fon
cier bâti, foncier non bâti, valeurs mobi-
Hères.
Il y aura lieu de poursuivre dans aneautre
étape la réforme des patentes et d’étudier la
création de nouvelles cédules pour les reve
nus qui ne sont pas encore à l’heure actuelle
directement frappés.
Sur le troisième point — base et assiette
de l’impôt — les principes sur lesquels la
Commission a édifié son œuvre sont ainsi
définis :
lo Base aussi large que possible, le nom
bre des assujettis ne devant être limité que
par un minimum d’existence non imposable.
Ce minimum non imposable, la Commission
l’a fixé :
A 3,000 francs dans les communes
2,000 habitants et au-dessous ;
communes
A 1,230 francs dans les
2,001 à 3,000 habitants ;
A 1,500 francs dans les
communes
3,001 à 40,000 habitants;
A 1,750 francs dans les communes
de
de
de
de
10,000 habitants et au-dessus ;
A 2,000 francs à Paris.
En outre, la Commission a prévu l’appli-
cation, par personne à la charge de chaque
contribuable, enfant de moins de 16 ans et
ascendants sans ressources, d’une réduction
variant de 100 francs dans les petites com
munes à 200 francs à Paris ;
2° Dégression de l’impôt. La Commission
a adopté le principe qui consiste à diminuer
l'impôt à mesure que diminue l© revenu ;
3° Déclaration facultative combinée avec
une évaluation administrative et l’emploi
d’un certain nombre de signes extérieurs.
A ce propos le rapporteur rappelle que la
Chambre, a la suite de M. Caillaux, s’était
prononcée pour la déclaration obligatoire.
La Commission a considéré que les mesures
de contrôle proposées étaient insuffisantes, et
une, de ce fait, un tiers de U matière impo
sable échapperait à l'impôt. D'autre part, la
déclaration obligatoire, dit M. Aimond, au
rait pour effet certain de faire retomber la
plus grande partie du poids de l'impôt sur
les revenus qu’on ne peut pas dissimuler,
revenus industriels et commerciaux, traite"
ments des fonctiondaires, revenus mobiliers
des mineurs, etc.
La déclaration facultative des revenus
évalués par l’administration d’après les si
gnes extérieurs, serait au contraire, un
moyen suffisamment efficace pour assurer le
rendement de l'impôt.
Le rapporteur conclut :
Le système que nous soumettons au Sénat
tient compte de tous les tempéraments uti
les, des traditions, des habitudes, voire mê-
me des préjuges de nos concitoyens.
Nous avons mis à la bise de notre impôt
général cinq millions de contribuables, c'est-à-
dire tous ceux qui n’en sont pas réduits au
strict minimum de l’existence. C'est là la
pierre angulaire de l'œuvre.
A la place de la personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres, nous proposons un
impôt général sur le revenu qui s’adapte
mieux à nos mœurs et à nos institutions
que les systèmes d'importation étrangère
dont certains se font les protagonistes.
A la place de l’impôt foncier, nous éta
blissons un impôt fondé d’après la dernière
révision sur les bases de la valeur locative
réelle diminuée de 20 0/0 ; l’agriculture voit
ses charges diminuées de façon considéra
ble.
Aux 30 ou 40 milliards de fonds étrangers
qui bénéficient de notre crédit après avoir
acquitté un simple droit de douane, nous
demandons de prendre une part du fardeau
général.
Malgré un très large dégrèvement agri
cole, et en nous en tenant au taux modéré
de 4 0/0, l’ensemble de la réforme laisse en
core un boni de plus de 200 millions pour le
budget.
--------—-----
M. Doumergue à la Commission
Nous avons donné hier une analyse des
déclarations de M. Doumergue, président du
Conseil, devant la Commission des affaires
étrangères. Il y a lieu de compléter cette
première information par un nouveau dé
veloppement.
Au sujet de l’influence morale de la Fran
ce en Syrie, M. Doumergue a tenu à faire la
déclaration suivante :
Notre tâche, pour aider à la mise en valeur de
cette partie de l’Empire ottoman, sera singulière
ment facilitée par les assurances données, en dé
cembre 1912, à l’ambassadeur de la Républigue à
Londres, par le gouvernement britannique : qu’il
n’avait en ces régions ni intention d’agir, ni des
seins, ni aspirations politiques.
Je crois inutile de vous assurer que, souciera,
comme tous mes
rien
me tous mes prédécesseurs, do ne laissex
perdre du patrimoine moral de la France, je
prêterai mon concours à toutes les œuvres qui
travaillent à la diffusion de notre langue, au déve
loppement de notre influence et qui font aimer el
respecter le génie généreux de la France et que je
soutiendrai tous ceux qui peuvent se dire, sous
quelque habit qu’ils se présentent, les ouvriers de
l œuvre française.
Les intérêts financiers français en Turquie
Voici, sur ce sujet, les déclarations de
M. Doumergue :
L’épargne française a, de tout temps joué un rô
le important en Turquie, où déjà au moyen âge
les banquiers de Provence et de Languedoc ex
portaient et plaçaient l’or français. A l’heure ac
tuelle les capitaux français engagés en Turquie,
presque entièrement investis dans les emprunts
du gouvernement ottoman, s’élèvent en gros au
chiffre de trois milliards de francs
Les conséquences financières de la guerre bal
kanique, le détachement deFempiro ottoman des
provinces sinon riches, du moins suffisamment
prospères pour contribuer au service de la dette
de l’Etat, ne pouvaient laisser indifférent le gou
vernement de la Républque.
Dès que les résultats des premières batailles ont
fait paraître inévitable un démembrement de la
Turquie d’Europe, c’est de Paris que sont parties
ses initiatives tendant à protéger les intérêts
financiers et économiques européens engagés en
Turquie ; c’est une Commission interministérielle
française qui a étudié les mesures à prendre en
faveur des créanciers de la Turquie, et c’est elle
qui a préparé les travaux de la Commission inter
nationale réunie à Paris en juin dernier pour indi
quer les solutions à donner a toutes les questions
financières et économiques posées par la guerre.
La première session de cette Commission a été
interrompue par la guerre entre la Bulgarie et ses
anciens alliés. Le travail de mise au point, d‘é-
claircissement fait dans cette session ne sera pas
perdu, et je saisirai une occasion, prochaine je
l’espère, d’inviter à revenir à Paris les commis
saires des puissances pour les convier, aujour
d’hui que la paix est signée entre tous les belligé
rants, à terminer leur tâche, si nécessaire au re
lèvement financier de la Turquie et de ses adver
saires et à la garantie de leurs prêteurs.
Le ministre des affaires étrangères fait connaître
que notre diplomatie a fait tous ses efforts — sui
vis de succès auprès de la Serbie — pour que les
Etals balkaniques participent à la dette extérieure
de la Turquie, e participation devant être réduite
d’ailleurs, au chiffre strictement nécessaire à la
sauvegarde de tous les porteurs de titres otto
mans. »
Le ministre a de « sérieuses raisons de croire »
que ta Grèce notamment ne refusera pas son
adhésion à ce principe.
L’accord franco-turc
LES AVANTAGES RÉSERVÉS A LA FRANCE
De même, déclare le ministre, que nous nous
sommes efforcés de préserver les intérêts maté
riels franç is vis-à-vis des vainqueurs de la guerre
balkanique, de même vis-a-vis delà Turquie, en
échange des ressources douanières et fiscales que
le consentement du gouvernement de la Républi
que pourrait permettre à la Porte de trouver pour
faire face à ses charges financières, nous avons
cherché à obtenir et avons obtenu pour le com
merce et pour l’industrie français des avantages
concrets »
Ces avantages consistent, en faveur de nos na
tionaux, dans la promesse d’améliorations du ré
gime douanier ottoman et du régime des analyses
et dans celle d’une étude en commun des mesures
propres à assurer la garantie de la propriété in
dustrielle.
Je crois pouvoir vous donner l’assurance que
l’industrie française obtiendra de son côté d’im
portantes commandes, dont bénéficiera le travail
national.
D’autre part, nos compatriotes oât obtenu la
promesse d’un important réseau de chemins de
fer à construire, tant en Anatolie du Nord qu’en
Arménie et en Syrie. La longueur de ce réseau se
rait supérieur à 2 403 kilomètres. A ces conces
sions s’ajouteraient la construction et l’exploita
tion des ports de Jaffa, de Caïffa et de Tripoli en
Syrie, et de ceux d’Héraclée et dIneboli sur la
mer Noire.
Vis-à-vis des États de la péninsule balkanique,
qui ont pu trouver auprès de notre épargne un
concours nécessaire au cours de cette crise, notre
diplomatie a suivi sa ligne de conduite habituelle
et a insisté auprès d’eux pour obtenir des avanta
ges en faveur de notre commerce et de notre in
dustrie. Je poursuis des négociations dans ce sens
en Serbie et je ne doute pas que d’importantes
commandes ne soient passées pr le gouverne-
ment serbe aux industriels français dont Certains
oui déjs obtenu des promesses.
En Grèce, une grande partie des commandes
faites au cours de la guerre ont été exéoulées en
France. Je tiendrai la main à ce que ce marché resté
ouvert à notre industrie. L’action de notre légs-
ton a cet égard sera appuyée par l’influence qu’a
prise notre mission militaire, dont le contrat a été
récemment renouvelé avc une extension des
pouvoirs conférés à nos officiers.
L’Etat Albanais
La question qui offre le plus d'urgence est eelte
du nouv.1 État qui va sortir des délibérations des
rep esentanis des puissances à Londres et dont
la création a été la conséquence de la volonté dès
grandes puissances de maintenir entre elles la
paix et l équilibre.
Les puissances sont toutes tombée? d'accord
pour offrir la couronne d’Albanie au prince de
wied, apparenté à la famille royale de Roumanie.
La France s’est associée, d'autant plus volontiers
a cette désignation qu’elle y trouve une occasion
de reconnaître le rôle utile joué par la nation rou-
maine comme facteur de l’equilbre e mro les ! eu-
pies ba kaniques, et son action pacificatrice dans
le dernier conflit.
Ce rôle politique de la Roumanie a rencontré
1 approbation de l’opinion publique fra-ciise et je
suis heureux de signaler que nos relations tou
jours bonnes avec ce pays en ont été amsliorées.
De part et d’autre a été marifesté un sincère désir
de relations plus frequentes, et des appels ré-
cents faits à notre industrie pour la préparation
d’importantes commandes peuvent Dous faire es-
pérer des résultats intéressants.
Après avoir signalé l’état des (rivaux de
délimitation de l'Albanie, le ministre traite
de
La Question Arménienne
La question des réformes a faire en Arménie
afin de parer à l’état misérable et anarchique de
cette province turque n’a cessé vous le savez, de
préoccuper les grandes puissances. Au cours de
l’été dernier, un projet de réformes avait été pré
senté par le gouvernement ru se et soutenu par
la France et l’Angleterre. Ce projet fut soumis à
une commission formée par les ambassadeurs des
puissances à Constantinople.
Le 29 octobre, le gouvernement ottoman, per
suadé qu’‘i échapperait a la pression des puissan-
ces en devançant leurs propositions, non mait
deux inspecteurs généraux ottomans pour les six
provinces arméniennes. La Russie, avec l’appui de
la France et de l’Angleterre et l’assentimer | ces
autres Puissances,' poursuit les démarches com-
mencées pour faire donner à l Arménie un statut
assurant la sûreté des personnes et des biens.
Fidèle aux principes d'humanité qui ontlouj ours
guide la politique française à l'égard des p pula-
bons victimes d’abus en Orient, je second roi les
a ss
efforts de notre alliée pour arriver à l’établisse-
ment de l’ordre et au respect des droits de tous
dans les provinces armeniennes.
NOS COLONIES
TUNISIE
l.e Commerce extérieur de la régence
La statistique générale de la Tunisie, an
nexée au rapport de 1912, vient d'être publiée
par les soins du ministère des affaires étran-
gères Elle permet d'apprécier notamment
les progrès rapides accomplis en vingt
ans par le commerce extérieur de la ré
gence.
Ce commerce, exportations et importations
comprises, n'ateignait en 4893 que 68,068,555
francs. Dix ans plus tard, en 1903, il avait
déjà plus que doublé, atteignant 233,011.520
francs. Depuis cette année, à part un fléchis
sement de 11 millions en 1905, l’essor ne
s’est pas ralenti. Le mouvement commer
cial a encore doublé et se chiffre en 1912
par 310,919,188 francs.
Détail digne de remarqué : les échanges
de li Tunisie-avec la France ont suivi la mê-
me marche ascendante. De 88 millions en
1903 ils ont passé à 148 millions en 1912.
C'est dire que la France occupe dans le com-
marce de la Tunisie une place sans donte
moins considérable que dans le commerce
algérien, égale pourtant à la moitié du
commerce total de la régence. L’Italie, qui
vient au second rang, se contente du mo-
deste chiffre de 33 millions ; l’Angleterre
suit avec 28 millions. L'Algérie est au qua
trième rang avec 7,700,000 francs aux expor-
talions et 17,800,000 francs aux importations,
soit un total d’environ 25 millions.
ANGLETERRE
Médecins et Clergymen balayent les rues
Une scène extraordinaire s’est déroulée la
nuit de lundi à mardi dans les rues de
Leeds, ville où, ainsi que nous l’avons déjà
relaté, les employés de la municipalité sont
eu grève depuis près de quinze jours. La plu-
part des services ont été cependant rétablis,
grâce au concours d’une association dite
Ligue des Citoyens, composée de gens de
bonne volonté qui font le travail des grévis
tes. Seuls les balayeurs des rues n’avaient
pu être remplacés et les immondices com
mençaient à s’accumuler de façon inquié
tante.
Prenant leur courage à deux mains, une
soixantaine de membres de la Ligue des Ci
toyens prit rendez-vous pour lundi soir,
minuit, dans une salle appelée, de façon ap
propriée, salle des Philosophes. A ‘heure
dite, les volontaires arrivèrent au lieu du
rendez-vous, beaucoup d’entre eux dans
leur propre automobile, conduite par leur
chaufeur. Il y avait parmi eux des avocats,
des médecins, plusieurs clergymen et un
architecte des plus connus, qui portait en
bandoulière un revolver de fort calibre.
Escortés par des policemen à cheval, les
soixante se rendirent au dépôt central, où
on leur distribua pelles et balais, puis ils
commencèrent leur travail, ne l’interrom
pant que quelques minutes pour repousser,
à l’aide des policemen montés, une charge
des grévistes. Un second détachement de
ligueurs passa avec des tombereaux dans les
principaux hôtels pour y récolter les pou-
belles qui s’y accumulaient. Réconfortés par
des rafraîchissements variés que transportait
l’automobile do l’un d’eux, les travailleurs
volontaires continuèrent leur tâche jusqu’à
la pointe du jour.
HOLLANDE
Un déraillement
Une catastrophe de chemins de fer s’est
produite dans la province de Groninguen, a
Beilen. . ,
L’express de Groninguen à Amsterdam a
déraillé pour des causes qui ne sont pas en-
core ét.blies.
D’après les dernières nouvelles n y a sept
personnes tueeset plusieurs sont grièvement
blessées.
Le fils du ministre de l’Intérieur de Hol-
lande, M. Cort Van der Linden, se trouve au
nombre des victimes. Il a été tué dans la
compartiment de Are classe qu’il occupait.
Il reste quelques cadavres qui n’ont pu sis
I core être identifiés.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.5%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.5%.
- Auteurs similaires Société havraise d'études diverses Société havraise d'études diverses /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Société havraise d'études diverses" or dc.contributor adj "Société havraise d'études diverses")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/6
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t52638676b/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t52638676b/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t52638676b/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t52638676b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t52638676b
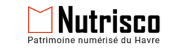


Facebook
Twitter