Titre : Le Petit Havre : organe républicain, démocratique, socialiste ["puis" organe républicain démocratique "puis" bulletin d'informations locales]
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1913-11-20
Contributeur : Fénoux, Hippolyte (1842-1913). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836500g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 20 novembre 1913 20 novembre 1913
Description : 1913/11/20 (A33,N11812). 1913/11/20 (A33,N11812).
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t52638640q
Source : Bibliothèque municipale du Havre, PJ5
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/04/2023
53* Année
N 11,812
(€ Pages)
6 Centimes
EDITION DU MATIN
SS
S Centimes
(6 Pages)
Administrateur * Délégué
O. RANDOLET
presser tout ce qui concerne l’Administratios
fi M. O. RANDOLET
SS, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havre
Administration; Impressions et Aunonces, T®. 10.47
AU HAVRE
A PARIS
BUREAU du Journal, 118, boni* de Strasbourg.
L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Jeudi 20 Novembre 1913
========= ================= =========
Rédacteur en Chef. Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
Auresser tout ce qui concerne la Rédaction
a M. HIPPOLYTE FÉNOUX
85, Rue Fontenelle, 35
téléphone : Rédaction, No 7.66
£s PETIT HA VRE est désigné pour les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
.
| ABONNEMENTS
! Le Havre, la Seine-Inférieure, l’Eure ,
l’Oise et la Somme
Autres Départements...
Union Postale
| Trois Moisi Six Mois
Un As
6
10
50
p».
• Fr.
as tc
1 @
2s
Fr.
^^^J^ a!emont ’ r s ^NS FR.ns, dens tous tas Baransx ds es E
20 Fr.
48%
DEPECHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 19 Novembre, Dépêche de 4 h. 30
CUIVRE
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
Comptant.
calme
£ 68 7/6
-b
22/6
3 mois
£ 66 L 6
5/-
ETAIN
Comptant .
calme
£181 18/-
-1-
-/-
3 mois
£ 182 15/-
-i-
5/-
FER j
Comptant ..
calme
■
£ 49/1 %
2 % d
V-
3 mois.... ;
£ 49/10 %
23d
-/-
Prix comparés avec ceux de la deuxième Bourse
du 18 novembre 1-43.
du ComMerce et de l'Industrie
DISCOURS DS M PABTHOU
- Le Comité républicain do Commerce et de
l’Industrie donnait hier soir son grand ban-
quel annuel, sous la présidence de M. Louis
Barthou.
. Le grand nombre de convives témoignait
de l’importince de plus en plus grande. prise
par le Comité.
Hier soir, le banquet ne comprenait pas
moins en effet, de 1,800 couverts.
Toutes les sections de province avaient
envoyé des délégués et les membres du Par-
lement avaient en grand nombre accepté
l’invitation qui leur avait été adressée.
M. Barthou avait à sa droite MM. Antonin
Dobost, président du Sénat et Ratier, garde
des sceaux; il avait à sa gauche MM. Mas-
curaud, président du Comité républicain du
commerce et de l’industrie et Paul Deschanel,
président de la Chambre des députés.
A la table d’honneur avaient pris place
tous les ministres et les sous-secrétaires
d’Etat.
Au champagne, M. Mascuraud a prononcé
un discours dans lequel, écartant pour un
soir les problèmes d'actualité politique, il a
analysé l'œuvre sociale de la République.
« Les membres de notre Association, a dit
M. Mascuraud, souhaitent que le gouverne-
ment poursuive l’œuvre d’assainissement,
moral et matériel entreprise contre le
taudis.
» Ils admettent que la surveillance du
travail à domicile ex ge l’intervention de la
loi. Ils espèrent enfin que le Parlement aura
l’énergie d’achever la loi sur les syndicats
professionnels. »
M. Mascuraud a ensuite exprimé l’espoir
que la pénétration pacifique au Maroc four-
nisse bientôt au pays une légitime compen-
nation à ses sacrifices en hommes et en ar
gent.
Concernant le rapprochement franco-es-
pagnol, il dit :
« Vous n’ignorez pas que cette fois encore,
nous nous sommes efforcés à Madrid et à
Paris de seconder, dans la mesure de nos
moyens, les efforts du gouvernement. »
L’orateur termine en exprimant sa con
fiance dans l’avenir de la France et de la Ré
publique laïque et démocratique qui consti
tue ia plus etonnante expérience politique
de l’humanité.
* «
v M. Barthou, président du Conseil, a pris la
parole après M. Mascuraud.
En acceptant l’invitation du Comité, il a
voulu, dit-il, apporter à une grande assem-
blée politique et économique dont on n’a
plus a compter les services, le témoignage
de sa gratitude et de sa sympathie.
M. Barthou sera ‘interprète des senti-
Zuents des assistants auprès du président de
la République.
Dans un pays de liberté, sous un régime
républicain, une élection présidentielle ne
peut ni ne doit laisser derrière elle ni les re
présailles de la victoire, ni les ressentiments
de la défaite.
En dehors des partis, au-dessus de tous les
partis, le président de la République n’a pas
de responsabilite qui lui est propre ; il est le
gardien r espectueux et fidèle de ia Constitu
tion.
Le gouvernement est responsable devant
la Chambre et le Sénat et M. Barthou est cer
tain qu’on lui rendra cette justice qu’il n’a
jamais été un homme à éluder ou esquiver
les responsabilités de sa fonction.
Le president du Conseil rappelle que le
Cabinet qu’il a l'honneur de présider a eu
des débuts laborieux et depuis ses adversaires
n'ont cessé de lui faire la vie dure.
M. Barthou se félicité de la réorganisation
du parti radical et radical socialiste ; il don-
nera plus de clarté à la po itique générale.
Mais il s’étonne de n’avoir pas été inter
pellé sur la politique générale du Cabinet
dès la rentrée des Chambres. C’est seulement
hier qn'ane démarche de cette nature a été
déposée par M. Breton.
Le gouvernement ne sera pas embarrassé
pour répondre.
M. B irthou déclare que la défense de l’Eco
le laïque doit réunir tous les républicains
dans une même intention et une même es
pérance.
A aucun moment il n’a pu constater de la
part du gouvernement une hésitation, une
défaillance, une complaisance coupable.
Dès lundi prochain, l’orateur sera à la
Chambre pour soutenir avec l'ensemble du
Parti républicain, les lois qu’il juge néces
saires afin d’assurer à l’École laïque une dé
fense indispensable.
Le gouvernement n’a pas davantage dé
serté son programme social.
Les lois votées ou proposées sont une né
cessité et un devoir, surtout pour un régi-
me républicain.
En faisant voter la loi de trois ans, nous
avons eu de notre devoir une conception qui
nous a conduit à demander au Parlement et
au pays un sacrifice qui nous paraît néces-
saire.
; J’ai dit encore et c’est la conviction pro
fonde de tous les membres du cabinet, que
‘les conséd uences de cette loi uni a augmed-
PARIS, TROIS HEURES MATIN
NOUVELLE ETAPE
NEW-YORK, 19 NOVEMBRE
Cetens: décembre, baisse 12 points; jan
vier, baisse 8 points ; mars, baisse 8 points ;
mai, baisse 7 points. — A peine soutenu.
Calés : hausse 10 à 19 points.
NEW-YORK, 19 NOVEMBRE
Cuivre Standard disp.
— janvier
Ammalgamat. Coy...
J. 29 MSI
70 3 8
15 37
C. PRZCEDEX?
14
15
70
15
50
50
7,8
75
CHICAGO, 19 NOVEMBRE
Blé sur.....
Décembre.
Mai
c. au jour
86 3 '8
9) 7/8
a. PREGED
85 3 4
90 3 8
Maïs sur
Déceinbre.
71 -/»
70 1 2
--===
Mai
71 n/»
70 5 8
Saindoux sur.
Janvier...
2: 02
10 90
—
Mai
H 22
14 10
té la défense nationale du pays, doivent être
supportées par la richesse acquise.
Mais ces dépenses présentent un caractère
de dépenses temporaires non renouvelables;
c’est pour cela que le cabinet a pensé avec le
ministre des finances que seul un emprunt
de liquidation pourrait faire face à ces dé
penses.
Nous avons déposé un projet d’emprunt ;
nous le défendrons et nous n’hésiterons pas
f à engager noire responsabilité !
Le président du Conseil promet au nom
dn gouvernement d’agir auprès de la Com-
mission sénatoriale pour faire aboutir le pro
jet d’impôt sur le revenu.
Le gouvernement ne veut pas d’une ré
forme qui soit une aventure et qui provoque
dans le pays uns véritable révolution.
La réforme ne sera possible qu’à condition
de respecter le secret des fortanes et des af
faires.
Le président du Conseil explique encore
les raisons qui l’ont poussé à faire voler la
loi de trois ans.
« Ce n’est pas une loi de provocation ;
nous n’avons fait que répondre à des arme-
ments par d’autres armements.
» Messieurs, est-il un pays dans lequel la
paix soit plus néce saire et plus unanime-
ment désirée que uans la démocratie fran
çaise ?
» Cette paix, depuis un an, a été assurée à
travers bien des difficultés et des périls.
Mais, à l’heure actuelle, il est permis de res
pirer et les points douloureux s’atténuent ou
di-p Taisseut. .,
» Je peux dire que nous sortons d’une ère
de troubles et de malaises.
» Dans tous les pays, il faut que ceux qui
peuvent p rler au nom des intérêts généraux
de ces pays pèsent sur leur Gouvernement
pour qu’on en finisse avec un malaise qui,
troublé et paralyse les affaires.
» Cette paix du Monde, nous continuerons
à y contribuer.
». Monsieur Mascuraud parlait de frater
nité humaine. C’est un rêve auquel je m’as
socie. Mais quand cette fraternité abaissera-
t-elle les frontières ?
» En attendant, il faut préconiser la soli
darité française.
» Je bois au Comité républicain du Com-
merce et de l’Industrie 1 »
La Seconde Ligne
du Havre à Paris
Sur h proposition de M. Lemarchand, le
Cons il général de la Seine a émis le vœu
que la traversée de la ligne de chemin de
fer du Havre, sur la ligne de Serquigny à
Rouen, avec raccordement à Pont-de l'Ar-
che, entre les lignes de Serquigny à Rouen
et du Havre à Paris, soit effectuée au moyen
d’un passage souterrain et que le proj t de
viaduc actuellement soumis à la Chambre
soit défiaitivemeat écarté.
MEETING ANTIMILITARISTE
Le meeting o ganisé par l’Union des Syn
dicats de la Seine et le Comité Confédéral
p ur protester contre le procès du « Sou du
Soldat » a eu lieu hier après-midi rue Saint-
Paul.
Les assistants étaient nombreux.
Des discours antimilitaristes violents ont
été prononces, puis l’assemblée a adopté un
ordre du jour protestant contre le procès de
tendance intenté aux militants et a adressé
son salut fraternel aux inculpes.
La sortie s’est effectuée sans incidents.
CONDAMNATIONS
AUX TRAVAUX FORCÉS
Blois. — Le nommé Marcel Normantqui,
le 29 janvier et le 2 mars, tenta d’assassiner
deux vieillards pour les voler, a été condam
né à quinze ans de travaux forcés.
TROYES. — Le nommé Paul Lapon qui, le
2 a ût dernier, incendia des bâtiments agri
coles aux Chênes, vient d’être condamné à
dix ans de travaux forcés.
EXPLOSION DANS UNE MINE
Birmingham. — 24 hommes ont été tués
mardi soir a la suite d’une explosion dans
une mine de charbon.
•-==-%=-====
DE PARIS AUX BALKANS EN BALLON
Constantinople. — Les aeronautes Schnei-
der, Pierron et Bienaimé sont arrivés à
Constantinople.
Ils ont franchi en un seul vol une distance
de deux mille kilomètres environ.
Le sphérique Icare bat ainsi le record
français de durée.
armrencsnn@2FBnrwesce
LFS TROUBLES AU MEXIQUE
NEW-YORK.— Suivant un télégramme de
Mexico, l’ambassadeur américain aurait reçu
dans la matinée de M. Bryan une dépêche
annonçant qu’une mesure de nature grave
relative au Mexique était à l’étude à W as-
hing ton,
LA
Réforme électorale en Marche
La Chambre en a fini avec la réforme
électorale. Elle a voté l’ensemble par 333
voix contre 225.
C’est ce texte qui va être soumis au Sé
nat comme le dernier mot de la transaction
possible.
Le président de la Commission, M. Fer
dinand Buisson, a tenu, avant le vote final,
à préciser la portée du projet élaboré par la
Chambre. Il a rappelé l’historique de la
discussion, au cours de laquelle, par trois
fois déjà, a été affirmée la volonté de rem
placer le scrutin d’arrondissement par le
scrutin de liste. L’opinion adverse n’a pu
réunir plus de GG voix.
Ce sont ceux que l’orateur appelle ironi
quement « les hommes de bronze ».
Et il se sert, pour les mettre au pied du
mur, d’un document tout neuf, émané à la
{ dernière heure de M. Combes lui-même :
■ car le « petit père » vit encore, et dans une
oraison funèbre magistrale, il a voulu se
charger d’enierrer la représentation des mi
norités par cette prase lapidaire :
Peut-être, écrit-il, n‘ess-il pas sans incon
vénient, ni même sans danger, qu’une
Assembiéee élue par le suffrage anversel ne
compte dans son sein que des mandataires
du peuple imbis des mêmes idé6s et aninlés
des mêmes passions, et ne serait-il pas mai-
séant, tant pour l’Assemblée que pour la
nation elle-même, qu’à côté de la majorité
sortie du suffrage populaire, la minorité dis-
posât de quelques sièges et pût foire enten
dre sa voix dans les débats qui mettent en
jeu les intérêts du pays.
« A-t-on jamais rien écrit de plus mé
prisant pour la démocratie, rien de plus
césarien, de plus oligarchique ! » s’écrie
M. Buisson.
« Convenir qu’il n’est pas malséant d’ac
corder quelques sièges à la minorité, c’est
lui faire une aumône. Nous n’en voulons
pas ! Nous voulons des parts égales entre
gens ayant des droits égaux !
» Vous vous prétendez partisans de la
représentation des minorités, et quand
nous vous demandons laquelle, vous ré
pondez : < Celle que nous voudrons bien
» leur accorder. »
» Ces paroles de M. Combes feront plus
que tous nos discours pour éclairer le
pays. »
En somme, dit M. Buisson pour se résu
mer, le projet de loi voté par la Chambre
n’accorde aux minorités que la part des
droits évidemment acquis,qu’on ne pouvait
leur enlever sans un déni de justice, contre
lequel la France entière protesterait.
Le Sénat ayant lui-même condamné le
scrutin d’arrondissement et adopté le scru
tin de liste départemental, il ne reste plus
de raison pour que l’accord avec la Cham
bre ne soit prompt et définitif,sur une forme
transactionnelle de représentation des mi
norités.
Plus de cinq mois nous séparent encore
des élections, c’est un délai suffisant pour
clarifier la situation, pour voler la réforme
et l’appliquer en mai prochain.
HIPPOLYTE FÉNOUX.
I
LA COMMISSION DU BUDGET
La Commission du budget a entendu la
fin de l’exposé du rapporteur général sur
‘emprunt et l’équilibre du budget.
M. Noullens a successivement examiné les
dépenses extraordinaires de la guerre aux
quelles l’emprunt doit pourvoir, les besoins
du budget qui se trouvent en corrélation
avec l’emprunt, la situation de la dette, les
caractères de l’emprunt proposé, la combi
naison d’amortissement et la question de
l’annuité de la rente.
La conclusion a été que l’emprunt se
(rouve plutôt inférieur aux besoins auxquels
le gouvernement aura à faire face.
Après lui, M. Ju es Roche a demandé à la
Commission de prendre une décision de
principe sur l’emprunt.
M. Raiberti a défendu le projet du gouver-
nement.
MM. Augagneur, Thomas, Malvy, Piou et
de Mon ont déclaré se refuser a accepter
qu’une part de l’emprunt alimente le compte
provisionnel et partant à subvenir au déficit
du budget.
Sur la proposition de M. Cocbery, la Com
mission a accepté par 28 voix contre 6 de
passer à la discussion des articles du projet
sous la réserve rappelée par MM. Malvy et
Gheusi qu’elle examinera en même temps
que l’emprant la taxe sur le capital.
Par 28 voix contre 4, la Commission a en-
suite adopte le principe de 1 emprunt pour
f ire face aux dépenses extraordinaires
de la guerre dont le gouvernement fera
connaître le chiffre exact.
M. Augagneur a alors proposé de limiter
l’emprunt et son usage.
Cette proposition a été votée par 48 voix
contre 13.
La Commission a ensuite reporté sa séance
à aujourd’hui, pour entendre le Gouverne
ment sur le chiffre de l’emprunt, pour l’exa-
men de la taxe sur le capital et la continua
tion de l’examen de l’emprunt.
LES AFFAIRES D'ORIENT
La Délimitation de l’Albanie du Nord
Belgrade, 19 novembre.
On se plaint ici de ce qu’un certain Datz,
Albanais, a réuni une bande armée qui pré
cède la commission internationale de déli
mitation de la frontière de ‘Albanie du
Nord et oblige par intimidation et même par
la violence les habitants albanais et Serbes
à déclarer vouloir être incorporés a 1 Al-
■ banie.
UNE TAXE
SUR LA
Plus -Value Immobilière
II
La plus-value immobilière ne pro
vient pas seulement des travaux publics :
le mouvement de la population en est une
source aussi fréquente. G est pourquoi M.
Génestal a donné à son Mémoire, soumis
au Congrès des maires, une portée plus
générale que la loi de 1807, et c’est pour
quoi il a demandé le vote, par le Parlement,
de dispositions analogues à celles qui sont
en vigueur depuis quelques années en Alle
magne et en Angleterre.
Toutefois, les systèmes allemand ou an
glais peuvent-ils être envisagés en France ?
Le problème a été discuté par la Commis
sion de législation fiscale, il a été posé par
le ministre des finances, devant le Parle
ment, à l’occasion du budget de 1912, enfin
une proposition de loi de M. Ajam, déposée
le 10 juin 1912, a précisé le débat en le
faisant porter sur des dispositions con
crètes.
Avant d’étudier ce projet très intéressant,
qui s’inspire de la législation allemande,M.
Génestal expose les législations allemande
et anglaise, d’après une étude très savante
de M. William Oualid, chargé de conféren
ces financières à la Faculté de droit de Pa
ris. Il a également utilisé les documents
qui.lui ont été obligeamment communiqués
par le Musée social.
Nous ne saurions suivre le Rapport que
nous analysons dans tous ses détails. Conten
tons-nous de rappeler brièvement quelques
faits. C’est en Angleterre que, le premier,
Stuart Mill déduisit de la notion de rente
toutes les conséquences économiques et fi
nancières qu’elle comporte, et proposa de
prélever, après évaluation préalable, toute
plusvalue non gagnée, c’est-à-dire aitribua-
ble à des causes étrangères à l’activité du
propriétaire ; c’est en Amérique qu’Henry
George s’attacha plus spécialement à la
rente urbaine, à la plus-value du sol des
villes ; c’est en Allemagne que la multipli
cité des budgets à alimenter provoqua pour
la première fois, en Europe, la création de
la nouvelle taxe qui, d’impôt local est de
venu impôt fédéral d’Empire.
En Angleterre, en 1910, malgré l’oppo
sition des lords, un budget qui comportait
la création d’une imposition sur « la plus-
value strictement non gagnée » fut pro
mulguée.
Avec l’expérience faite en Australasie,
mais en des conditions qui ne sauraient
avoir leur équivalent en Europe, telles pa
raissent être les seules applications faites
jusqu’ici de la théorie de l’imposition des
plus-values immobilières.
* $
Pour justifier la théorie de l’imposition
des plus-values immobilières, les raisons
excellentes ne manquent pas.
Quand on envisage, en effet, les plus-va
lues considérables réalisées par certains
propriétaires urbains, sans aucun effort de
leur part ; quand on constate que des ter
rains, laissés exactement en l'état primitif,
ont haussé de valeur dans de très notables
proportions ; quand on assiste à une aug
mentation de loyers de tout un quartier,
uniquement par suite de la mise en exploi
tation d’une nouvelle ligne de communi
cation, — comment ne pas conclure que la
société, la communauté, a le droit de préle
ver au moins une partie de celle plus-
value ?
Certes, dit M. Génestal, ce prélèvement
peut varier à l’infini depuis la théorie ex-
provriairice de Henry Georgeproposant de
percevoir, au profit de la communauté, toute
la plus-value, jusqu’aux prélèvements ré
duits à une faib e portion de l’excédent non-
gagné. Grâce à l’accroissement de la popula
tion, aux progrès de la richesse, à l'activité
grandissante des autorités municipales ou de
l'Etat, les terrains — et particulièrement les
terrains urbains — augmentent de valeur
sans que les propriétaires y aient le moins
du monde contribué par leurs efforts. N’est-
il pas juste que la société récupère, sous
forme d’impôt, cette plus-value non gagnée
dont elle est la créatrice et la source ?
L’imposition des plus-values immobilières
correspond, d’ailleurs, parfaitement à la
notion moderne de la justice fiscale.
Elle aurait le mérite de mettre un terme
aux spéculations sur les variations de prix
des immeubles et particulièrement des ter
rains, spéculations le plus souvent néfastes
et qui revêtent deux formes principales : im
mobilisation prolongée du sol entre les mê-
mes mains, le détenteur laissant son terrain
grandir de valeur pendant qu’il sommeille,
tandis que la population croissante doit se
contenter d'an espace de plus en plus res
treint — ou bien multiplication intense d’o
pérations de tous ordres : ventes, constitu
tion d’hypothèques multiples entraînant des
pertes énormes pour les prêteurs et pour
les entrepreneurs.
D’autre part, l’impôt sur les plus-values
constitue un moyen de faire fice aux be
soins grandissants des municipalités notam
ment, et aux dépenses de travaux publics et
d'amélioration de tout ordre dont profitent
en grande partie les propriétaires fonciers.
Il pourrait aboutir à une diminution des
droits de mut lion immobilière, droits qui
frappent indifféremment toutes les trans
missions immobilières, opérées ou non dans
un but de spéculation, que l'aliénateur réa
lise ou non.ua bénofice, et droits qui s’op-
po ent souvent par leur élévation à un trans
fert utile de certains immeubles.
Certes l'imposition des plus-values a don
né lieu à des objections que l’auteur du
Mémoire ne méconnaît pas, mais qu’il exa
mine. On a dit que cette imposition consti
tuerait une véritable expropriation ; on a dit
aussi que l’imposition de la plus-value im
pliquerait une contre-partie : l’obligation
pour la société de compenser en tout ou
partie les moins-values. Autant la première
objection est spécieuse et sans fondement,
autant la seconde mérite qu’on s’y arrête
et, d’ailleurs, on ne peut invoquer contre
elle aucune raison d’ordre juridique. Mais,
ajoute le Rapport, on peut lui opposer de
sérieuses considérations d’opportunité et de
nécessité pratique : tandis que l’imposition
des plus vaines semble devoir se garantir
assez aisément contre la fraude, l'indemni-
sation des moins-values prêterait beaucoup
plus aux collusions. D’autre part, l'impo-
sition ne portant que sur partie de la plus-
value, la marge de profit laissée aux pro
priétaires constitue une compensation très
suffisante aux moins-values éventuelles.
La troisième critique est d'ordre plus
particulièrement financier. Elle est résu
mée et réfutée en ces termes :
Si l’impôt sur las plus-values a pour but
d’aboutir à une diminution des fluctuations
de c-tte valeur, dans le sens d’une moindre
progression, il y a tout lieu de craindre —
dit-on — qu’il obtienne le résultat inverse,
à savoir de provoquer une h nisse de cette
valeur, le vendeur rejetant l’impôt sur l’ache-
tear qui en resterait ainsi le débiteur final.
En effet, les propriétaires ne supporteront
‘impôt que si leur situation économique ne
leur permet pas de le rejeter sur d’autres.
Mais l’objection n’a pas autant de portée
qu’il put paraître au premier abord, car les
avantages de l’impôt, au point de "Vue des
abus de la spéculation et de la hausse im-
modérée de la valeur des immeubles, sem
blent devoir compenser les inconvénients
de la répercussion que voudrait éviter le lé- [
gislatear.
Le Rapport examine ensuite la façon
dont il faut appliquer le principe de la plus-
value. Il détermine le moment où il con
vient de se placer pour estimer cette plus-
value ; il pose en principe que le fisc ne
peut saisir toute plus-value, si minime soit-
elle, et il établit la marge de profit laissée à
l’initiative et à la spéculation individuelle,
en abandonnant une marge plus élevée à
la propriété bâtie; il prévoit certains cas
d’exemption ; enfin il envisage le taux de
l’impôt, estimant avec les législateurs et les
théoriciens que l’impôt des plus-values sur
la grande propriété peut s’élever jusqu’à
35 et même 50 0/0 de la valeur de ces
plus-values. Ainsi le propriétaire conserve
encore la moitié ou les deux tiers d’un
excédent à la production duquel il est
étranger. Peut-être la progressivité pour
rait-elle être employée ici, sa souplesse
permettant de mieux réaliser le but re
cherché.
«En résumé, ditM. Génestal, l’imposition
des plus-values immobilières, justifiée en
principe, doit obéir, dans l’application, aux
règles suivantes : N’atteindre que la plus-
value non gagnée, celle-ci étant déterminée
grâce à certaines déductions opérées sur la
plus-value absolue, et la frapper d’un im
pôt progressif ou dégressif, plutôt que d’un
impôt proportionnel, suivant les contin
gences actuelles et locales. Dans la fixation
du taux, comme dans l’assiette de l’impôt,
il y a lieu de tenir compte de la nature
même des propriétés imposées et de sou
mettre à un régime différent les propriétés
bâties et les propriétés non bâties. »
Ayant étudié avec soin le fonctionnement
de cette taxe nouvelle en Allemagne et en
Angleterre, l’auteur du Rapport en conclut
que « l’imposition des plus-values foncières
n’est plus, comme on le soutenait autrefois,
et comme l’affirment encore ses adversaires,
une utopie irréalisable ». Sans doute, dit-
il, elle poursuit autant une fin sociale
qu’un but purement financier, mais elle
paraît se tenir aussi éloignée du non inter
ventionnisme du libéralisme économique
que de l’expropriationisme fiscal d’Henry
George.
* *
L’impôt sur la plus-value, qui a fait ses
preuves en Allemagne, a ses avantages: il
a aussi ses défauts, et c’est pourquoi le
législateur ne devra pas se départir d’une
certaine prudence. Mais il apparaît bien
que la législation française peut entrer
sans inconvénient dans la voie que lui ont
tracée les législateurs allemands et anglais.
C’est ce que demandait M. Ajam en dépo
sant, le 10 juin 1912, une proposition de
loi ayant pour objet la création d’un impôt
sur la plus-value sociale, et que le Rapport
analyse parallèlement avec les lois étran
gères.
Ce projet de M. Ajam, on doit l’approu-
ver dans ses dispositions principales ; mais
on estimera cependant qu’il devrait être
amendé sur plusieurs points. C’est ainsi
que le produit de l’impôt, entre l’Etat et la
Commune, devrait se répartir par moitié.
Peut-être même la Commune devrait-elle
être avantagée, puisque c’est surtout à
l’activité communale que, le plus souvent,
l’immeuble doit sa plus-value.
Telle est, dans son ensemble. l’importan
te et intéressante élude de M. Génestal.
Elle a servi de base à une discussion ap
profondie au Congrès des Maires tenu à
Paris, il y a quinze jours, — et elle a moti
vé l’expression du vœu suivant formulé à
l’unanimité :
« Le Congrès des Maires... émet le
vœu :
» Que le Parlement crée au plus tôt une
taxe sur la plus-value immobilière et
abandonne aux Communes la plus large
part de cette taxe ;
» Subsidiairement, et en attendant le
vote de la loi créant l'imposition ci-dessus,
que le Parlement-simplifie la procédure
instituée par J . loi de 1807 en cas de plus-
value résultant de l'exécution des travaux
publics, de telle sorte que la loi devienne
facilement applicable. »
s
* «
Ainsi que le disait très justement M, Gé-
nestal, dès le début de son Mémoire, les
charges sans cesse croissantes qui sont im
posées par l’Etat aux Municipalités, de mê
me que les sacrifices spontanés que celles-
ci consentent pour l’assistance publique,
l’assainissement, la voirie, leur font une né>
cessité de rechercher de nouvelles ressour
ces. C’est pourquoi il est indispensable que
le Parlement réalise le vœu formulé par le
Congrès des Maires.
Une question qui, à l’heure actuelle,
préoccupe au plus haut point les Municipa
lités des grandes villes est celle des Habita
tions à bon marché.
Or les Municipalités ne trouveraient-
elles pas, dans celle taxe sur la plus-value
immobilière, les ressources nécessaires et
qui, jusqu’ici, dans la plupart des cas,
leur font défaut ? Et pourrait-il exister une
affectation plus naturelle d’une partie tout
au moins de cette taxe nouvelle?
Cette idée ingénieuse vient d'être émise
au cours d’une enquête sur la Crise des
loyers et sur la question des Habitations à
bon marché. Elle était implicitement con
tenue dans le Mémoire de M. Géneslai.
Tu. Vallée.
Nouvelles de la Chambra
La Limitation des Débits d’Alcoox
Rapport de M. Jules Siegfried
La question de la limitation du nombre
des débits de boissons est inscrite en tête de
l'ordre du jour d’aujourd’hui.
L Chambre aura cette fois à formuler un
vote décisif d’acceptation ou de rejet. Le pro
blème a été pesé par le Sénat dans des ter-
mes qui ne permettent plus à la Chambre de
se dérober.
Le projet qui lui est soumis limite par
commune à 3 pour 600 habitants et au-des
sous et à 1 par 200 habiants au-dessus de ce
chifire le nombre des débits, cafés, cabarets
où l’on consomme sur place et où l’on vend
de l’alcool. Aucune déclaration d’ouverture
ne pourra être faite tant que cette réduction
ne sert-pas réalisée. Cette mesure ne porte
donc atteinte qu’aux intérêts des débitant
futurs, non existants encore.
Dans son rapport M. Jules Siegfried insist
sur la progression effrayante de la consom
mation alcoolique. D’après les documents
offi iels elle est passée de 1 litre 43 par tête
en 1830 à 4 litres 06 en 1911. Si on y ajouta
les quantités qui par le privilège des bouil
leurs de cm, échappent au contrôle, on peut
évaluer à 5 litres d’alcool pur la consomma
tion moyenne par tête, ce qui correspond à
43 litres de spiritueux du commerce.
M. Jules Siegfried montre que la progres
sion du nombre des débits est corc imitante
au développement de l’alcoolisme. Ei Fran
ce le nombre des débits a passé de 330,000
en 1879 à 480 000 en 1909. On compte dans
notre pays un débit par 82 habitants au lieu
de un par 246 habitants en Allemagne, par
360 habitants aux Etats-Unis, par 430 en An
gleterre, par 5.000 en Suède, par 9,000 en
Norvège. Encore ces chiffres sont-ils des
moyennes. Car en France la p report on s’é
lève à un débitpour 22 adultes dans la Seine-
Inférieure, pour 45 adultes dans le Nord,
pour 41 adultes dans l’Eure.
Si la Chambre ratifie la mesure adoptée
par la Sanat, le nombre total des débits de
boissons s’abaissera par extinction de
480.000 à 180,000. « Qui pourrait soutenir,
écrit M. Jules Siegfri d, qu’un pareil résul
tat, même avec le temps qu’il exigera, serait
sans effet pour la lutte contre l’aicoolisme ?
Il est incontestable que la limitation du
nombre des débits est la condition première
de toute mesure contre l’alcoolisme.
A la Commission des
Affaires extérieures
La Commission des affaires extérieures a
Chargé M. Henry Simon, député du Tarn, du
rapp rt sur le projet de loi relatif à l’établis-
sement d’un port charbonnier à Papeete
(Tahiti) en vue de ‘ouverture du canal de
Panama.
M. Amiard a été nommé rapporteur de
l’emprunt de l’Afrique équatoriale française.
La Réduction du nombre
des Députés
Ou sait que la Chambre a voté lundi un
nouvel article 3, qui, dans le projet de ré-
forme électorale, prend la place de l'article
de la commission. D’après la bise nouvelle
de 22 500 électeurs, qui a été adoptée sur
l’initiative de M. Maginot, pour déterminer
le nombre de sièges auxquels chaque dépar
tement a droit, il v aura au total 527 dépu
tés, au lieu de 597, soit une diminution de
70 sièges. . . ,
Trente-trois départements conservent le
même nombre de députés qu’actuellement.
Ce sont :
Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Cher,
Creuse, Dordogne, Gid, Haute-Garonne, Hérault,
I ère, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-life
rieure. Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine
et-Loire, Manche, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute
Saône, Sarthe, Haute-Savoie, Doux Sevres, Som
m i, Tarn et-Gironne, Var, Vauciuse, Vendée,
Haute-Vienne.
Perdent un député, les départements sui
vants :
Ain, Aisne, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône,
Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze
Corse, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Eure et-Loir,
Gers, Gironde, Lle-et-Vilaine, Indre, Landes-
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nievre
Nord, Oise, One, Pas-de-Calais, Pyrénées mu‘
tesk Pyrénées Orientales, Saône-et Lire,
I féricwe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Vienne, Yonne.
Perdent deux députés, les département
suivants :
Alpes (Basses-), Ardennes), Calondos, Sotes-da
Nord, Eure, Finistère, Meuse Marne, 4 Yren-e
(Basses), Savoie, Vosges.
N 11,812
(€ Pages)
6 Centimes
EDITION DU MATIN
SS
S Centimes
(6 Pages)
Administrateur * Délégué
O. RANDOLET
presser tout ce qui concerne l’Administratios
fi M. O. RANDOLET
SS, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havre
Administration; Impressions et Aunonces, T®. 10.47
AU HAVRE
A PARIS
BUREAU du Journal, 118, boni* de Strasbourg.
L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Jeudi 20 Novembre 1913
========= ================= =========
Rédacteur en Chef. Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
Auresser tout ce qui concerne la Rédaction
a M. HIPPOLYTE FÉNOUX
85, Rue Fontenelle, 35
téléphone : Rédaction, No 7.66
£s PETIT HA VRE est désigné pour les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
.
| ABONNEMENTS
! Le Havre, la Seine-Inférieure, l’Eure ,
l’Oise et la Somme
Autres Départements...
Union Postale
| Trois Moisi Six Mois
Un As
6
10
50
p».
• Fr.
as tc
1 @
2s
Fr.
^^^J^ a!emont ’ r s ^NS FR.ns, dens tous tas Baransx ds es E
20 Fr.
48%
DEPECHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 19 Novembre, Dépêche de 4 h. 30
CUIVRE
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
Comptant.
calme
£ 68 7/6
-b
22/6
3 mois
£ 66 L 6
5/-
ETAIN
Comptant .
calme
£181 18/-
-1-
-/-
3 mois
£ 182 15/-
-i-
5/-
FER j
Comptant ..
calme
■
£ 49/1 %
2 % d
V-
3 mois.... ;
£ 49/10 %
23d
-/-
Prix comparés avec ceux de la deuxième Bourse
du 18 novembre 1-43.
du ComMerce et de l'Industrie
DISCOURS DS M PABTHOU
- Le Comité républicain do Commerce et de
l’Industrie donnait hier soir son grand ban-
quel annuel, sous la présidence de M. Louis
Barthou.
. Le grand nombre de convives témoignait
de l’importince de plus en plus grande. prise
par le Comité.
Hier soir, le banquet ne comprenait pas
moins en effet, de 1,800 couverts.
Toutes les sections de province avaient
envoyé des délégués et les membres du Par-
lement avaient en grand nombre accepté
l’invitation qui leur avait été adressée.
M. Barthou avait à sa droite MM. Antonin
Dobost, président du Sénat et Ratier, garde
des sceaux; il avait à sa gauche MM. Mas-
curaud, président du Comité républicain du
commerce et de l’industrie et Paul Deschanel,
président de la Chambre des députés.
A la table d’honneur avaient pris place
tous les ministres et les sous-secrétaires
d’Etat.
Au champagne, M. Mascuraud a prononcé
un discours dans lequel, écartant pour un
soir les problèmes d'actualité politique, il a
analysé l'œuvre sociale de la République.
« Les membres de notre Association, a dit
M. Mascuraud, souhaitent que le gouverne-
ment poursuive l’œuvre d’assainissement,
moral et matériel entreprise contre le
taudis.
» Ils admettent que la surveillance du
travail à domicile ex ge l’intervention de la
loi. Ils espèrent enfin que le Parlement aura
l’énergie d’achever la loi sur les syndicats
professionnels. »
M. Mascuraud a ensuite exprimé l’espoir
que la pénétration pacifique au Maroc four-
nisse bientôt au pays une légitime compen-
nation à ses sacrifices en hommes et en ar
gent.
Concernant le rapprochement franco-es-
pagnol, il dit :
« Vous n’ignorez pas que cette fois encore,
nous nous sommes efforcés à Madrid et à
Paris de seconder, dans la mesure de nos
moyens, les efforts du gouvernement. »
L’orateur termine en exprimant sa con
fiance dans l’avenir de la France et de la Ré
publique laïque et démocratique qui consti
tue ia plus etonnante expérience politique
de l’humanité.
* «
v M. Barthou, président du Conseil, a pris la
parole après M. Mascuraud.
En acceptant l’invitation du Comité, il a
voulu, dit-il, apporter à une grande assem-
blée politique et économique dont on n’a
plus a compter les services, le témoignage
de sa gratitude et de sa sympathie.
M. Barthou sera ‘interprète des senti-
Zuents des assistants auprès du président de
la République.
Dans un pays de liberté, sous un régime
républicain, une élection présidentielle ne
peut ni ne doit laisser derrière elle ni les re
présailles de la victoire, ni les ressentiments
de la défaite.
En dehors des partis, au-dessus de tous les
partis, le président de la République n’a pas
de responsabilite qui lui est propre ; il est le
gardien r espectueux et fidèle de ia Constitu
tion.
Le gouvernement est responsable devant
la Chambre et le Sénat et M. Barthou est cer
tain qu’on lui rendra cette justice qu’il n’a
jamais été un homme à éluder ou esquiver
les responsabilités de sa fonction.
Le president du Conseil rappelle que le
Cabinet qu’il a l'honneur de présider a eu
des débuts laborieux et depuis ses adversaires
n'ont cessé de lui faire la vie dure.
M. Barthou se félicité de la réorganisation
du parti radical et radical socialiste ; il don-
nera plus de clarté à la po itique générale.
Mais il s’étonne de n’avoir pas été inter
pellé sur la politique générale du Cabinet
dès la rentrée des Chambres. C’est seulement
hier qn'ane démarche de cette nature a été
déposée par M. Breton.
Le gouvernement ne sera pas embarrassé
pour répondre.
M. B irthou déclare que la défense de l’Eco
le laïque doit réunir tous les républicains
dans une même intention et une même es
pérance.
A aucun moment il n’a pu constater de la
part du gouvernement une hésitation, une
défaillance, une complaisance coupable.
Dès lundi prochain, l’orateur sera à la
Chambre pour soutenir avec l'ensemble du
Parti républicain, les lois qu’il juge néces
saires afin d’assurer à l’École laïque une dé
fense indispensable.
Le gouvernement n’a pas davantage dé
serté son programme social.
Les lois votées ou proposées sont une né
cessité et un devoir, surtout pour un régi-
me républicain.
En faisant voter la loi de trois ans, nous
avons eu de notre devoir une conception qui
nous a conduit à demander au Parlement et
au pays un sacrifice qui nous paraît néces-
saire.
; J’ai dit encore et c’est la conviction pro
fonde de tous les membres du cabinet, que
‘les conséd uences de cette loi uni a augmed-
PARIS, TROIS HEURES MATIN
NOUVELLE ETAPE
NEW-YORK, 19 NOVEMBRE
Cetens: décembre, baisse 12 points; jan
vier, baisse 8 points ; mars, baisse 8 points ;
mai, baisse 7 points. — A peine soutenu.
Calés : hausse 10 à 19 points.
NEW-YORK, 19 NOVEMBRE
Cuivre Standard disp.
— janvier
Ammalgamat. Coy...
J. 29 MSI
70 3 8
15 37
C. PRZCEDEX?
14
15
70
15
50
50
7,8
75
CHICAGO, 19 NOVEMBRE
Blé sur.....
Décembre.
Mai
c. au jour
86 3 '8
9) 7/8
a. PREGED
85 3 4
90 3 8
Maïs sur
Déceinbre.
71 -/»
70 1 2
--===
Mai
71 n/»
70 5 8
Saindoux sur.
Janvier...
2: 02
10 90
—
Mai
H 22
14 10
té la défense nationale du pays, doivent être
supportées par la richesse acquise.
Mais ces dépenses présentent un caractère
de dépenses temporaires non renouvelables;
c’est pour cela que le cabinet a pensé avec le
ministre des finances que seul un emprunt
de liquidation pourrait faire face à ces dé
penses.
Nous avons déposé un projet d’emprunt ;
nous le défendrons et nous n’hésiterons pas
f à engager noire responsabilité !
Le président du Conseil promet au nom
dn gouvernement d’agir auprès de la Com-
mission sénatoriale pour faire aboutir le pro
jet d’impôt sur le revenu.
Le gouvernement ne veut pas d’une ré
forme qui soit une aventure et qui provoque
dans le pays uns véritable révolution.
La réforme ne sera possible qu’à condition
de respecter le secret des fortanes et des af
faires.
Le président du Conseil explique encore
les raisons qui l’ont poussé à faire voler la
loi de trois ans.
« Ce n’est pas une loi de provocation ;
nous n’avons fait que répondre à des arme-
ments par d’autres armements.
» Messieurs, est-il un pays dans lequel la
paix soit plus néce saire et plus unanime-
ment désirée que uans la démocratie fran
çaise ?
» Cette paix, depuis un an, a été assurée à
travers bien des difficultés et des périls.
Mais, à l’heure actuelle, il est permis de res
pirer et les points douloureux s’atténuent ou
di-p Taisseut. .,
» Je peux dire que nous sortons d’une ère
de troubles et de malaises.
» Dans tous les pays, il faut que ceux qui
peuvent p rler au nom des intérêts généraux
de ces pays pèsent sur leur Gouvernement
pour qu’on en finisse avec un malaise qui,
troublé et paralyse les affaires.
» Cette paix du Monde, nous continuerons
à y contribuer.
». Monsieur Mascuraud parlait de frater
nité humaine. C’est un rêve auquel je m’as
socie. Mais quand cette fraternité abaissera-
t-elle les frontières ?
» En attendant, il faut préconiser la soli
darité française.
» Je bois au Comité républicain du Com-
merce et de l’Industrie 1 »
La Seconde Ligne
du Havre à Paris
Sur h proposition de M. Lemarchand, le
Cons il général de la Seine a émis le vœu
que la traversée de la ligne de chemin de
fer du Havre, sur la ligne de Serquigny à
Rouen, avec raccordement à Pont-de l'Ar-
che, entre les lignes de Serquigny à Rouen
et du Havre à Paris, soit effectuée au moyen
d’un passage souterrain et que le proj t de
viaduc actuellement soumis à la Chambre
soit défiaitivemeat écarté.
MEETING ANTIMILITARISTE
Le meeting o ganisé par l’Union des Syn
dicats de la Seine et le Comité Confédéral
p ur protester contre le procès du « Sou du
Soldat » a eu lieu hier après-midi rue Saint-
Paul.
Les assistants étaient nombreux.
Des discours antimilitaristes violents ont
été prononces, puis l’assemblée a adopté un
ordre du jour protestant contre le procès de
tendance intenté aux militants et a adressé
son salut fraternel aux inculpes.
La sortie s’est effectuée sans incidents.
CONDAMNATIONS
AUX TRAVAUX FORCÉS
Blois. — Le nommé Marcel Normantqui,
le 29 janvier et le 2 mars, tenta d’assassiner
deux vieillards pour les voler, a été condam
né à quinze ans de travaux forcés.
TROYES. — Le nommé Paul Lapon qui, le
2 a ût dernier, incendia des bâtiments agri
coles aux Chênes, vient d’être condamné à
dix ans de travaux forcés.
EXPLOSION DANS UNE MINE
Birmingham. — 24 hommes ont été tués
mardi soir a la suite d’une explosion dans
une mine de charbon.
•-==-%=-====
DE PARIS AUX BALKANS EN BALLON
Constantinople. — Les aeronautes Schnei-
der, Pierron et Bienaimé sont arrivés à
Constantinople.
Ils ont franchi en un seul vol une distance
de deux mille kilomètres environ.
Le sphérique Icare bat ainsi le record
français de durée.
armrencsnn@2FBnrwesce
LFS TROUBLES AU MEXIQUE
NEW-YORK.— Suivant un télégramme de
Mexico, l’ambassadeur américain aurait reçu
dans la matinée de M. Bryan une dépêche
annonçant qu’une mesure de nature grave
relative au Mexique était à l’étude à W as-
hing ton,
LA
Réforme électorale en Marche
La Chambre en a fini avec la réforme
électorale. Elle a voté l’ensemble par 333
voix contre 225.
C’est ce texte qui va être soumis au Sé
nat comme le dernier mot de la transaction
possible.
Le président de la Commission, M. Fer
dinand Buisson, a tenu, avant le vote final,
à préciser la portée du projet élaboré par la
Chambre. Il a rappelé l’historique de la
discussion, au cours de laquelle, par trois
fois déjà, a été affirmée la volonté de rem
placer le scrutin d’arrondissement par le
scrutin de liste. L’opinion adverse n’a pu
réunir plus de GG voix.
Ce sont ceux que l’orateur appelle ironi
quement « les hommes de bronze ».
Et il se sert, pour les mettre au pied du
mur, d’un document tout neuf, émané à la
{ dernière heure de M. Combes lui-même :
■ car le « petit père » vit encore, et dans une
oraison funèbre magistrale, il a voulu se
charger d’enierrer la représentation des mi
norités par cette prase lapidaire :
Peut-être, écrit-il, n‘ess-il pas sans incon
vénient, ni même sans danger, qu’une
Assembiéee élue par le suffrage anversel ne
compte dans son sein que des mandataires
du peuple imbis des mêmes idé6s et aninlés
des mêmes passions, et ne serait-il pas mai-
séant, tant pour l’Assemblée que pour la
nation elle-même, qu’à côté de la majorité
sortie du suffrage populaire, la minorité dis-
posât de quelques sièges et pût foire enten
dre sa voix dans les débats qui mettent en
jeu les intérêts du pays.
« A-t-on jamais rien écrit de plus mé
prisant pour la démocratie, rien de plus
césarien, de plus oligarchique ! » s’écrie
M. Buisson.
« Convenir qu’il n’est pas malséant d’ac
corder quelques sièges à la minorité, c’est
lui faire une aumône. Nous n’en voulons
pas ! Nous voulons des parts égales entre
gens ayant des droits égaux !
» Vous vous prétendez partisans de la
représentation des minorités, et quand
nous vous demandons laquelle, vous ré
pondez : < Celle que nous voudrons bien
» leur accorder. »
» Ces paroles de M. Combes feront plus
que tous nos discours pour éclairer le
pays. »
En somme, dit M. Buisson pour se résu
mer, le projet de loi voté par la Chambre
n’accorde aux minorités que la part des
droits évidemment acquis,qu’on ne pouvait
leur enlever sans un déni de justice, contre
lequel la France entière protesterait.
Le Sénat ayant lui-même condamné le
scrutin d’arrondissement et adopté le scru
tin de liste départemental, il ne reste plus
de raison pour que l’accord avec la Cham
bre ne soit prompt et définitif,sur une forme
transactionnelle de représentation des mi
norités.
Plus de cinq mois nous séparent encore
des élections, c’est un délai suffisant pour
clarifier la situation, pour voler la réforme
et l’appliquer en mai prochain.
HIPPOLYTE FÉNOUX.
I
LA COMMISSION DU BUDGET
La Commission du budget a entendu la
fin de l’exposé du rapporteur général sur
‘emprunt et l’équilibre du budget.
M. Noullens a successivement examiné les
dépenses extraordinaires de la guerre aux
quelles l’emprunt doit pourvoir, les besoins
du budget qui se trouvent en corrélation
avec l’emprunt, la situation de la dette, les
caractères de l’emprunt proposé, la combi
naison d’amortissement et la question de
l’annuité de la rente.
La conclusion a été que l’emprunt se
(rouve plutôt inférieur aux besoins auxquels
le gouvernement aura à faire face.
Après lui, M. Ju es Roche a demandé à la
Commission de prendre une décision de
principe sur l’emprunt.
M. Raiberti a défendu le projet du gouver-
nement.
MM. Augagneur, Thomas, Malvy, Piou et
de Mon ont déclaré se refuser a accepter
qu’une part de l’emprunt alimente le compte
provisionnel et partant à subvenir au déficit
du budget.
Sur la proposition de M. Cocbery, la Com
mission a accepté par 28 voix contre 6 de
passer à la discussion des articles du projet
sous la réserve rappelée par MM. Malvy et
Gheusi qu’elle examinera en même temps
que l’emprant la taxe sur le capital.
Par 28 voix contre 4, la Commission a en-
suite adopte le principe de 1 emprunt pour
f ire face aux dépenses extraordinaires
de la guerre dont le gouvernement fera
connaître le chiffre exact.
M. Augagneur a alors proposé de limiter
l’emprunt et son usage.
Cette proposition a été votée par 48 voix
contre 13.
La Commission a ensuite reporté sa séance
à aujourd’hui, pour entendre le Gouverne
ment sur le chiffre de l’emprunt, pour l’exa-
men de la taxe sur le capital et la continua
tion de l’examen de l’emprunt.
LES AFFAIRES D'ORIENT
La Délimitation de l’Albanie du Nord
Belgrade, 19 novembre.
On se plaint ici de ce qu’un certain Datz,
Albanais, a réuni une bande armée qui pré
cède la commission internationale de déli
mitation de la frontière de ‘Albanie du
Nord et oblige par intimidation et même par
la violence les habitants albanais et Serbes
à déclarer vouloir être incorporés a 1 Al-
■ banie.
UNE TAXE
SUR LA
Plus -Value Immobilière
II
La plus-value immobilière ne pro
vient pas seulement des travaux publics :
le mouvement de la population en est une
source aussi fréquente. G est pourquoi M.
Génestal a donné à son Mémoire, soumis
au Congrès des maires, une portée plus
générale que la loi de 1807, et c’est pour
quoi il a demandé le vote, par le Parlement,
de dispositions analogues à celles qui sont
en vigueur depuis quelques années en Alle
magne et en Angleterre.
Toutefois, les systèmes allemand ou an
glais peuvent-ils être envisagés en France ?
Le problème a été discuté par la Commis
sion de législation fiscale, il a été posé par
le ministre des finances, devant le Parle
ment, à l’occasion du budget de 1912, enfin
une proposition de loi de M. Ajam, déposée
le 10 juin 1912, a précisé le débat en le
faisant porter sur des dispositions con
crètes.
Avant d’étudier ce projet très intéressant,
qui s’inspire de la législation allemande,M.
Génestal expose les législations allemande
et anglaise, d’après une étude très savante
de M. William Oualid, chargé de conféren
ces financières à la Faculté de droit de Pa
ris. Il a également utilisé les documents
qui.lui ont été obligeamment communiqués
par le Musée social.
Nous ne saurions suivre le Rapport que
nous analysons dans tous ses détails. Conten
tons-nous de rappeler brièvement quelques
faits. C’est en Angleterre que, le premier,
Stuart Mill déduisit de la notion de rente
toutes les conséquences économiques et fi
nancières qu’elle comporte, et proposa de
prélever, après évaluation préalable, toute
plusvalue non gagnée, c’est-à-dire aitribua-
ble à des causes étrangères à l’activité du
propriétaire ; c’est en Amérique qu’Henry
George s’attacha plus spécialement à la
rente urbaine, à la plus-value du sol des
villes ; c’est en Allemagne que la multipli
cité des budgets à alimenter provoqua pour
la première fois, en Europe, la création de
la nouvelle taxe qui, d’impôt local est de
venu impôt fédéral d’Empire.
En Angleterre, en 1910, malgré l’oppo
sition des lords, un budget qui comportait
la création d’une imposition sur « la plus-
value strictement non gagnée » fut pro
mulguée.
Avec l’expérience faite en Australasie,
mais en des conditions qui ne sauraient
avoir leur équivalent en Europe, telles pa
raissent être les seules applications faites
jusqu’ici de la théorie de l’imposition des
plus-values immobilières.
* $
Pour justifier la théorie de l’imposition
des plus-values immobilières, les raisons
excellentes ne manquent pas.
Quand on envisage, en effet, les plus-va
lues considérables réalisées par certains
propriétaires urbains, sans aucun effort de
leur part ; quand on constate que des ter
rains, laissés exactement en l'état primitif,
ont haussé de valeur dans de très notables
proportions ; quand on assiste à une aug
mentation de loyers de tout un quartier,
uniquement par suite de la mise en exploi
tation d’une nouvelle ligne de communi
cation, — comment ne pas conclure que la
société, la communauté, a le droit de préle
ver au moins une partie de celle plus-
value ?
Certes, dit M. Génestal, ce prélèvement
peut varier à l’infini depuis la théorie ex-
provriairice de Henry Georgeproposant de
percevoir, au profit de la communauté, toute
la plus-value, jusqu’aux prélèvements ré
duits à une faib e portion de l’excédent non-
gagné. Grâce à l’accroissement de la popula
tion, aux progrès de la richesse, à l'activité
grandissante des autorités municipales ou de
l'Etat, les terrains — et particulièrement les
terrains urbains — augmentent de valeur
sans que les propriétaires y aient le moins
du monde contribué par leurs efforts. N’est-
il pas juste que la société récupère, sous
forme d’impôt, cette plus-value non gagnée
dont elle est la créatrice et la source ?
L’imposition des plus-values immobilières
correspond, d’ailleurs, parfaitement à la
notion moderne de la justice fiscale.
Elle aurait le mérite de mettre un terme
aux spéculations sur les variations de prix
des immeubles et particulièrement des ter
rains, spéculations le plus souvent néfastes
et qui revêtent deux formes principales : im
mobilisation prolongée du sol entre les mê-
mes mains, le détenteur laissant son terrain
grandir de valeur pendant qu’il sommeille,
tandis que la population croissante doit se
contenter d'an espace de plus en plus res
treint — ou bien multiplication intense d’o
pérations de tous ordres : ventes, constitu
tion d’hypothèques multiples entraînant des
pertes énormes pour les prêteurs et pour
les entrepreneurs.
D’autre part, l’impôt sur les plus-values
constitue un moyen de faire fice aux be
soins grandissants des municipalités notam
ment, et aux dépenses de travaux publics et
d'amélioration de tout ordre dont profitent
en grande partie les propriétaires fonciers.
Il pourrait aboutir à une diminution des
droits de mut lion immobilière, droits qui
frappent indifféremment toutes les trans
missions immobilières, opérées ou non dans
un but de spéculation, que l'aliénateur réa
lise ou non.ua bénofice, et droits qui s’op-
po ent souvent par leur élévation à un trans
fert utile de certains immeubles.
Certes l'imposition des plus-values a don
né lieu à des objections que l’auteur du
Mémoire ne méconnaît pas, mais qu’il exa
mine. On a dit que cette imposition consti
tuerait une véritable expropriation ; on a dit
aussi que l’imposition de la plus-value im
pliquerait une contre-partie : l’obligation
pour la société de compenser en tout ou
partie les moins-values. Autant la première
objection est spécieuse et sans fondement,
autant la seconde mérite qu’on s’y arrête
et, d’ailleurs, on ne peut invoquer contre
elle aucune raison d’ordre juridique. Mais,
ajoute le Rapport, on peut lui opposer de
sérieuses considérations d’opportunité et de
nécessité pratique : tandis que l’imposition
des plus vaines semble devoir se garantir
assez aisément contre la fraude, l'indemni-
sation des moins-values prêterait beaucoup
plus aux collusions. D’autre part, l'impo-
sition ne portant que sur partie de la plus-
value, la marge de profit laissée aux pro
priétaires constitue une compensation très
suffisante aux moins-values éventuelles.
La troisième critique est d'ordre plus
particulièrement financier. Elle est résu
mée et réfutée en ces termes :
Si l’impôt sur las plus-values a pour but
d’aboutir à une diminution des fluctuations
de c-tte valeur, dans le sens d’une moindre
progression, il y a tout lieu de craindre —
dit-on — qu’il obtienne le résultat inverse,
à savoir de provoquer une h nisse de cette
valeur, le vendeur rejetant l’impôt sur l’ache-
tear qui en resterait ainsi le débiteur final.
En effet, les propriétaires ne supporteront
‘impôt que si leur situation économique ne
leur permet pas de le rejeter sur d’autres.
Mais l’objection n’a pas autant de portée
qu’il put paraître au premier abord, car les
avantages de l’impôt, au point de "Vue des
abus de la spéculation et de la hausse im-
modérée de la valeur des immeubles, sem
blent devoir compenser les inconvénients
de la répercussion que voudrait éviter le lé- [
gislatear.
Le Rapport examine ensuite la façon
dont il faut appliquer le principe de la plus-
value. Il détermine le moment où il con
vient de se placer pour estimer cette plus-
value ; il pose en principe que le fisc ne
peut saisir toute plus-value, si minime soit-
elle, et il établit la marge de profit laissée à
l’initiative et à la spéculation individuelle,
en abandonnant une marge plus élevée à
la propriété bâtie; il prévoit certains cas
d’exemption ; enfin il envisage le taux de
l’impôt, estimant avec les législateurs et les
théoriciens que l’impôt des plus-values sur
la grande propriété peut s’élever jusqu’à
35 et même 50 0/0 de la valeur de ces
plus-values. Ainsi le propriétaire conserve
encore la moitié ou les deux tiers d’un
excédent à la production duquel il est
étranger. Peut-être la progressivité pour
rait-elle être employée ici, sa souplesse
permettant de mieux réaliser le but re
cherché.
«En résumé, ditM. Génestal, l’imposition
des plus-values immobilières, justifiée en
principe, doit obéir, dans l’application, aux
règles suivantes : N’atteindre que la plus-
value non gagnée, celle-ci étant déterminée
grâce à certaines déductions opérées sur la
plus-value absolue, et la frapper d’un im
pôt progressif ou dégressif, plutôt que d’un
impôt proportionnel, suivant les contin
gences actuelles et locales. Dans la fixation
du taux, comme dans l’assiette de l’impôt,
il y a lieu de tenir compte de la nature
même des propriétés imposées et de sou
mettre à un régime différent les propriétés
bâties et les propriétés non bâties. »
Ayant étudié avec soin le fonctionnement
de cette taxe nouvelle en Allemagne et en
Angleterre, l’auteur du Rapport en conclut
que « l’imposition des plus-values foncières
n’est plus, comme on le soutenait autrefois,
et comme l’affirment encore ses adversaires,
une utopie irréalisable ». Sans doute, dit-
il, elle poursuit autant une fin sociale
qu’un but purement financier, mais elle
paraît se tenir aussi éloignée du non inter
ventionnisme du libéralisme économique
que de l’expropriationisme fiscal d’Henry
George.
* *
L’impôt sur la plus-value, qui a fait ses
preuves en Allemagne, a ses avantages: il
a aussi ses défauts, et c’est pourquoi le
législateur ne devra pas se départir d’une
certaine prudence. Mais il apparaît bien
que la législation française peut entrer
sans inconvénient dans la voie que lui ont
tracée les législateurs allemands et anglais.
C’est ce que demandait M. Ajam en dépo
sant, le 10 juin 1912, une proposition de
loi ayant pour objet la création d’un impôt
sur la plus-value sociale, et que le Rapport
analyse parallèlement avec les lois étran
gères.
Ce projet de M. Ajam, on doit l’approu-
ver dans ses dispositions principales ; mais
on estimera cependant qu’il devrait être
amendé sur plusieurs points. C’est ainsi
que le produit de l’impôt, entre l’Etat et la
Commune, devrait se répartir par moitié.
Peut-être même la Commune devrait-elle
être avantagée, puisque c’est surtout à
l’activité communale que, le plus souvent,
l’immeuble doit sa plus-value.
Telle est, dans son ensemble. l’importan
te et intéressante élude de M. Génestal.
Elle a servi de base à une discussion ap
profondie au Congrès des Maires tenu à
Paris, il y a quinze jours, — et elle a moti
vé l’expression du vœu suivant formulé à
l’unanimité :
« Le Congrès des Maires... émet le
vœu :
» Que le Parlement crée au plus tôt une
taxe sur la plus-value immobilière et
abandonne aux Communes la plus large
part de cette taxe ;
» Subsidiairement, et en attendant le
vote de la loi créant l'imposition ci-dessus,
que le Parlement-simplifie la procédure
instituée par J . loi de 1807 en cas de plus-
value résultant de l'exécution des travaux
publics, de telle sorte que la loi devienne
facilement applicable. »
s
* «
Ainsi que le disait très justement M, Gé-
nestal, dès le début de son Mémoire, les
charges sans cesse croissantes qui sont im
posées par l’Etat aux Municipalités, de mê
me que les sacrifices spontanés que celles-
ci consentent pour l’assistance publique,
l’assainissement, la voirie, leur font une né>
cessité de rechercher de nouvelles ressour
ces. C’est pourquoi il est indispensable que
le Parlement réalise le vœu formulé par le
Congrès des Maires.
Une question qui, à l’heure actuelle,
préoccupe au plus haut point les Municipa
lités des grandes villes est celle des Habita
tions à bon marché.
Or les Municipalités ne trouveraient-
elles pas, dans celle taxe sur la plus-value
immobilière, les ressources nécessaires et
qui, jusqu’ici, dans la plupart des cas,
leur font défaut ? Et pourrait-il exister une
affectation plus naturelle d’une partie tout
au moins de cette taxe nouvelle?
Cette idée ingénieuse vient d'être émise
au cours d’une enquête sur la Crise des
loyers et sur la question des Habitations à
bon marché. Elle était implicitement con
tenue dans le Mémoire de M. Géneslai.
Tu. Vallée.
Nouvelles de la Chambra
La Limitation des Débits d’Alcoox
Rapport de M. Jules Siegfried
La question de la limitation du nombre
des débits de boissons est inscrite en tête de
l'ordre du jour d’aujourd’hui.
L Chambre aura cette fois à formuler un
vote décisif d’acceptation ou de rejet. Le pro
blème a été pesé par le Sénat dans des ter-
mes qui ne permettent plus à la Chambre de
se dérober.
Le projet qui lui est soumis limite par
commune à 3 pour 600 habitants et au-des
sous et à 1 par 200 habiants au-dessus de ce
chifire le nombre des débits, cafés, cabarets
où l’on consomme sur place et où l’on vend
de l’alcool. Aucune déclaration d’ouverture
ne pourra être faite tant que cette réduction
ne sert-pas réalisée. Cette mesure ne porte
donc atteinte qu’aux intérêts des débitant
futurs, non existants encore.
Dans son rapport M. Jules Siegfried insist
sur la progression effrayante de la consom
mation alcoolique. D’après les documents
offi iels elle est passée de 1 litre 43 par tête
en 1830 à 4 litres 06 en 1911. Si on y ajouta
les quantités qui par le privilège des bouil
leurs de cm, échappent au contrôle, on peut
évaluer à 5 litres d’alcool pur la consomma
tion moyenne par tête, ce qui correspond à
43 litres de spiritueux du commerce.
M. Jules Siegfried montre que la progres
sion du nombre des débits est corc imitante
au développement de l’alcoolisme. Ei Fran
ce le nombre des débits a passé de 330,000
en 1879 à 480 000 en 1909. On compte dans
notre pays un débit par 82 habitants au lieu
de un par 246 habitants en Allemagne, par
360 habitants aux Etats-Unis, par 430 en An
gleterre, par 5.000 en Suède, par 9,000 en
Norvège. Encore ces chiffres sont-ils des
moyennes. Car en France la p report on s’é
lève à un débitpour 22 adultes dans la Seine-
Inférieure, pour 45 adultes dans le Nord,
pour 41 adultes dans l’Eure.
Si la Chambre ratifie la mesure adoptée
par la Sanat, le nombre total des débits de
boissons s’abaissera par extinction de
480.000 à 180,000. « Qui pourrait soutenir,
écrit M. Jules Siegfri d, qu’un pareil résul
tat, même avec le temps qu’il exigera, serait
sans effet pour la lutte contre l’aicoolisme ?
Il est incontestable que la limitation du
nombre des débits est la condition première
de toute mesure contre l’alcoolisme.
A la Commission des
Affaires extérieures
La Commission des affaires extérieures a
Chargé M. Henry Simon, député du Tarn, du
rapp rt sur le projet de loi relatif à l’établis-
sement d’un port charbonnier à Papeete
(Tahiti) en vue de ‘ouverture du canal de
Panama.
M. Amiard a été nommé rapporteur de
l’emprunt de l’Afrique équatoriale française.
La Réduction du nombre
des Députés
Ou sait que la Chambre a voté lundi un
nouvel article 3, qui, dans le projet de ré-
forme électorale, prend la place de l'article
de la commission. D’après la bise nouvelle
de 22 500 électeurs, qui a été adoptée sur
l’initiative de M. Maginot, pour déterminer
le nombre de sièges auxquels chaque dépar
tement a droit, il v aura au total 527 dépu
tés, au lieu de 597, soit une diminution de
70 sièges. . . ,
Trente-trois départements conservent le
même nombre de députés qu’actuellement.
Ce sont :
Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Cher,
Creuse, Dordogne, Gid, Haute-Garonne, Hérault,
I ère, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-life
rieure. Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine
et-Loire, Manche, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute
Saône, Sarthe, Haute-Savoie, Doux Sevres, Som
m i, Tarn et-Gironne, Var, Vauciuse, Vendée,
Haute-Vienne.
Perdent un député, les départements sui
vants :
Ain, Aisne, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône,
Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze
Corse, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Eure et-Loir,
Gers, Gironde, Lle-et-Vilaine, Indre, Landes-
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nievre
Nord, Oise, One, Pas-de-Calais, Pyrénées mu‘
tesk Pyrénées Orientales, Saône-et Lire,
I féricwe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Vienne, Yonne.
Perdent deux députés, les département
suivants :
Alpes (Basses-), Ardennes), Calondos, Sotes-da
Nord, Eure, Finistère, Meuse Marne, 4 Yren-e
(Basses), Savoie, Vosges.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 84.04%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 84.04%.
- Auteurs similaires Fénoux Hippolyte Fénoux Hippolyte /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Fénoux Hippolyte" or dc.contributor adj "Fénoux Hippolyte")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/6
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t52638640q/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t52638640q/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t52638640q/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t52638640q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t52638640q
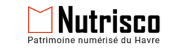


Facebook
Twitter