Titre : Le Réveil du Havre : organe républicain ["puis" organe républicain-socialiste indépendant "puis" organe du Parti républicain démocratique]
Éditeur : [s.n.] (Le Havre)
Date d'édition : 1900-08-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32854639q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 25 août 1900 25 août 1900
Description : 1900/08/25 (N226). 1900/08/25 (N226).
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k3263425v
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-89667
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/05/2019
5 e Année—lü # 226
CINQ CENTIMES LE NUMERO
Samedi 25 Août 1806.
I
Organe du Parti Républicain Démocraxii^ue
PRIX DES ABONNEMENTS
Le Havre et la Seine-Inférieure par an
Départements »
ADMINISTRATION ET RÉDACTION
15, RUE GASIMIR-PÉRIER,
Secrétaire de la Rédaction Alfred HENRI
L’Imprimeur-Gérant F. LE ROY
Prix des Insertions
Annonces 25 centimes la ligne
Réclames . 50 »
On traite à forfait
L’UNE DES FONCTIONS
de la richesse
Certains partis font de la lutte des
classes la base de leur action. En d’au
tres termes, ils opposent ceux qui
n’ont rien à ceux qui possèdent. Ils
pourraient dire aux premiers de con
quérir, à force de travail et de volonté,
une place parmi les seconds ; ils pré
fèrent un état violent susceptible de
dégénérer en guerre civile.
_ La passion sur laquelle spéculent
ainsi ces réformateurs n’a rien de!
bien honorable, elle s’appelle l’envie
et compte fort justement au nombre
des péchés capitaux. Péché bas et sans
relief, qui ne rachète aucune qualité
correspondante. L’envie n’engendre
que la haine, elle rend l’homme à la
lois malheureux et méchant, elle lui
met dans l’âme un vice méprisable
dont il ne guérira jamais, car celui
qui en est atteint trouvera toujours
un nouvel aliment à sa passion.
En supposant qu’il soit parvenu à
la puissance et à la richesse qui sont
les deux choses les plus recherchées
en ce monde, il sera encore jaloux de
la joie des autres, du bonheur qu’il
sera incapable d’acquérir. Une juste
fatalité le condamnera à souffrir toute
sa vie.
L'envie est certainement la faibles
se humaine qui se comprend et qui
s’excuse le moins. Four y échapper,
il suffit de regarder autour de soi.
S’il est vrai que pas un d’entre nous
ne coudoie chaque jour quelqu’un
que la fortune a favorisé davantage,
il est vrai aussi qu il coudoie des mi
sères capables de le ramener à une
plus juste conception des choses. Quel
est le capitaliste qui ne trouve pas
encore plus riche que lui, quel est le
malheureux qui ne soit pas témoin
d’une misère plus grande que la
sienne? u
Et si nous en arrivons à chercher
le bonheur, qu’il ne faut pas confon
dre avec l’abus grossier de toutes les
jouissances, nous nous apercevons
qu’il est souvent là où l’on s’atten
drait le moins à le découvrir : dans
un modeste ménage d’ouvrier, où l’on
goûte les joies intimes et saines de la
famille ; dans une chaumière de
paysans, où chacun accomplit sa tâche
et borne son ambition à la réalisation
de maigres économies dont sourirait
un riche propriétaire.
Tout est relatif. Le bonheur n’est
pas plus dans telle situation que dans
telle autre. Il est en nous-mêmes. La
fortune que nous envions a son cor
tège de misères et de vicissitudes. Elle
serait, évidemment, si le dernier mot
de la vie était de faire bonne chère,
de goûter à satiété toutes les jouissan
ces materielles. Mais, par bonheur,
il y a autre chose de plus élevé et de
plus durable, de moins fragile aussi,
vers quoi nous devons tendre d’abord
sous peine de déchéance.
# lors, si 1 on vient à extirper ce
vil sentiment qui est l’envie, on s’a
perçoit aussitôt que l’inégalité des
conditions est non seulement une loi
fatale de la Nature, mais encore un
élément d’action indispensable à la
vie. N est-ce pas l’espoir de conqué
rir un rang supérieur dans l’échelle
sociale, de sortir de la médiocrité, qui
excite l’émulation dans le travail enj
alimentant le rêve qui soutient et
console?Et, du moins, le plus hum
ble peut-il espérer désormais arriver
au sommet. Là est la véritable égalité
et non dans le nivellement démorali
sateur rêvé par des politiciens qui spé
culent sur l’ignorance de leurs con
temporains.
La richesse a son rôle nécessaire
dans une société organisée. Le luxe a
sa raison d’être et impose ses devoirs;
il ne faut la condamner que dans la
personne de ceux qui la méconnais
sent.
Nous n’avons pas besoin de dire
d’abord que nombre d’industries très
importantes vivent du luxe. Quand
on calcule le prix d’une toilette ou
d’un meuble, il faut penser aux
ouvriers dont ce fut le travail et qui y
ont trouvé leur salaire. Ainsi de tou
tes choses. L’argent revient toujours
en dernière analyse, directement ou
indirectement, aux ouvriers produc
teurs. Il serait facile de développer
cette thèse; à quoi bon? Un peu de
réflexion suffit à affirmer l’évidence.
Mais les riches ont une autre fonc
tion. C’est par eux que nous devons
connaître la Beauté, celle du moins
que seule la fortune peut réaliser.
On va au théâtre ou au concert, on
voyage, on achète des ouvrages illus
trés ou des tableaux pour offrir à ses
sens certaines jouissances d’ordre déli
cat et élevé, pour enrichir son intel
ligence, pour donner à son esprit
cette culture artistique nécessaire à
1 homme autant que la nourriture
corporelle et sans laquelle il n’est pas
complet. Eh bien ! il appartient aux
riches de nous offrir, dans les maisons
qu’ils font bâtir, l’impression du
beau en architecture, de réunir chez
eux et de placer dans nos musées les
œuvres des maîtres, de charmer nos
fêtes par l’élégance et le bon goût des
toilettes de leurs femmes et de leurs
filles, considérant cette distinction
dans la mise et les usages comme uo
devoir résultant de leur situation
sociale. Et n’est-ce pas, en effet;, un
spectacle séduisant qu’un défilé de
beaux équipages, de personnes belles
et parées, étalant royalement leurs
riéhesses au lieu de les cacher comme
des avares ?
Au théâtre, dans les cortèges de
fêtes, on altnire ces splenceurs, pour
quoi les considérer autrement dans la,
vie courante et comment surtout s’a
viser d’être jaloux d’une robe prin-
cière dont on ne saurait que faire ou
d’une pa ; re de chevaux dont tout le
prix est dans l’élégance de leur
allure ?
Le grand malheur d’une femme
millionnaire est d'être laide ou mal
bâtie. Il semble qu’elle doive tout
avoir a portée de sa main et pourtant
rien ne peut la sauver de cette infor
tune. Elle eu est alors réduite à en
vier la petite ouvrière qui passe,
coquette et jolie, habillée avec un
rien, plus séduisante et plus remar
quée.
a Ah ! où je comprends que l’on se
fâche, c’est lorsque l’un de ces favo
risés de la fortune agit comme un
Harpagon, lorsqu’il ne donne pas
de travail à cette masse d’ouvriers
qui vit du luxe des autres, lorsqu’il
fait construire des baraques sans ca
ractère, lorsqu’il se contente de meu
bles rustiques, lorsque sa femme et
! ses filles inélégantes se vêtent comme
: de petites bourgeoises, - à moins
qu’elles n’aient l’excuse de la gauche
rie et de la laideur. C’est alors que
les riches manquent à tous leurs de
voirs et sont haïssables au premier
chef. Ils se dérobent à l’une de leurs
premières fonctions sociales, puisque
personne ne peut y suppléer.
Certes, la beauté, l’élégance, la
distinction même se rencontrent par
tout et telle fille de ferme rendrait
souvent des points à la dame du
château, mais l’éclat qu’il vient du
luxe, quelque artificiel que soit sou
vent l’impression qui s’en dégage, a
un autre caractère et satisfait nos
yeux à un point de vue different. Et
c^st pourquoi nous considérons côm-
mœun droit d’exiger que ceux qui
ont la fortune en partage ne l’oublient
pas. Nous devons alors tout leur par
donner.
Nous voici bien loin de la lutte
des classes. Le lecteur aura peut-être
souri d’abord à notre théorie, il se
sera même irrité. Qn’il veuille bien
la méditer et il finira par nous don-
der raison.
Pas de lutte. Tout homme a son
rôle défini, qu’il a l’obligation de
jouer sous peine de justifier des colè
res. Le seul sentiment qui doive naî
tre de l’inégalité des conditions, est
l’ambition de gravir soi-même quel
ques échelons et de préparer à ses
enfants un sort meilleur. Tant d’au
tres, placés au sommet, s’écroulent
chaque jour, que l’équilibre se main
tient quand même. L’égalité règne en
maîtresse dans notre société.
Mais, au-dessus de toutes les^ tra
ditions et de toutes les rivalités, se
place pour chacun l’impérieux devoir
d aider de son intelligence et de son
influence, mieux peut-être encore
que de sa fortune, ceux qui cherchent
à se frayer honorablement un chemin
dans la vie. Que l’on appelle cela
pitié, solidarité, charité, peu importe,
pourvu que la chose y soit.
Qui sait tendre la main à propos,
prononcer la parole qui reconforte,
prêter sans calcul le concours qui
sauve, celui-là, quel que soit l’éclat
de la richesse, a droit à l’estime et à
la considération de tous. Il n’est ni
un parasite ni un inutile, il remplit
une fonction normale et contribue
non moins que le producteur a la
prospérité générale.
Loin d’en être jaloux, airaons-leet
rendons-lui j ustice.
François DEPASSE.
(Reproduction interdite).
«3^»
MÉLIW E & VEU ILLOT
Il est loin, le temps où ces deux
noms eussent hurlé d’être accouplés,
où les présenter côte à côte c’eut été
dresser une formidable antithèse.
Aujourd’hui ces noms marchent
fort bien ensemble : compère et com
pagnon.
Dans Y Univers, M. Pierre Yeuillot
parle de « la République soucieuse de
l’ordre, honnête, patriote et libérale,
que nous promet M. Méline ». Il qua
lifie « un acte de haute importance »
le discours prononcé par l’ancien pre
mier ministre au conseil général des
Vosges.
Le langage tenu par M. Méline
montre à M. Veuillot « le chef des
républicains modérés en train d’ache
ver son évolution ».
Il en extrait « la phrase capitale »,
qui est celle-ci : « Ce ne sont plus les
cléricaux que nous avons à combat
tre, ce sont les sectaires... c’est-à-dire
les francs-maçons et leurs instru
ments ».
| Là-dessus M. Pierre Veuillot foude
l’espoir de voir se dresser demain la
République de ses rêves, celle des
ralliés et des cléricaux.
M. Méline, c’est la garde, suprême
espoir et suprême pensée pour M.
Veuillot !
PAS D’ ÉQUIV OQUE I
Les nationalistes exploitent en ce
moment, en le dénaturant, le discours
de Marseille du Président de la Répu
blique. Volontiers, ils porteraient
maintenant au Capitole, M. Loubet
qu’ils injuriaient grossièrement na
guère. Le publiciste Martineau et
l’orateur!!! Brindeau qui, comme
l’on sait, ne forment sous le dieu
Méline qu’une seule et même personne,
s’évertuent à montrer le chef de l’Etat
gagné à leur cause.
On aperçoit clairement que les dis
ciples de François Coppée et de Jules
Lemaître croient le moment venu de
dévorer la poire et le fromage. Us
cherchent à se, mettre bien en cour et
à rentrer à l’Elysée. Mais il y a tou
jours ce maudit ministère Waldeck-
Rousseau qu’il faudrait renverser et
qui ne paraît pas disposé à laisser la
place à l’ennemi. Sous son impulsion,
le pays s’est constitué en état de dé
fense républicaine, et il est difficile
de l’attaquer de front. L’on se pique,
dans le camp nationaliste, d’agir de
ruse, de tourner la forteresse répu
blicaine en endormant ses défenseurs
dans une douce quiétude, de gagner à
soi les républicains naïfs en encensant
le président Loubet, puis de tout
chambarder ensuite par une alliance
avec toutes les droites.
Voilà pourquoi l’on travestit les
paroles du Président de la Républi
que quand il a dit que. P ce on avait
cherché à creuser un fossé entre l’ar
mée et la nation ». Quel est cet « on »
sinon les nationalistes qui ont excité
l’armée contre la nation. C’est ce qu’a
réellement laissé entendre M. Loubet
après son discours de Cherbourg. Il
faut être vraiment Brindeau pour ne
pas l’avoir compris ou ne pas l’avoir
voulu comprendre.
D’ailleurs, M. Caillaux, ministre
des finances, a précisé les intentions
du chef du pouvoir exécutif ces jours-
ci. Il a affirmé, pour se faire enten
dre, la nécessité de la fidélité de
l’armée à la République.
Quoi que l’on dise et fasse, M. Lou
bet reste solidaire du gouvernement.
Alf. HENRI.
Patriotisme et Patriotardisme
Un fait, que nous relevons entre
mille, prouve bien que les véritables
patriotes ne sont pas chez les natio
nalistes, et que ce dernier titre cache
généralement des poltrons cherchant
à dissimuler leur lâcheté sous une
hâblerie bruyante et grotesque.
Le gouvernement a fait récemment
appel à la nation pour envoyer des
volontaires en Chine.
Or, on sait bien le nombre des en
gagements fournis par la Ville de
Paris, cité éminemment patriotarde
et représentée par un conseil munici
pal nationaliste ?
Exactement 180, sur 2 millions
d’habitants ! ! !
Et si l’on procède au dépouillement
des contingents fournis par chaque
arrondissement, on constate que le
chiffre donné par le 16 e (le plus natio
naliste des 20 arrondissements de
Paris, le seul qui ait donné 4 sièges
de conseillers sur 4 aux amis de De-
roulède), est exactement zéro.
Vous entendez bien : zéro. Voilà
l’expression mathématique par la
quelle se traduit l’amour de la patrie
dans l’arrondissement de Passy.
Mais quels fumistes que ces natio
nalistes !
LES PÉNITENTS
Le temps commençait pour eux son
œuvre de pardon et d’oubli. Personne,
excepté la victime encore saignante,
ne se rappelait plus leurs noms exé
crés. Ils pouvaient, tous deux, achever
dans une paix relative leur vie
déshonorée.
Ils ne l’ont pas voulu. Atteints de
la nostalgie des beaux jours de gloire
où ils participèrent au gouvernement
du pays, ils ont réussi à reconquérir
dans leurs cénacles de province un peu
de leur situation perdue, et les voilà
tous deux présidents de Conseils gé
néraux.
L’occasion était belle pour se re
pentir. Ils ont préféré s’amnistier.
Ecoutons le panégyrique.
M. Cavaignac, en prenant posses
sion du fauteuil de président du Con
seil général de la Sarthe, a traité lé
gèrement le différend qui l’avait
obligé à disparaître quelque temps.
Et il s’est rendu cet hommage que du
moins le malentendu qui s’était élevé
entre certains de ses collègues et lui
ne pouvait l’éloigner pour toujours
des honneurs où il prétend atteindre.
L’autre, M. André Lebon, inquiet
sur l’avenir de sa propre gloire, s’est
borné à faire l’éloge de M. de la
Porte, qui ne méritait pas un pareil
témoin. Il a parlé du faux nationa
lisme, qu’il ne faut pas confondre
avec le nationalisme du faux dont il
fut jusqu’à ce jour une des gloires
incontestées.
Les conseillers généraux de la
Sarthe et des Deux-Sèvtes ont pu se
laisser prendre au jeu de ces deux
pénitents qui attendent à la porte de
la République le pardon de leur faute.
Us n’iront pas plus loin. Le sinistre
entêté Cavaignac, l’ancien professeur
de vertu nationale, ne saurait autre
ment que par le silence et le remords,
faire oublier l’affichage du faux
Henry. Le bourreau André Lebon,
l’homme à la double boucle, le com
plice du garde-chiourme Deniel, est à
jamais marqué au fer rouge.
Le parti républicain se déshonore
rait lui-même s’il venait à rouvrir les
bras à ces deux personnages.
C’est assez que Mercier soit devenu
sénateur.
Qu’on nous épargne la honte d'être
gouvernés un jour par Cavaignac et
Lebon.
À. Varemne.
LA MORTALITÉ DES ENFANTS
Très juste réflexion du Parisien du
Radical :
La statistique douloureuse nous ap
prend que les tout petits enfants —
de un jour à un an — meurent eu
des proportions formidables. On a re
marqué que, dans nombre de familles,
il arrive que le premier né meurt dès
le premier mois. Pourquoi? Parce que
les mères, si bonnes, si affectueuses,
si maternelles qu’elles soient, igno
rent absolument de quelle façon il
convient de soigner ces créatures frê
les. Si le second enfant survit, c’est
que la mère a fait un triste appren
tissage avec le premier.
Que prouve cela, sinon que notre
stupide méthode d’éducation néglige
justement ce qui devrait être son
essence et sa base? Et cela est encore
la résultante du crime catholique.
C'est la doctrine religieuse qui,
en conspuant la chair, en souillant la
i
CINQ CENTIMES LE NUMERO
Samedi 25 Août 1806.
I
Organe du Parti Républicain Démocraxii^ue
PRIX DES ABONNEMENTS
Le Havre et la Seine-Inférieure par an
Départements »
ADMINISTRATION ET RÉDACTION
15, RUE GASIMIR-PÉRIER,
Secrétaire de la Rédaction Alfred HENRI
L’Imprimeur-Gérant F. LE ROY
Prix des Insertions
Annonces 25 centimes la ligne
Réclames . 50 »
On traite à forfait
L’UNE DES FONCTIONS
de la richesse
Certains partis font de la lutte des
classes la base de leur action. En d’au
tres termes, ils opposent ceux qui
n’ont rien à ceux qui possèdent. Ils
pourraient dire aux premiers de con
quérir, à force de travail et de volonté,
une place parmi les seconds ; ils pré
fèrent un état violent susceptible de
dégénérer en guerre civile.
_ La passion sur laquelle spéculent
ainsi ces réformateurs n’a rien de!
bien honorable, elle s’appelle l’envie
et compte fort justement au nombre
des péchés capitaux. Péché bas et sans
relief, qui ne rachète aucune qualité
correspondante. L’envie n’engendre
que la haine, elle rend l’homme à la
lois malheureux et méchant, elle lui
met dans l’âme un vice méprisable
dont il ne guérira jamais, car celui
qui en est atteint trouvera toujours
un nouvel aliment à sa passion.
En supposant qu’il soit parvenu à
la puissance et à la richesse qui sont
les deux choses les plus recherchées
en ce monde, il sera encore jaloux de
la joie des autres, du bonheur qu’il
sera incapable d’acquérir. Une juste
fatalité le condamnera à souffrir toute
sa vie.
L'envie est certainement la faibles
se humaine qui se comprend et qui
s’excuse le moins. Four y échapper,
il suffit de regarder autour de soi.
S’il est vrai que pas un d’entre nous
ne coudoie chaque jour quelqu’un
que la fortune a favorisé davantage,
il est vrai aussi qu il coudoie des mi
sères capables de le ramener à une
plus juste conception des choses. Quel
est le capitaliste qui ne trouve pas
encore plus riche que lui, quel est le
malheureux qui ne soit pas témoin
d’une misère plus grande que la
sienne? u
Et si nous en arrivons à chercher
le bonheur, qu’il ne faut pas confon
dre avec l’abus grossier de toutes les
jouissances, nous nous apercevons
qu’il est souvent là où l’on s’atten
drait le moins à le découvrir : dans
un modeste ménage d’ouvrier, où l’on
goûte les joies intimes et saines de la
famille ; dans une chaumière de
paysans, où chacun accomplit sa tâche
et borne son ambition à la réalisation
de maigres économies dont sourirait
un riche propriétaire.
Tout est relatif. Le bonheur n’est
pas plus dans telle situation que dans
telle autre. Il est en nous-mêmes. La
fortune que nous envions a son cor
tège de misères et de vicissitudes. Elle
serait, évidemment, si le dernier mot
de la vie était de faire bonne chère,
de goûter à satiété toutes les jouissan
ces materielles. Mais, par bonheur,
il y a autre chose de plus élevé et de
plus durable, de moins fragile aussi,
vers quoi nous devons tendre d’abord
sous peine de déchéance.
# lors, si 1 on vient à extirper ce
vil sentiment qui est l’envie, on s’a
perçoit aussitôt que l’inégalité des
conditions est non seulement une loi
fatale de la Nature, mais encore un
élément d’action indispensable à la
vie. N est-ce pas l’espoir de conqué
rir un rang supérieur dans l’échelle
sociale, de sortir de la médiocrité, qui
excite l’émulation dans le travail enj
alimentant le rêve qui soutient et
console?Et, du moins, le plus hum
ble peut-il espérer désormais arriver
au sommet. Là est la véritable égalité
et non dans le nivellement démorali
sateur rêvé par des politiciens qui spé
culent sur l’ignorance de leurs con
temporains.
La richesse a son rôle nécessaire
dans une société organisée. Le luxe a
sa raison d’être et impose ses devoirs;
il ne faut la condamner que dans la
personne de ceux qui la méconnais
sent.
Nous n’avons pas besoin de dire
d’abord que nombre d’industries très
importantes vivent du luxe. Quand
on calcule le prix d’une toilette ou
d’un meuble, il faut penser aux
ouvriers dont ce fut le travail et qui y
ont trouvé leur salaire. Ainsi de tou
tes choses. L’argent revient toujours
en dernière analyse, directement ou
indirectement, aux ouvriers produc
teurs. Il serait facile de développer
cette thèse; à quoi bon? Un peu de
réflexion suffit à affirmer l’évidence.
Mais les riches ont une autre fonc
tion. C’est par eux que nous devons
connaître la Beauté, celle du moins
que seule la fortune peut réaliser.
On va au théâtre ou au concert, on
voyage, on achète des ouvrages illus
trés ou des tableaux pour offrir à ses
sens certaines jouissances d’ordre déli
cat et élevé, pour enrichir son intel
ligence, pour donner à son esprit
cette culture artistique nécessaire à
1 homme autant que la nourriture
corporelle et sans laquelle il n’est pas
complet. Eh bien ! il appartient aux
riches de nous offrir, dans les maisons
qu’ils font bâtir, l’impression du
beau en architecture, de réunir chez
eux et de placer dans nos musées les
œuvres des maîtres, de charmer nos
fêtes par l’élégance et le bon goût des
toilettes de leurs femmes et de leurs
filles, considérant cette distinction
dans la mise et les usages comme uo
devoir résultant de leur situation
sociale. Et n’est-ce pas, en effet;, un
spectacle séduisant qu’un défilé de
beaux équipages, de personnes belles
et parées, étalant royalement leurs
riéhesses au lieu de les cacher comme
des avares ?
Au théâtre, dans les cortèges de
fêtes, on altnire ces splenceurs, pour
quoi les considérer autrement dans la,
vie courante et comment surtout s’a
viser d’être jaloux d’une robe prin-
cière dont on ne saurait que faire ou
d’une pa ; re de chevaux dont tout le
prix est dans l’élégance de leur
allure ?
Le grand malheur d’une femme
millionnaire est d'être laide ou mal
bâtie. Il semble qu’elle doive tout
avoir a portée de sa main et pourtant
rien ne peut la sauver de cette infor
tune. Elle eu est alors réduite à en
vier la petite ouvrière qui passe,
coquette et jolie, habillée avec un
rien, plus séduisante et plus remar
quée.
a Ah ! où je comprends que l’on se
fâche, c’est lorsque l’un de ces favo
risés de la fortune agit comme un
Harpagon, lorsqu’il ne donne pas
de travail à cette masse d’ouvriers
qui vit du luxe des autres, lorsqu’il
fait construire des baraques sans ca
ractère, lorsqu’il se contente de meu
bles rustiques, lorsque sa femme et
! ses filles inélégantes se vêtent comme
: de petites bourgeoises, - à moins
qu’elles n’aient l’excuse de la gauche
rie et de la laideur. C’est alors que
les riches manquent à tous leurs de
voirs et sont haïssables au premier
chef. Ils se dérobent à l’une de leurs
premières fonctions sociales, puisque
personne ne peut y suppléer.
Certes, la beauté, l’élégance, la
distinction même se rencontrent par
tout et telle fille de ferme rendrait
souvent des points à la dame du
château, mais l’éclat qu’il vient du
luxe, quelque artificiel que soit sou
vent l’impression qui s’en dégage, a
un autre caractère et satisfait nos
yeux à un point de vue different. Et
c^st pourquoi nous considérons côm-
mœun droit d’exiger que ceux qui
ont la fortune en partage ne l’oublient
pas. Nous devons alors tout leur par
donner.
Nous voici bien loin de la lutte
des classes. Le lecteur aura peut-être
souri d’abord à notre théorie, il se
sera même irrité. Qn’il veuille bien
la méditer et il finira par nous don-
der raison.
Pas de lutte. Tout homme a son
rôle défini, qu’il a l’obligation de
jouer sous peine de justifier des colè
res. Le seul sentiment qui doive naî
tre de l’inégalité des conditions, est
l’ambition de gravir soi-même quel
ques échelons et de préparer à ses
enfants un sort meilleur. Tant d’au
tres, placés au sommet, s’écroulent
chaque jour, que l’équilibre se main
tient quand même. L’égalité règne en
maîtresse dans notre société.
Mais, au-dessus de toutes les^ tra
ditions et de toutes les rivalités, se
place pour chacun l’impérieux devoir
d aider de son intelligence et de son
influence, mieux peut-être encore
que de sa fortune, ceux qui cherchent
à se frayer honorablement un chemin
dans la vie. Que l’on appelle cela
pitié, solidarité, charité, peu importe,
pourvu que la chose y soit.
Qui sait tendre la main à propos,
prononcer la parole qui reconforte,
prêter sans calcul le concours qui
sauve, celui-là, quel que soit l’éclat
de la richesse, a droit à l’estime et à
la considération de tous. Il n’est ni
un parasite ni un inutile, il remplit
une fonction normale et contribue
non moins que le producteur a la
prospérité générale.
Loin d’en être jaloux, airaons-leet
rendons-lui j ustice.
François DEPASSE.
(Reproduction interdite).
«3^»
MÉLIW E & VEU ILLOT
Il est loin, le temps où ces deux
noms eussent hurlé d’être accouplés,
où les présenter côte à côte c’eut été
dresser une formidable antithèse.
Aujourd’hui ces noms marchent
fort bien ensemble : compère et com
pagnon.
Dans Y Univers, M. Pierre Yeuillot
parle de « la République soucieuse de
l’ordre, honnête, patriote et libérale,
que nous promet M. Méline ». Il qua
lifie « un acte de haute importance »
le discours prononcé par l’ancien pre
mier ministre au conseil général des
Vosges.
Le langage tenu par M. Méline
montre à M. Veuillot « le chef des
républicains modérés en train d’ache
ver son évolution ».
Il en extrait « la phrase capitale »,
qui est celle-ci : « Ce ne sont plus les
cléricaux que nous avons à combat
tre, ce sont les sectaires... c’est-à-dire
les francs-maçons et leurs instru
ments ».
| Là-dessus M. Pierre Veuillot foude
l’espoir de voir se dresser demain la
République de ses rêves, celle des
ralliés et des cléricaux.
M. Méline, c’est la garde, suprême
espoir et suprême pensée pour M.
Veuillot !
PAS D’ ÉQUIV OQUE I
Les nationalistes exploitent en ce
moment, en le dénaturant, le discours
de Marseille du Président de la Répu
blique. Volontiers, ils porteraient
maintenant au Capitole, M. Loubet
qu’ils injuriaient grossièrement na
guère. Le publiciste Martineau et
l’orateur!!! Brindeau qui, comme
l’on sait, ne forment sous le dieu
Méline qu’une seule et même personne,
s’évertuent à montrer le chef de l’Etat
gagné à leur cause.
On aperçoit clairement que les dis
ciples de François Coppée et de Jules
Lemaître croient le moment venu de
dévorer la poire et le fromage. Us
cherchent à se, mettre bien en cour et
à rentrer à l’Elysée. Mais il y a tou
jours ce maudit ministère Waldeck-
Rousseau qu’il faudrait renverser et
qui ne paraît pas disposé à laisser la
place à l’ennemi. Sous son impulsion,
le pays s’est constitué en état de dé
fense républicaine, et il est difficile
de l’attaquer de front. L’on se pique,
dans le camp nationaliste, d’agir de
ruse, de tourner la forteresse répu
blicaine en endormant ses défenseurs
dans une douce quiétude, de gagner à
soi les républicains naïfs en encensant
le président Loubet, puis de tout
chambarder ensuite par une alliance
avec toutes les droites.
Voilà pourquoi l’on travestit les
paroles du Président de la Républi
que quand il a dit que. P ce on avait
cherché à creuser un fossé entre l’ar
mée et la nation ». Quel est cet « on »
sinon les nationalistes qui ont excité
l’armée contre la nation. C’est ce qu’a
réellement laissé entendre M. Loubet
après son discours de Cherbourg. Il
faut être vraiment Brindeau pour ne
pas l’avoir compris ou ne pas l’avoir
voulu comprendre.
D’ailleurs, M. Caillaux, ministre
des finances, a précisé les intentions
du chef du pouvoir exécutif ces jours-
ci. Il a affirmé, pour se faire enten
dre, la nécessité de la fidélité de
l’armée à la République.
Quoi que l’on dise et fasse, M. Lou
bet reste solidaire du gouvernement.
Alf. HENRI.
Patriotisme et Patriotardisme
Un fait, que nous relevons entre
mille, prouve bien que les véritables
patriotes ne sont pas chez les natio
nalistes, et que ce dernier titre cache
généralement des poltrons cherchant
à dissimuler leur lâcheté sous une
hâblerie bruyante et grotesque.
Le gouvernement a fait récemment
appel à la nation pour envoyer des
volontaires en Chine.
Or, on sait bien le nombre des en
gagements fournis par la Ville de
Paris, cité éminemment patriotarde
et représentée par un conseil munici
pal nationaliste ?
Exactement 180, sur 2 millions
d’habitants ! ! !
Et si l’on procède au dépouillement
des contingents fournis par chaque
arrondissement, on constate que le
chiffre donné par le 16 e (le plus natio
naliste des 20 arrondissements de
Paris, le seul qui ait donné 4 sièges
de conseillers sur 4 aux amis de De-
roulède), est exactement zéro.
Vous entendez bien : zéro. Voilà
l’expression mathématique par la
quelle se traduit l’amour de la patrie
dans l’arrondissement de Passy.
Mais quels fumistes que ces natio
nalistes !
LES PÉNITENTS
Le temps commençait pour eux son
œuvre de pardon et d’oubli. Personne,
excepté la victime encore saignante,
ne se rappelait plus leurs noms exé
crés. Ils pouvaient, tous deux, achever
dans une paix relative leur vie
déshonorée.
Ils ne l’ont pas voulu. Atteints de
la nostalgie des beaux jours de gloire
où ils participèrent au gouvernement
du pays, ils ont réussi à reconquérir
dans leurs cénacles de province un peu
de leur situation perdue, et les voilà
tous deux présidents de Conseils gé
néraux.
L’occasion était belle pour se re
pentir. Ils ont préféré s’amnistier.
Ecoutons le panégyrique.
M. Cavaignac, en prenant posses
sion du fauteuil de président du Con
seil général de la Sarthe, a traité lé
gèrement le différend qui l’avait
obligé à disparaître quelque temps.
Et il s’est rendu cet hommage que du
moins le malentendu qui s’était élevé
entre certains de ses collègues et lui
ne pouvait l’éloigner pour toujours
des honneurs où il prétend atteindre.
L’autre, M. André Lebon, inquiet
sur l’avenir de sa propre gloire, s’est
borné à faire l’éloge de M. de la
Porte, qui ne méritait pas un pareil
témoin. Il a parlé du faux nationa
lisme, qu’il ne faut pas confondre
avec le nationalisme du faux dont il
fut jusqu’à ce jour une des gloires
incontestées.
Les conseillers généraux de la
Sarthe et des Deux-Sèvtes ont pu se
laisser prendre au jeu de ces deux
pénitents qui attendent à la porte de
la République le pardon de leur faute.
Us n’iront pas plus loin. Le sinistre
entêté Cavaignac, l’ancien professeur
de vertu nationale, ne saurait autre
ment que par le silence et le remords,
faire oublier l’affichage du faux
Henry. Le bourreau André Lebon,
l’homme à la double boucle, le com
plice du garde-chiourme Deniel, est à
jamais marqué au fer rouge.
Le parti républicain se déshonore
rait lui-même s’il venait à rouvrir les
bras à ces deux personnages.
C’est assez que Mercier soit devenu
sénateur.
Qu’on nous épargne la honte d'être
gouvernés un jour par Cavaignac et
Lebon.
À. Varemne.
LA MORTALITÉ DES ENFANTS
Très juste réflexion du Parisien du
Radical :
La statistique douloureuse nous ap
prend que les tout petits enfants —
de un jour à un an — meurent eu
des proportions formidables. On a re
marqué que, dans nombre de familles,
il arrive que le premier né meurt dès
le premier mois. Pourquoi? Parce que
les mères, si bonnes, si affectueuses,
si maternelles qu’elles soient, igno
rent absolument de quelle façon il
convient de soigner ces créatures frê
les. Si le second enfant survit, c’est
que la mère a fait un triste appren
tissage avec le premier.
Que prouve cela, sinon que notre
stupide méthode d’éducation néglige
justement ce qui devrait être son
essence et sa base? Et cela est encore
la résultante du crime catholique.
C'est la doctrine religieuse qui,
en conspuant la chair, en souillant la
i
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 88.51%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 88.51%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k3263425v/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k3263425v/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k3263425v/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k3263425v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k3263425v
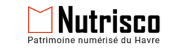


Facebook
Twitter