Titre : Le Petit Havre : organe républicain, démocratique, socialiste ["puis" organe républicain démocratique "puis" bulletin d'informations locales]
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1913-07-08
Contributeur : Fénoux, Hippolyte (1842-1913). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836500g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 08 juillet 1913 08 juillet 1913
Description : 1913/07/08 (A33,N11682). 1913/07/08 (A33,N11682).
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t52637759v
Source : Bibliothèque municipale du Havre, PJ5
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/04/2023
N11,68%
BCenhmnes— OfflômiWB- 8 Centimes
Mardi 8 Jwillet 1913
33= Année
Rédaeter en Chef. Gérant
Administrateur • Délégué
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Administration
a M. 0. RANDOLET
35, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havr
Administration, Auprezsions et Aunonces. TU 10.47
Le Petit Havre
HIPPOLYTE FÉNOUX
Aoresser tout ce qui concerne la Redactios
a M. HIPPOLYTE FénouI
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE: Rédaction. N 7.60
AU HAVRE
A PARIS
AN NON SEB
Bureau du Journal, 118, boula de Strasbourg.
! L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir lea Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
te PETIT HA VUE est désigne peur les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
peme= , =========================== ================
ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférioure, PEure
l’Oise et la Somme
Autres Départements.
Union Postale
TBOI MOIS, Six Mois
Un An
anss
E9
„ ... 20 Fr. 1 44 »
onSabenne egalement, SANS FRr ' S> tous 105 Bllraa '^ de Peste de
=============== =======
10
£
| Dernière Heure |
PARIS, TROIS HEURES MATIN
D
DÉPÊCHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 7 Juillet. Dépêche de 4 h. 80
CUIVRE
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
cal.ne
£ 63 18/-
• 63 17/6
s/-
5/-
-/-
Comptant..
8 mois
ETAIN
Comptant .
8 mois
facile
£ 183 5/-
£ 184 5/-
-/-
75/-
65/-
FER
Comptant..
3 mois
calme
£ 55/10 %
£ 86/9
3 % d
5 d
-/-
-/-
Prix comparés avec peux de la deuxième Bourse
du 6 juillet 1913.
LES AFTAIRES DORIENT
E
La Ports et les Bulgares
Constantinople. — La Porte a télégraphié
à M. Daneff demandant l’évacuation des
troupes bulgares du territoire qui se trouve
au delà de la ligne droite Enos-Midia.
L’offensive grecque
SALONIQUE. — Stroumitea et Bemir-Hassar
ont été occupés par les Grecs.
Les Pertes bulgares
Belgrade. — Après avoir inutilement es
saye pendant six jours de trouer la ligne de
combat serbe, les Bulgares commencent à se
retirer.
Les pertes bulgares en hommes sont con
sidérables . "
Le choléra règne à Istip. Des mesures ont
été prises pour etoufter l’épidémie.
Autour de Salonique
SALONIQUE. — En arrivant à Doiran où il
est actuerement, l’état-major a trouvé huit
canons, des caissons et des fusils.
Le général de division télégraphie que la
poursuite continue avec une telle vigueur
que l’ennemi ne peut se reformer.
La bataille de Lahana a été terrible.
Dès Grecs ont eu beaucoup de pertes.
Sept mille Grecs blessés sont arrivés à Sa-
Ionique.
A LA COMMISSION DU BUDGET
La Commission du Budget a examiné le
projet de loi relatif aux dépenses militaires
du Maroc.
Elle a repris l’examen des ressources com
plémentaires nécessitées par les nouvelles
modifications apportées au Budget, notam
ment l’adoption du projet de report de 46
millions de crédits de 1912 à 1913. Elle a dé
cidé de reprendre, pour faire face à cette dé
pense en écritures, des dispositions relati
ves à la prise en charge, par les comptables,
du papier timbré, soit 45 millions, qui cons
titue elle-même une recette en écritures —
disposition votée par la Chambre et repous
sée par le Sénat.
La Commission a adopté d’autre part les
taxes suivantes sur lesquelles elle avait ré-
servé sa décision : 1° Augmentation de 2 à
3 0/0 du droit de timbre à l’émission des va-
leurs étrangères, le chiffre communiqué par
le gouvernement lui ayant montré que cette
taxe ne portait pas atteinte à l’équilibre de
l’impôt du revenu ; 20 Etablissement d’un
droit sur les films cinématographiques,étant
entendu que le remboursement des droits à
l’exportation ne bénéficiera qu’aux films
n’ayant jamais servi et que les films impor-
Lés paieront la taxe.
Elle a maintenu ses résolutions précéden-
Ses en ce qui concerne les mesures propo
sées par le gouvernement sur le revenu et
les droits de transmission des valeurs mobi
lières, les apports en mariage, contrats d’as
surances sur la vie, le timbre des effets de
commerce et le décime sur les droits d’en
registrement.
Le ministre des finances avait demandé à
la Commission d’établir, en tenant compte
des diverses modifications survenues dans
les dépenses depuis le rapport de M. Noul-
dens et non compris les dépenses du Maroc.
L’équilibre se trouve obtenu en réduisant à
30 millions le chiffre de 54 millions des obli
gations sexenaires autorisées dans Je projet
du Sénat.
VOTE DE NOS DÉPUTÉS
Dans le scrutin sur le paragraphe 3 de l’ar
ticle 18 ainsi conçu : « dans l’armée active,
pendant trois ans... », tous les députés de
la Seine-Inférieure ont voté pour.
TE VOYAGE DE M. POINCARÉ
A TOULOUSE
TOULOUSE. — Le Conseil général a voté à
‘unanimité un crédit de cent mille francs
pour les frais de la réception de M. Poincaré
a Toulouse.
Du sait que le Conseil municipal socialiste
de cette ville a refusé tout crédit pour cette
réception.
LE SAPEUR AVIATEUR SERTIT
FAIT URE CHUTE
REIMS. — Dans la soirée d’hier, le sapeur
aviateur Bertin sur monoplan, exécutait des
vols entre Reims et le camp de Châlons en
vue de passer son brevet de pilote quand,
par suite d’une fausse manœuvre, l’hélice de
son appareil toucha Iq sol. L’aéroplane se
retourna comoletement.
NEW-YORK, 7 JUILLET
Cotons : juillet, baisse 10 points ; octobre,
baisse 8 points ; décembre, baisse 8 points ;
mars, baisse 11 points. — A peins soutenu.
NEW-YORK, 7 JUILLET
Calés » baisse 23 à 19 points.
Cuivre Standard disp.
— août
Amalgamat. Cop...
Fer
t. M
JOK
S. PSI
Cl»«T
13
87
13
87
14
12
14
12
63
3/4
64
1/2
15
75
15
75
CHICAGO, 7 JUILLET
C. DU JOUR
C. PRECEO
Blé sur Juillet....
8s 7'8
90 » '»
— Septembre
89 3 8
90 3/8
Maïs sur Juillet,..
60 7 8
61 1/2
— ..... Septembre
61 7 «
61 5/8
Saindoux sur. Juillet. ..
‘ 11 67
11 45
- Septembre
A 70
11 00
“aeerd
2
Dans sa chute, l’aviateur s’est fait de gros
ves contusions à la tête ; il a dû être trans-1 modé. Je ne veux pas dire qu’il se survécut
Krn4( 8 1‘3A36 a 1 mi 13:3257 D : .. . ê < __ A o o 1 ’ o,s 2 r
porté à l’hôpital militaire de Reims.
CHUTE GRAVE D’UN
AVIATEUR MILITAIRE ALLEMAND
Berlin. — Le lieutenant aviateur Adami a
fait nier une .chute de vingt mètres à l’aéro
drome de Goerries, près de Schwerin, alors
qu’il exécutait son premier vol.
L’aviateur est grièvement blessé ; son ap
pareil est détruit.
LES AFFAIRES DU MAROC
Une déclaration du colonel Mangin
Bordeaux. — Le colonel Mangin intervie
wé à son passage à Bordeaux par le corres
pondant de l’Agence Havas, sur les affaires
des 8 et 10 juin, a déclaré :
« Cette opération était nécessaire et quoi
qu’on en dise elle constitue un gros succès,
chèrement acheté, il est vrai, mais un succès
qui consacre la pacification du Tadla. Le
Tadla qui était un cauchemar pour la Chaouia
est maintenant organisé. Nous avons acquis
une province extrêmement riche, pacifiée
entièrement ».
L’Allemagne prendra-t-elle
Raisouli sous sa protection ?
Madrid. — Le gouvernement espagnol in
formé que des commerçants allemands éta
blis au Maroc faisaient des démarches au
près du cabinet de Berlin pour que la pro
tection allemande fut accordée à El Raisouli,
a présenté aussitôt au gouvernement alle
mand des observations très cordiales.
Il ressort de ces observations que le gou
vernement espagnol se verrait obligé de s’op-
poser à une telle mesure non seulement à
cause des traités en vigueur, mais encore,
en raison des antécédents et de l’attitude ac
tuelle d’El Raisouli.
Le gouvernement impérial a répondu en
termes fort courtois et conformément à la
bonne amitié qui unit les deux pays qu’il
accueillait les observations de l’Espagne et
qu’il demandait de plus amples renseigne
ments à son représentant à Tanger sur cette
aflaire.
Nouvelles Politiques
M. Herriot reprendra le contre-projet
Messimy-Paul-Boncour
Le Progrès de Lyon annonce que M. Herriot,
sénateur du Rhône, se propose de reprendre
devant le Sénat le contre-projet de MM. Mes-
simy et Paul Boncour, partisans du service
de trente mois.
Le cas de M. Willm
La section socialiste unifiée de Levallois
ne pardonne pas à M. Willm, l’élu du parti,
son accident d’automobile.
Samedi, une grande affiche placardée à
profusion dans la cité de Levallois, annon
çait à la population que tout était rompu en
tre «celui qui avait manqué se tuer avec
M. Aristide Briand » et les unifiés.
La Fédération socialiste de la Seine, réu
nie en congrès régional, salle de la Bellevil-
loise, à Paris, a estimé que la section de Le
vallois allait un peu vite.
Cette section, en prononçant seule l’exclu
sion de M. Willm, aurait violé les statuts du
parti.
Elle avait de plus donné une entorse au
principe de droit commun qui veut que
tout accusé puisse se défendre avant d’être
frappé.
Deux autres motions présentées par les
sections de Boulogne et da Puteaux, venues
au secours de celle de Levallois, furent re
poussées.
L’assemblée décida d’appliquer strictement
les statuts. •
En conséquence, une lettre recommandés
a été enveyée par le président de séance, M.
Bon, au député de Levallois.
Aux termes de cette lettre, M. Willm est
invité à se présenter devant le comité fédé
ral pour y être entendu.
Au cas probable — M. Willm est actuelle
ment absent de Paris — où l’élu ne répon
drait pas à cette invitation, il appartiendrait
alors au conseil national du parti, qui se ré
unira le 13 de ce mois, de prendre une déci
sion.
De cette décision d’ailleurs, M. Willm
pourra, le cas échant appeler devant le
congrès national.
ROCHEFORT
tt le Tempérament politique if Paris
Rochefort, qui vient de mourir, après une
existence merveilleuse d’intensité, de ro
mantisme et de diversité, fut, comme hom
me, essentiellement représentatif d’une gé
nération (celle qui a vu tomber l’Empire),
ét, comme journaliste politique, essentielle
ment représentatif d’un milieu (le milieu
parisien). Ne demandons pas à ce grand
fantaisiste une doctrine, ni une continuité
quelconque de vues politiques: la seule
unité de sa vie de partisan, c’est une unité
de tempérament, si j’ose dire, une façon
persistante et toujours la même, à travers
un demi-siècle, de sentir les choses, de s'en
thousiasmer ou de s’indigner. Et le grand
intérêt que je trouve à l’analyser vient sur
tout de ce que ce tempérament est exacte
ment celui des Parisiens : Rochefort, en
une brève synthèse, nous rend claire toute
l’évolution politique de Paris depuis cin
quante ans.
Depuis une dizaine d'années, en réalité
depuis l'échec du Nationalisme, il était dé-
à luf-même, mais il survivait à son époque,
et son esprit qui n’était plus le nôtre, sem
blait déjaappanigir à l’Histoire. Il y a eu en
effet un « esprit Second Empire », de même
qu’en architecture — D]S commençons à
nous en apercevoir — il y S eu un “ style
Second Empire », Rien de plus lointain au-
jourd’hui que cette blague boulevard.]re.
cette façon superficielle de résoudre les
problèmes par des jeux de .mots, de se croire
profond parce qu’on est simplement spiri
tuel. Moins frivoles que nos devanciers,
plus intellectuels, surtout plus soucieux
d'information précise, nous sommes las de
cette façon de traiter les questions. Comme
les opérettes d’Offenbach, les bons mots du
Boulevard qui enchantèrent nos pères, nous
paraissent trop souvent teintés d’une verve
un peu vulgaire de collégiens.
Tout cela du reste revient peut-être à
dire que nous achevons de perdre contact
avec l’époque de Napoléon III. Jusqu’au
Boulangisme, subsistaient une atmosphère,
une société, un personnel qui rappelaient
encore l’Empire ; dans le recul du temps,
le Paris du général Boulanger et celui de
l’impératrice Eugénie nous apparaissent
comme rapprochés l’un de l’autre par je ne
sais quel air de famille. Quel contraste, en
effet, avec le Paris des autobus et des Amé
ricains que ce Paris d’hier, relativement
petit, avec des équipages brillants et des
chevaux qui piaffaient ! Et comme Roche
fort devait le regretter !
Passons maintenant à la politique. M.
Maurice Barrés, dans son admirable Appel
au soldat, a écrit sur Rochefort ces quel
ques lignes profondes : « Rochefort ! Ce
nom personnifie l’instinct gai et d’attaque
qui, surtout depuis deux siècles et sous
l’influence de Paris, détermine les gens de
notre race à s’indigner des injustices, à
s’amuser des mésaventures du pouvoir».
Vous voyez là, de suite, comme en un ré
sumé les deux pôles de l’esprit parisien :
d’une part sa belle sincérité, son désinté
ressement ; de l’autre son irrémédiable fri
volité.
C’est la noblesse du Parisien que de
n’être jamais, en politique, un calculateur
mesquin. A d’autres les basses querelles de
Comités, les pitoyables rivalités de clans,
le sectarisme étroit des cléricaux jaloux ou
des ridicules mangeurs de curés. Sans dou
te il se forme, dans les quartiers et surtout
aux heures d’atonie, des organisations de
politiciens, qui prétendent discipliner, ca
naliser, accaparer les votes, mais il suffit
d’une marée d’opinion (et Paris en connaît
de superbes) pour balayer les pygmées des
mares électorales et recouvrir, sous les hau
tes eaux d’un enthousiasme, les chenaux
séparés des partis.
Voilà donc le premier caractère du Pari
sien : susceptible d’enthousiasme, désinté
ressé, assez dédaigneux en général du mot
d’ordre des coteries, il voit de haut, ce qui
ne veut pas dire qu’il voie toujours juste.
Guidé par le sentiment et très sensible à
l’atmosphère des circonstances, il fait bon
marché des préoccupations de partis :. au
fond, c’est essentiellement un pléniscitaire.
Malheureusement, cette sincérité, qui
commande la sympathie, a une regrettable
contre-partie : le Parisien, en politique,
n’est pas sérieux. On connaît la passion
brutale et sans pitié des rivalités électo
rales dans les petites communes : les ad
versaires s’y détestent cordialement, ne
pensant qu’à leur duel de tous les jours, de
tous les instants. Leur excuse est, après 1
tout, qu’ils n’ont pas d’autre distraction !
A Paris, au contraire, chacun a d’autres
occupations, d’autres amusements aussi ;
la politique n’y est pas le tout d’un homme.
Il en résulte que le lutteur parisien se
donne, se reprend, engage la bataille ou
s’en retire, un peu par caprice. Il se fait
tuer sur une barricade ! me direz-vous. —
Oui, mais s’il pleut, il rentre chez lui ! En
somme, à tout âge. il reste un peu « gamin
de Paris », n’étant vraiment à son aise que
s’il fait de l’opposition et se moque de quel
qu’un.
Cet ensemble de traits fait qu’aucun gou
vernement, aucun régime ne peut complète
ment compter sur le peuple de Paris.Aucun
parti n’a pu davantage prétendre annexer
Rochefort lui-même ! Voyez plutôt !
En 1869, le pamphlétaire de la Lanterne
soulève tout Paris dans une gaie et endia
blée protestation contre Napoléon III : plus
que Gambetta, il est à ce moment l’idole de
la capitale ; la foule parisienne le tire de sa
prison, au Quatre-Septembre ; c’est elle
qui l’impose au gouvernement de la Dé
fense Nationale. Mais trois mois n’ont pas
passé que Rochefort démissionne et une
demi-année s’est à peine écoulée que la
Commune éclate. Républicaine, nationa
liste, révolutionnaire, exaltée, la popula
tion parisienne s’exprime toute entière
dans l’emballement insurrectionnel du 18
Mars. Que lui importent ce jour-là et le
parlementarisme, et l’ordre public et le sé
rieux politique, si nécessaire cependant de
vant l’ennemi ? Elle ne pense qu’à défendre
la République contre l’orléanisme mena
çant et les canons de Paris contre l’armée de
Versailles ! Et la voilà qui, à deux pas des
Prussiens, se met à organiser un régime de
fantaisie, dont elle ne peut ignorer vrai
ment qu’il n’a pas de lendemain. Si l’on ne
se souvenait de la « folie obsidionale » du
siège, comme il faudrait être sévère pour
les Parisiens ! .
Quand on tient ce point de départ, on a
en main tout ce qu’il faut pour expliquer
l’attitude de Paris, dans toutes les crises
r subséquentes. En 1873, la capitale préfère
Barodet à de Rémusat : peu lui importe que
la répercussion de ce scrutin soit la chute
de Thiers étc régime de « l’Ordre mo
ral » ! En 1889, Paris tout entier est bou
langiste, A l’éleotion du 27 janvier, sous
la direction de Rochelr, rédacteur de
Y Intransigeant, tous les quarn.TS sans CK-
ception donnent la majorité au gebral : Si
ce pusillanime l’avait seulement 0St, il
couchait le soir même à l’Elysée. Commi-
— 2 j- » 40-0 ï 1 . , d'obtenir des atténuations en faveur des fa-
nard en 1871, radical en 1873, le peuple nlles nombreuses, mais leurs efforts de-
parisien marquait cette fois sa préférence
pour une République plébiscitaire, anti
parlementaire, et, si l’on peut dire, pour
une République d’opposition ! Dix ans plus
tard, reprise, moins belle sans doute, mais
authentique, de la même tragi-comédie :
Paris en 1899 est nationaliste ; en 1902,
Syveton y est porté à la Chambre par une
élection triomphale, et une fois de plus le
vieil entraîneur de foules, le déjà légen
daire Rochefort est là.Devant cette nouvelle
marée populaire qui soulève Paris, il se .
rappelle sans doute 1871, 1889, et il peut
se dire après tout, non sans raison, que ce
sont trois éruptions d’un même foyer et que
d’un bout à l’autre c’est le même courant :
un républicanisme sincère, mais fantaisiste,
plus plébiscitaire que parlementaire, un
patriotisme bruyant et parfois équivoque,
un invincible besoin de brimer le pouvoir
existant et par dessus tout la conviction
naïve que Paris est le soleil politique du
monde ! Y a-t-il là de quoi fonder un gou
vernement durable ? On peut en douter.
Mais quelle matière pour les Premiers-
Paris d’un Rochefort ou les pronuncia-
mientos d’un Boulanger !
Le raz de marée du Nationalisme ne sera
sans doute pas le dernier de cet ordre qui
soulèvera Paris, car si les hommes, les vil
les ou les peuples peuvent changer d’opi
nion, ils ne changent guère de tempéra-
ment. Dans les nouvelles crises que l’ave
nir ne manquera pas de nous apporter,
Paris se comportera sans doute conformé
ment à sa tradition. La République parle
mentaire, celle des Ferry et des Waldeck-
Rousseau, aurait donc tort de compter sur
lui. Commune, Boulangisme, Nationa
lisme, voilà en effet des leçons que les mi
litants républicains font bien de méditer.
Ils les méditent, en effet, et plus qu’autre-
fois. Dans les deux premiers tiers du XIX e
siècle, Paris fut, pour la Province républi
caine, le guide suprême ; c’est de Paris que
partaient les mouvements démocratiques
qui changeaient la face de la Nation : 1830,
1858, 1870 ! Depuis lors, la méfiance est
venue : les militants de 1871 n’ont pas suivi
la Commune dans sa folle dissidence ; c’est
parce que la Province républicaine a résisté,
en 1889, à l’entraînement de Paris que
l’aventure boulangiste a avorté ; le nationa
lisme enfin est demeuré une éruption près
que exclusivement parisienne. Politique
ment, Paris ne dirige plus la France, qui,
avec raison, se méfie de lui.
A cet égard encore, et de même que nous
le disions tout à l’heure pour le ton de ses
plaisanteries, Rochefort meurt un peu dé-
modé, dans une France profondément modi
fiée. A plusieurs reprises, il avait été le roi
d’un Paris qui conduisait la France. Or, si
Paris est resté jusqu’à la fin fidèle à son
idole, le Pays, lui, s’est soustrait à la domi
nation politique de sa capitale. La mort de
Rochefort ne marque pas, en soi, la fin
d’une époque : elle souligne, pour les es-
prits attentifs, qu’une époque a pris fin.
André SIEGFNEI
LE SERVICE DE TROIS ANS
Par 559 voix contre 225 la Chambre vote le paragraphe 5 de l’article 18
de la loi militaire fixant à trois ans la durée du service actif.
(DE NOTRE correspondant particulier)
Paris, 7 juillet.
Les derniers obstacles amoncelés par les
auteurs de contre-projets pour barrer la
route à la loi militaire ayant été franchis, la
Chambre s’est trouvée aujourd'hui en pré
sence de l’article fondamental du projet;
celui fixant à trois ans la durée du service
actit.
Cet article, après les votes significatifs de
ces jours derniers, on n’aurait eu, semblait-
il, qu’à le mettre aux voix ; mais M. Jaurès,
qui a toujours un discours en réserve, avait
eu soin de se faire inscrire et, malgré tout,
il a bien fallu lui donner la parole.
Si on l’avait écouté, c’est toute la discus
sion générale qui aurait recommencé sur cet
article. Heureusement, ni la Commission, ni
le gouvernement ne se sont laissés entraîner
dans la voie où il voulait les attirer et M.
Jaurès, un peu vexé, a dû faire cavalier
seul.
Toutefois, avant de statuer sur les trois
ans, la Chambre avait examiné un certain
nombre d’amendements dont un, celui de M.
Daniel Vincent, avait une portée considé
rable.
Le texte présenté par M. Daniel Vincent
posait, en effet, d’une façon absolue, le prin
cipe de l'égalité du service, et les adversaires
des trois ans comptaient s’en servir comme
d’une arme nouvelle, une arme qu'ils ju
geaient redoutable pour combattre le
projet.
Cette arme s’est retournée contre eux. Le
gouvernement, qui avait d’ailleurs inscrit
dans son projet primitif le principe de l’éga
lité du service, s’est rallié à l’amendement
Vincent, et celui-ci, également accepté par la
Commission, a été adopté à l’unanimité.
Du même coup, les amendements visant
la libération anticipée se trouvaient écartés.
Les socialistes n’en essayèrent pas moins
meurent superflus.
Et l’eb arriva enfin au paragraphe 3 (ser
vice de 3 ags) qui fut voté après pointage,
naturellement, par 339 voix contre 223, soit
116 voix de majorité.
Les adversaires de la loi consentiront-ils
maintenant à s’avouer vaincus ?
T. H.
La séance est ouverte à deux heures.
M. Paul DESCHANEL préside.
• On aborde sans débat un projet de loi relatif à
la nomination aux grades de sous-lieutenant et de
lieutenant. Ce projet a pour but de remédier au
déficit des lieutenants dans l’infanterie, qui s'élè
ve a 1,600 aux sources de recrutement actuaires.
On ajoute comme pouvant être nommés lieute
nants et sous-lieutenants les officiers de réserve
provenant de Centrale, des écoles des mines, des
ponts et chaussées. Normale supérieure, etc., ou
bien ayant accompli dans là réserve deux années
de service au Maroc.
U 101 DE TROIS ANS
On reprend la loi de trois ans.
On en a fini avec les contre-projets, on aborde
les articles. Selon la décision prise vendredi par
la Chambre, on commence par l'artiele 18, parce
qu’il pose le principe de la loi de trois ans.
En voici le texte :
L’article 32 de la loi du 21 mars 1905 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Tout
Français reconnu propre au service militaire
fait partie successivement de l’armée active
pendant trois ans, de la réserve de l’armée ac
tive pendant onze ans, de l’armée territoriale
pendant sept ans, de la réserve de l’armée terri
toriale pendant sept ans. Le service militaire est
réglé par classe.
» L'armée active comprend, indépendamment
des hommes qui ne proviennent pas des appelés,
tous les jeunes gens déclarés propres au service
militaire armé et auxiliaire et faisant partie
des trois derniers contingents incorporés. »
le président appelle successivement les pre-
miers orateurs inscrits : M. Félix Chautemps,
mais M. Chautemps n'est pas là ; puis M. Aubriot,
socialiste unifié, mais il n’est pas là non plus ;
et enfin M. Jaurès, le troisième inscrit. M. Jaurès
est là et parle. . _
m. Jaurès combat l’article 18 II s étonne sur
tout de l’incorporation à 20 ans. Va-t-on maintenir
en octobre quatre classes sous les drapeaux ?
C’est impossible ! Va-t-on donc libérer la classe
1910 dont on avait annoncé bruyamment le main
tien ? Mais alors pourquoi ce maintien tapageur et
brutal qui a déchaîné les mutineries ? Et pourquoi
avoir remué tout le pays en disant qu’il fallait en
octobre avoir trois classes dont deux instruites
puisqu’on en aura deux non instruites sur trois ?
L’argumentation essentielle sur laquelle était
fondée la loi de trois classes, dont deux instruites
est désormais ruinée, tout l'édifice s’écroule. Vous
nous disiez : « il faut parer au plus pressé.» Vous
n’y parez plus. Alors a quoi bon votre loi ?
Votre œuvre a d’ailleurs d'autres defauts . en
fait vous rétablissez la deuxième portion du con
tingent. L’égalité sera encore comme uue ensei
gne sur votre loi, mais elle ne sera plus dans la
Vous ouvrez la porte à l’arbitraire. On libérera
d’après le surnombre, mais ce surnombre qui le
déterminera ? Votre loi vivra quelques mois tré
buchante et chancelante ; elle croulera sous le
poids de ses contradictions et de l'esprit républi
cain qui la condamne. (Applaudissements a 1 ex
trême gauche.)
m. pâté, rapporteur, répond :
M. Jaurès a rouvert, dit-il, une discussion géne
raie qu’on croyait close. (Très bien ! Tués bien )
Quelques-unes de ces observations portent sur
un article, mais c’est sur l’article 19. -
Sur l’incorporation à vingt ans, la Commission
ne s’est pas encore prononcée, on n'a pas le droit
de préjuger son vote sur ce point. La discussion
viendra naturellement à propos de l article 6.
M. DE LANESSAN : J’ai touiours voté jusqu ici
A LA CHAMBRE
' avec la Commission. Mais si vous voulez obtenu
un vote sur le principe de la loi de trois ans sand
avoir répondu aux objections qui vous ont ét
faites, nous nous y refusons. (Applaudissements
à l’extrême gauche et à gauche. — Mouvements
divers.)
m. daté : Relisez l’article 18 et dites-moi si
l’incorporation a vingt ans peut s’y poser. Elle
se posera sur d’autres articles, pas sur celui-là. Je
demande le voie de l’article 18. (Très bien I Très
bien ! au centre).
La c ôture est demandée.
m. Daniel Vincent, radical socialiste, parle
contre la clôture.
Il fait observer que deux questions sont soumi
ses à la Crambre : celle de la durée du service et
celle du principe d’égalité dans le service mili
taire. La seconde prime la première.
Pourquoi ne veut-on pas qu’on parle d’abord du
principe d’égalité, qui corrobore celui de l’obliga.
tion ?
L’orateur insiste pour que la Chambre discute
l’amendement qu’il a déposé à ce sujet
m. le hérissé, président de la Commission,
dit que la commission est a la disposition de la
Chambre ; mais il estime que la méthode propo
sée par ede est la plus simple et la plus logique.
En premier lieu il y aurait lieu de statuer sur le
service de trois ans. on examinerait ensuite les
modalités d’application.
Sur la question d égalité, la Commission n’a pas
varié d'opinion.
L’orateur insiste pour que la Chambre statue
sur l’article 18 et que l’amendement de M. Danie
Vincent vienne sur l’article 19. ((Très bien au cen
tre et sur divers bancs à gauche. Interruptions d
l’extrême gauche)
Vo
Le scrutin donne lieu au pointage.
Par 314 voix contre 856, la clôture est pronon
cée.
m. le président fait connaître que M Daniel
Vincent a déposé un amendement ainsi conçu :
« Tous les hommes reconnus aptes au service
militaire sont tenus d’accomplir effectivement la
même durée de service »
M. le hérissé, président de la Commission de
l’armée : La Commission, d’accord avec le gou
vernement. demande à la Chambre de se pronon-
cer sur l’amendement de M. Vincent qui pose un
principe qu’elle n’a .jamais contesté et qu’elle act
cepte.
M. ETIENNE, ministre de la guerre, déclare
qu’en adoptant ‘amendement de M. Vincent, la
Commission reprend le texte proposé par le Gou-
vérnement dans son projet.
Le Gouvernement ne fait pas opposition à l’adop
tion de l’amendement. (Très bien ! Très bien 8)
m daniel-vincent remercie la Commission
et le Ministre de la guerre d’avoir accepté son
amendement.
Il précise les termes de son amendement qus
vise a la fois la durée du service et la manière de
remplir cette durée.
Il coupe court aux libérations anticipées, aux
affectations spéciales et aux modalités indiquées
ailleurs qu’ici pour certaines catégories de militai
res (Applaudissements à l’extrême gauche et à
ailleurs qu’ici
gauche).
M. JOSEPH REINACH dit qu’il n’éprouve aucune
difficulté a voter l’amendement.
L’article 18 du projet fixe la durée du service de
l’armée active.
La Commission avait prévu, dans l’article 19,
une série de libérations anticipées. Pourquoi ?
Quand s’est posée la question du service de 3
ans, il a été entendu qu’on devait faire tout l’ef
fort nécessaire et rien que cela.
La Commission a demandé au Gouvernement
d’interroger le Conseil supérieur et de lui deman
der quels étaient les effectifs nécessaires.
Ces effectifs sont indiqués aux annexes de l’ar
ticle 2.
Par l’article 19, la Commission proposait de ren
voyer en congé le surnombre : familles nombreu
ses, soutiens de famille, après deux ans ou après
trente mois de service.
C’est l’ensemble des dispositions de l’article 19
qui vont tomber par le vote de l’amendement.
Au point de vue militaire, l’amendement aug
mente les effectifs d’une façon considérable. La-
Commission l’accepte.
Au point de vue économique et social, que la
Commission avait voulu sauvegarder, les avanta
ges prévus par l’article 19 tombent par le vote de
l’amendement.
Comme l’intérêt militaire domine la question,
les effectifs minima seront plus forts et l’orateur
s’en rejouit.
Mais, après le vote de l’amendement, M. Daniel-
Vincent et ses amis voteront-ils le service de trois
ans ? (Vifs applaudissements )
M LE PRÉSIDENT fait connaître qu’il a reçu
de M. J.-L Breton une disposition additionnelle à
l’amendement de M. Vincent.
« La présente disposition n’est pas applicab’e
aux mesures ayant pour objet exclusif de mainte
nir et de développer la population du pays. » (Ex
clamations sur divers bancs.)
m. le président met aux voix l’amendement
de M. Daniel Vincent auquel s’est rallié M. Cha-
nal.
Par 674 voix contre 2, cet
adopté? (Applaudissements).
m. breton insiste en faveur
ment.
amendement es)
de son amende-
COMMISSION dit
M. LE PRÉSIDENT DE LA
qu’après la manifestation faite par la Chambre sur
l’amendement de M. Daniel Vincent, d’accord avec
le gouvernement, il repousse ‘amendement.
(Très bien ! Très bien !)
M. LE MINISTRE DE LA GUERRE fait la même
déclaration. Le gouvernement repousse l’amende
ment de M. Breton dans son esprit comme dans
sa forme. (Applaudissements).
m AUGAGNEUR dit qu’il votera contre I amende
ment, quelle que soit son opinion sur le fond. Il
y a d’autres manières de venir en aide aux famil
les nombreuses, et il est prêt à voter les mesures
nécessaires. (Applaudissements à gauche.)
M. JAURÈS fait observer que si, par hasard. I8-
mendement de M. Breton était voté, il serait le
commencement d’une série. .
m. le président met aux voix la prise en con
sidération de l’amendement. , , —
Par 364 voix contra 210, 1 amendement n est pas
pris en considération.
m DELACHENAL soutient ‘amendement sui
vant • « La présente disposition n’exclut pas da
vantage les mesures ayant pour but de remédier à
la dépopulation des campagnes. »
M. LE PRÉSIDENT DE LA. COMMISSION : La
Commission, d’accord avec le gouvernement, re
pousse l’amendement. . . .
Par 428 voix contre 145, l’amendement n est par
pris en considération.
Les deux premiers paragraphes du projet sont
adoptés. . . n
m. de je ante a la parole sur le paragraphe 3
relatif au service de trois ans.
Comme ouvrier et représentant de la population
BCenhmnes— OfflômiWB- 8 Centimes
Mardi 8 Jwillet 1913
33= Année
Rédaeter en Chef. Gérant
Administrateur • Délégué
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Administration
a M. 0. RANDOLET
35, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havr
Administration, Auprezsions et Aunonces. TU 10.47
Le Petit Havre
HIPPOLYTE FÉNOUX
Aoresser tout ce qui concerne la Redactios
a M. HIPPOLYTE FénouI
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE: Rédaction. N 7.60
AU HAVRE
A PARIS
AN NON SEB
Bureau du Journal, 118, boula de Strasbourg.
! L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir lea Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
te PETIT HA VUE est désigne peur les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
peme= , =========================== ================
ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférioure, PEure
l’Oise et la Somme
Autres Départements.
Union Postale
TBOI MOIS, Six Mois
Un An
anss
E9
„ ... 20 Fr. 1 44 »
onSabenne egalement, SANS FRr ' S> tous 105 Bllraa '^ de Peste de
=============== =======
10
£
| Dernière Heure |
PARIS, TROIS HEURES MATIN
D
DÉPÊCHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 7 Juillet. Dépêche de 4 h. 80
CUIVRE
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
cal.ne
£ 63 18/-
• 63 17/6
s/-
5/-
-/-
Comptant..
8 mois
ETAIN
Comptant .
8 mois
facile
£ 183 5/-
£ 184 5/-
-/-
75/-
65/-
FER
Comptant..
3 mois
calme
£ 55/10 %
£ 86/9
3 % d
5 d
-/-
-/-
Prix comparés avec peux de la deuxième Bourse
du 6 juillet 1913.
LES AFTAIRES DORIENT
E
La Ports et les Bulgares
Constantinople. — La Porte a télégraphié
à M. Daneff demandant l’évacuation des
troupes bulgares du territoire qui se trouve
au delà de la ligne droite Enos-Midia.
L’offensive grecque
SALONIQUE. — Stroumitea et Bemir-Hassar
ont été occupés par les Grecs.
Les Pertes bulgares
Belgrade. — Après avoir inutilement es
saye pendant six jours de trouer la ligne de
combat serbe, les Bulgares commencent à se
retirer.
Les pertes bulgares en hommes sont con
sidérables . "
Le choléra règne à Istip. Des mesures ont
été prises pour etoufter l’épidémie.
Autour de Salonique
SALONIQUE. — En arrivant à Doiran où il
est actuerement, l’état-major a trouvé huit
canons, des caissons et des fusils.
Le général de division télégraphie que la
poursuite continue avec une telle vigueur
que l’ennemi ne peut se reformer.
La bataille de Lahana a été terrible.
Dès Grecs ont eu beaucoup de pertes.
Sept mille Grecs blessés sont arrivés à Sa-
Ionique.
A LA COMMISSION DU BUDGET
La Commission du Budget a examiné le
projet de loi relatif aux dépenses militaires
du Maroc.
Elle a repris l’examen des ressources com
plémentaires nécessitées par les nouvelles
modifications apportées au Budget, notam
ment l’adoption du projet de report de 46
millions de crédits de 1912 à 1913. Elle a dé
cidé de reprendre, pour faire face à cette dé
pense en écritures, des dispositions relati
ves à la prise en charge, par les comptables,
du papier timbré, soit 45 millions, qui cons
titue elle-même une recette en écritures —
disposition votée par la Chambre et repous
sée par le Sénat.
La Commission a adopté d’autre part les
taxes suivantes sur lesquelles elle avait ré-
servé sa décision : 1° Augmentation de 2 à
3 0/0 du droit de timbre à l’émission des va-
leurs étrangères, le chiffre communiqué par
le gouvernement lui ayant montré que cette
taxe ne portait pas atteinte à l’équilibre de
l’impôt du revenu ; 20 Etablissement d’un
droit sur les films cinématographiques,étant
entendu que le remboursement des droits à
l’exportation ne bénéficiera qu’aux films
n’ayant jamais servi et que les films impor-
Lés paieront la taxe.
Elle a maintenu ses résolutions précéden-
Ses en ce qui concerne les mesures propo
sées par le gouvernement sur le revenu et
les droits de transmission des valeurs mobi
lières, les apports en mariage, contrats d’as
surances sur la vie, le timbre des effets de
commerce et le décime sur les droits d’en
registrement.
Le ministre des finances avait demandé à
la Commission d’établir, en tenant compte
des diverses modifications survenues dans
les dépenses depuis le rapport de M. Noul-
dens et non compris les dépenses du Maroc.
L’équilibre se trouve obtenu en réduisant à
30 millions le chiffre de 54 millions des obli
gations sexenaires autorisées dans Je projet
du Sénat.
VOTE DE NOS DÉPUTÉS
Dans le scrutin sur le paragraphe 3 de l’ar
ticle 18 ainsi conçu : « dans l’armée active,
pendant trois ans... », tous les députés de
la Seine-Inférieure ont voté pour.
TE VOYAGE DE M. POINCARÉ
A TOULOUSE
TOULOUSE. — Le Conseil général a voté à
‘unanimité un crédit de cent mille francs
pour les frais de la réception de M. Poincaré
a Toulouse.
Du sait que le Conseil municipal socialiste
de cette ville a refusé tout crédit pour cette
réception.
LE SAPEUR AVIATEUR SERTIT
FAIT URE CHUTE
REIMS. — Dans la soirée d’hier, le sapeur
aviateur Bertin sur monoplan, exécutait des
vols entre Reims et le camp de Châlons en
vue de passer son brevet de pilote quand,
par suite d’une fausse manœuvre, l’hélice de
son appareil toucha Iq sol. L’aéroplane se
retourna comoletement.
NEW-YORK, 7 JUILLET
Cotons : juillet, baisse 10 points ; octobre,
baisse 8 points ; décembre, baisse 8 points ;
mars, baisse 11 points. — A peins soutenu.
NEW-YORK, 7 JUILLET
Calés » baisse 23 à 19 points.
Cuivre Standard disp.
— août
Amalgamat. Cop...
Fer
t. M
JOK
S. PSI
Cl»«T
13
87
13
87
14
12
14
12
63
3/4
64
1/2
15
75
15
75
CHICAGO, 7 JUILLET
C. DU JOUR
C. PRECEO
Blé sur Juillet....
8s 7'8
90 » '»
— Septembre
89 3 8
90 3/8
Maïs sur Juillet,..
60 7 8
61 1/2
— ..... Septembre
61 7 «
61 5/8
Saindoux sur. Juillet. ..
‘ 11 67
11 45
- Septembre
A 70
11 00
“aeerd
2
Dans sa chute, l’aviateur s’est fait de gros
ves contusions à la tête ; il a dû être trans-1 modé. Je ne veux pas dire qu’il se survécut
Krn4( 8 1‘3A36 a 1 mi 13:3257 D : .. . ê < __ A o o 1 ’ o,s 2 r
porté à l’hôpital militaire de Reims.
CHUTE GRAVE D’UN
AVIATEUR MILITAIRE ALLEMAND
Berlin. — Le lieutenant aviateur Adami a
fait nier une .chute de vingt mètres à l’aéro
drome de Goerries, près de Schwerin, alors
qu’il exécutait son premier vol.
L’aviateur est grièvement blessé ; son ap
pareil est détruit.
LES AFFAIRES DU MAROC
Une déclaration du colonel Mangin
Bordeaux. — Le colonel Mangin intervie
wé à son passage à Bordeaux par le corres
pondant de l’Agence Havas, sur les affaires
des 8 et 10 juin, a déclaré :
« Cette opération était nécessaire et quoi
qu’on en dise elle constitue un gros succès,
chèrement acheté, il est vrai, mais un succès
qui consacre la pacification du Tadla. Le
Tadla qui était un cauchemar pour la Chaouia
est maintenant organisé. Nous avons acquis
une province extrêmement riche, pacifiée
entièrement ».
L’Allemagne prendra-t-elle
Raisouli sous sa protection ?
Madrid. — Le gouvernement espagnol in
formé que des commerçants allemands éta
blis au Maroc faisaient des démarches au
près du cabinet de Berlin pour que la pro
tection allemande fut accordée à El Raisouli,
a présenté aussitôt au gouvernement alle
mand des observations très cordiales.
Il ressort de ces observations que le gou
vernement espagnol se verrait obligé de s’op-
poser à une telle mesure non seulement à
cause des traités en vigueur, mais encore,
en raison des antécédents et de l’attitude ac
tuelle d’El Raisouli.
Le gouvernement impérial a répondu en
termes fort courtois et conformément à la
bonne amitié qui unit les deux pays qu’il
accueillait les observations de l’Espagne et
qu’il demandait de plus amples renseigne
ments à son représentant à Tanger sur cette
aflaire.
Nouvelles Politiques
M. Herriot reprendra le contre-projet
Messimy-Paul-Boncour
Le Progrès de Lyon annonce que M. Herriot,
sénateur du Rhône, se propose de reprendre
devant le Sénat le contre-projet de MM. Mes-
simy et Paul Boncour, partisans du service
de trente mois.
Le cas de M. Willm
La section socialiste unifiée de Levallois
ne pardonne pas à M. Willm, l’élu du parti,
son accident d’automobile.
Samedi, une grande affiche placardée à
profusion dans la cité de Levallois, annon
çait à la population que tout était rompu en
tre «celui qui avait manqué se tuer avec
M. Aristide Briand » et les unifiés.
La Fédération socialiste de la Seine, réu
nie en congrès régional, salle de la Bellevil-
loise, à Paris, a estimé que la section de Le
vallois allait un peu vite.
Cette section, en prononçant seule l’exclu
sion de M. Willm, aurait violé les statuts du
parti.
Elle avait de plus donné une entorse au
principe de droit commun qui veut que
tout accusé puisse se défendre avant d’être
frappé.
Deux autres motions présentées par les
sections de Boulogne et da Puteaux, venues
au secours de celle de Levallois, furent re
poussées.
L’assemblée décida d’appliquer strictement
les statuts. •
En conséquence, une lettre recommandés
a été enveyée par le président de séance, M.
Bon, au député de Levallois.
Aux termes de cette lettre, M. Willm est
invité à se présenter devant le comité fédé
ral pour y être entendu.
Au cas probable — M. Willm est actuelle
ment absent de Paris — où l’élu ne répon
drait pas à cette invitation, il appartiendrait
alors au conseil national du parti, qui se ré
unira le 13 de ce mois, de prendre une déci
sion.
De cette décision d’ailleurs, M. Willm
pourra, le cas échant appeler devant le
congrès national.
ROCHEFORT
tt le Tempérament politique if Paris
Rochefort, qui vient de mourir, après une
existence merveilleuse d’intensité, de ro
mantisme et de diversité, fut, comme hom
me, essentiellement représentatif d’une gé
nération (celle qui a vu tomber l’Empire),
ét, comme journaliste politique, essentielle
ment représentatif d’un milieu (le milieu
parisien). Ne demandons pas à ce grand
fantaisiste une doctrine, ni une continuité
quelconque de vues politiques: la seule
unité de sa vie de partisan, c’est une unité
de tempérament, si j’ose dire, une façon
persistante et toujours la même, à travers
un demi-siècle, de sentir les choses, de s'en
thousiasmer ou de s’indigner. Et le grand
intérêt que je trouve à l’analyser vient sur
tout de ce que ce tempérament est exacte
ment celui des Parisiens : Rochefort, en
une brève synthèse, nous rend claire toute
l’évolution politique de Paris depuis cin
quante ans.
Depuis une dizaine d'années, en réalité
depuis l'échec du Nationalisme, il était dé-
à luf-même, mais il survivait à son époque,
et son esprit qui n’était plus le nôtre, sem
blait déjaappanigir à l’Histoire. Il y a eu en
effet un « esprit Second Empire », de même
qu’en architecture — D]S commençons à
nous en apercevoir — il y S eu un “ style
Second Empire », Rien de plus lointain au-
jourd’hui que cette blague boulevard.]re.
cette façon superficielle de résoudre les
problèmes par des jeux de .mots, de se croire
profond parce qu’on est simplement spiri
tuel. Moins frivoles que nos devanciers,
plus intellectuels, surtout plus soucieux
d'information précise, nous sommes las de
cette façon de traiter les questions. Comme
les opérettes d’Offenbach, les bons mots du
Boulevard qui enchantèrent nos pères, nous
paraissent trop souvent teintés d’une verve
un peu vulgaire de collégiens.
Tout cela du reste revient peut-être à
dire que nous achevons de perdre contact
avec l’époque de Napoléon III. Jusqu’au
Boulangisme, subsistaient une atmosphère,
une société, un personnel qui rappelaient
encore l’Empire ; dans le recul du temps,
le Paris du général Boulanger et celui de
l’impératrice Eugénie nous apparaissent
comme rapprochés l’un de l’autre par je ne
sais quel air de famille. Quel contraste, en
effet, avec le Paris des autobus et des Amé
ricains que ce Paris d’hier, relativement
petit, avec des équipages brillants et des
chevaux qui piaffaient ! Et comme Roche
fort devait le regretter !
Passons maintenant à la politique. M.
Maurice Barrés, dans son admirable Appel
au soldat, a écrit sur Rochefort ces quel
ques lignes profondes : « Rochefort ! Ce
nom personnifie l’instinct gai et d’attaque
qui, surtout depuis deux siècles et sous
l’influence de Paris, détermine les gens de
notre race à s’indigner des injustices, à
s’amuser des mésaventures du pouvoir».
Vous voyez là, de suite, comme en un ré
sumé les deux pôles de l’esprit parisien :
d’une part sa belle sincérité, son désinté
ressement ; de l’autre son irrémédiable fri
volité.
C’est la noblesse du Parisien que de
n’être jamais, en politique, un calculateur
mesquin. A d’autres les basses querelles de
Comités, les pitoyables rivalités de clans,
le sectarisme étroit des cléricaux jaloux ou
des ridicules mangeurs de curés. Sans dou
te il se forme, dans les quartiers et surtout
aux heures d’atonie, des organisations de
politiciens, qui prétendent discipliner, ca
naliser, accaparer les votes, mais il suffit
d’une marée d’opinion (et Paris en connaît
de superbes) pour balayer les pygmées des
mares électorales et recouvrir, sous les hau
tes eaux d’un enthousiasme, les chenaux
séparés des partis.
Voilà donc le premier caractère du Pari
sien : susceptible d’enthousiasme, désinté
ressé, assez dédaigneux en général du mot
d’ordre des coteries, il voit de haut, ce qui
ne veut pas dire qu’il voie toujours juste.
Guidé par le sentiment et très sensible à
l’atmosphère des circonstances, il fait bon
marché des préoccupations de partis :. au
fond, c’est essentiellement un pléniscitaire.
Malheureusement, cette sincérité, qui
commande la sympathie, a une regrettable
contre-partie : le Parisien, en politique,
n’est pas sérieux. On connaît la passion
brutale et sans pitié des rivalités électo
rales dans les petites communes : les ad
versaires s’y détestent cordialement, ne
pensant qu’à leur duel de tous les jours, de
tous les instants. Leur excuse est, après 1
tout, qu’ils n’ont pas d’autre distraction !
A Paris, au contraire, chacun a d’autres
occupations, d’autres amusements aussi ;
la politique n’y est pas le tout d’un homme.
Il en résulte que le lutteur parisien se
donne, se reprend, engage la bataille ou
s’en retire, un peu par caprice. Il se fait
tuer sur une barricade ! me direz-vous. —
Oui, mais s’il pleut, il rentre chez lui ! En
somme, à tout âge. il reste un peu « gamin
de Paris », n’étant vraiment à son aise que
s’il fait de l’opposition et se moque de quel
qu’un.
Cet ensemble de traits fait qu’aucun gou
vernement, aucun régime ne peut complète
ment compter sur le peuple de Paris.Aucun
parti n’a pu davantage prétendre annexer
Rochefort lui-même ! Voyez plutôt !
En 1869, le pamphlétaire de la Lanterne
soulève tout Paris dans une gaie et endia
blée protestation contre Napoléon III : plus
que Gambetta, il est à ce moment l’idole de
la capitale ; la foule parisienne le tire de sa
prison, au Quatre-Septembre ; c’est elle
qui l’impose au gouvernement de la Dé
fense Nationale. Mais trois mois n’ont pas
passé que Rochefort démissionne et une
demi-année s’est à peine écoulée que la
Commune éclate. Républicaine, nationa
liste, révolutionnaire, exaltée, la popula
tion parisienne s’exprime toute entière
dans l’emballement insurrectionnel du 18
Mars. Que lui importent ce jour-là et le
parlementarisme, et l’ordre public et le sé
rieux politique, si nécessaire cependant de
vant l’ennemi ? Elle ne pense qu’à défendre
la République contre l’orléanisme mena
çant et les canons de Paris contre l’armée de
Versailles ! Et la voilà qui, à deux pas des
Prussiens, se met à organiser un régime de
fantaisie, dont elle ne peut ignorer vrai
ment qu’il n’a pas de lendemain. Si l’on ne
se souvenait de la « folie obsidionale » du
siège, comme il faudrait être sévère pour
les Parisiens ! .
Quand on tient ce point de départ, on a
en main tout ce qu’il faut pour expliquer
l’attitude de Paris, dans toutes les crises
r subséquentes. En 1873, la capitale préfère
Barodet à de Rémusat : peu lui importe que
la répercussion de ce scrutin soit la chute
de Thiers étc régime de « l’Ordre mo
ral » ! En 1889, Paris tout entier est bou
langiste, A l’éleotion du 27 janvier, sous
la direction de Rochelr, rédacteur de
Y Intransigeant, tous les quarn.TS sans CK-
ception donnent la majorité au gebral : Si
ce pusillanime l’avait seulement 0St, il
couchait le soir même à l’Elysée. Commi-
— 2 j- » 40-0 ï 1 . , d'obtenir des atténuations en faveur des fa-
nard en 1871, radical en 1873, le peuple nlles nombreuses, mais leurs efforts de-
parisien marquait cette fois sa préférence
pour une République plébiscitaire, anti
parlementaire, et, si l’on peut dire, pour
une République d’opposition ! Dix ans plus
tard, reprise, moins belle sans doute, mais
authentique, de la même tragi-comédie :
Paris en 1899 est nationaliste ; en 1902,
Syveton y est porté à la Chambre par une
élection triomphale, et une fois de plus le
vieil entraîneur de foules, le déjà légen
daire Rochefort est là.Devant cette nouvelle
marée populaire qui soulève Paris, il se .
rappelle sans doute 1871, 1889, et il peut
se dire après tout, non sans raison, que ce
sont trois éruptions d’un même foyer et que
d’un bout à l’autre c’est le même courant :
un républicanisme sincère, mais fantaisiste,
plus plébiscitaire que parlementaire, un
patriotisme bruyant et parfois équivoque,
un invincible besoin de brimer le pouvoir
existant et par dessus tout la conviction
naïve que Paris est le soleil politique du
monde ! Y a-t-il là de quoi fonder un gou
vernement durable ? On peut en douter.
Mais quelle matière pour les Premiers-
Paris d’un Rochefort ou les pronuncia-
mientos d’un Boulanger !
Le raz de marée du Nationalisme ne sera
sans doute pas le dernier de cet ordre qui
soulèvera Paris, car si les hommes, les vil
les ou les peuples peuvent changer d’opi
nion, ils ne changent guère de tempéra-
ment. Dans les nouvelles crises que l’ave
nir ne manquera pas de nous apporter,
Paris se comportera sans doute conformé
ment à sa tradition. La République parle
mentaire, celle des Ferry et des Waldeck-
Rousseau, aurait donc tort de compter sur
lui. Commune, Boulangisme, Nationa
lisme, voilà en effet des leçons que les mi
litants républicains font bien de méditer.
Ils les méditent, en effet, et plus qu’autre-
fois. Dans les deux premiers tiers du XIX e
siècle, Paris fut, pour la Province républi
caine, le guide suprême ; c’est de Paris que
partaient les mouvements démocratiques
qui changeaient la face de la Nation : 1830,
1858, 1870 ! Depuis lors, la méfiance est
venue : les militants de 1871 n’ont pas suivi
la Commune dans sa folle dissidence ; c’est
parce que la Province républicaine a résisté,
en 1889, à l’entraînement de Paris que
l’aventure boulangiste a avorté ; le nationa
lisme enfin est demeuré une éruption près
que exclusivement parisienne. Politique
ment, Paris ne dirige plus la France, qui,
avec raison, se méfie de lui.
A cet égard encore, et de même que nous
le disions tout à l’heure pour le ton de ses
plaisanteries, Rochefort meurt un peu dé-
modé, dans une France profondément modi
fiée. A plusieurs reprises, il avait été le roi
d’un Paris qui conduisait la France. Or, si
Paris est resté jusqu’à la fin fidèle à son
idole, le Pays, lui, s’est soustrait à la domi
nation politique de sa capitale. La mort de
Rochefort ne marque pas, en soi, la fin
d’une époque : elle souligne, pour les es-
prits attentifs, qu’une époque a pris fin.
André SIEGFNEI
LE SERVICE DE TROIS ANS
Par 559 voix contre 225 la Chambre vote le paragraphe 5 de l’article 18
de la loi militaire fixant à trois ans la durée du service actif.
(DE NOTRE correspondant particulier)
Paris, 7 juillet.
Les derniers obstacles amoncelés par les
auteurs de contre-projets pour barrer la
route à la loi militaire ayant été franchis, la
Chambre s’est trouvée aujourd'hui en pré
sence de l’article fondamental du projet;
celui fixant à trois ans la durée du service
actit.
Cet article, après les votes significatifs de
ces jours derniers, on n’aurait eu, semblait-
il, qu’à le mettre aux voix ; mais M. Jaurès,
qui a toujours un discours en réserve, avait
eu soin de se faire inscrire et, malgré tout,
il a bien fallu lui donner la parole.
Si on l’avait écouté, c’est toute la discus
sion générale qui aurait recommencé sur cet
article. Heureusement, ni la Commission, ni
le gouvernement ne se sont laissés entraîner
dans la voie où il voulait les attirer et M.
Jaurès, un peu vexé, a dû faire cavalier
seul.
Toutefois, avant de statuer sur les trois
ans, la Chambre avait examiné un certain
nombre d’amendements dont un, celui de M.
Daniel Vincent, avait une portée considé
rable.
Le texte présenté par M. Daniel Vincent
posait, en effet, d’une façon absolue, le prin
cipe de l'égalité du service, et les adversaires
des trois ans comptaient s’en servir comme
d’une arme nouvelle, une arme qu'ils ju
geaient redoutable pour combattre le
projet.
Cette arme s’est retournée contre eux. Le
gouvernement, qui avait d’ailleurs inscrit
dans son projet primitif le principe de l’éga
lité du service, s’est rallié à l’amendement
Vincent, et celui-ci, également accepté par la
Commission, a été adopté à l’unanimité.
Du même coup, les amendements visant
la libération anticipée se trouvaient écartés.
Les socialistes n’en essayèrent pas moins
meurent superflus.
Et l’eb arriva enfin au paragraphe 3 (ser
vice de 3 ags) qui fut voté après pointage,
naturellement, par 339 voix contre 223, soit
116 voix de majorité.
Les adversaires de la loi consentiront-ils
maintenant à s’avouer vaincus ?
T. H.
La séance est ouverte à deux heures.
M. Paul DESCHANEL préside.
• On aborde sans débat un projet de loi relatif à
la nomination aux grades de sous-lieutenant et de
lieutenant. Ce projet a pour but de remédier au
déficit des lieutenants dans l’infanterie, qui s'élè
ve a 1,600 aux sources de recrutement actuaires.
On ajoute comme pouvant être nommés lieute
nants et sous-lieutenants les officiers de réserve
provenant de Centrale, des écoles des mines, des
ponts et chaussées. Normale supérieure, etc., ou
bien ayant accompli dans là réserve deux années
de service au Maroc.
U 101 DE TROIS ANS
On reprend la loi de trois ans.
On en a fini avec les contre-projets, on aborde
les articles. Selon la décision prise vendredi par
la Chambre, on commence par l'artiele 18, parce
qu’il pose le principe de la loi de trois ans.
En voici le texte :
L’article 32 de la loi du 21 mars 1905 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Tout
Français reconnu propre au service militaire
fait partie successivement de l’armée active
pendant trois ans, de la réserve de l’armée ac
tive pendant onze ans, de l’armée territoriale
pendant sept ans, de la réserve de l’armée terri
toriale pendant sept ans. Le service militaire est
réglé par classe.
» L'armée active comprend, indépendamment
des hommes qui ne proviennent pas des appelés,
tous les jeunes gens déclarés propres au service
militaire armé et auxiliaire et faisant partie
des trois derniers contingents incorporés. »
le président appelle successivement les pre-
miers orateurs inscrits : M. Félix Chautemps,
mais M. Chautemps n'est pas là ; puis M. Aubriot,
socialiste unifié, mais il n’est pas là non plus ;
et enfin M. Jaurès, le troisième inscrit. M. Jaurès
est là et parle. . _
m. Jaurès combat l’article 18 II s étonne sur
tout de l’incorporation à 20 ans. Va-t-on maintenir
en octobre quatre classes sous les drapeaux ?
C’est impossible ! Va-t-on donc libérer la classe
1910 dont on avait annoncé bruyamment le main
tien ? Mais alors pourquoi ce maintien tapageur et
brutal qui a déchaîné les mutineries ? Et pourquoi
avoir remué tout le pays en disant qu’il fallait en
octobre avoir trois classes dont deux instruites
puisqu’on en aura deux non instruites sur trois ?
L’argumentation essentielle sur laquelle était
fondée la loi de trois classes, dont deux instruites
est désormais ruinée, tout l'édifice s’écroule. Vous
nous disiez : « il faut parer au plus pressé.» Vous
n’y parez plus. Alors a quoi bon votre loi ?
Votre œuvre a d’ailleurs d'autres defauts . en
fait vous rétablissez la deuxième portion du con
tingent. L’égalité sera encore comme uue ensei
gne sur votre loi, mais elle ne sera plus dans la
Vous ouvrez la porte à l’arbitraire. On libérera
d’après le surnombre, mais ce surnombre qui le
déterminera ? Votre loi vivra quelques mois tré
buchante et chancelante ; elle croulera sous le
poids de ses contradictions et de l'esprit républi
cain qui la condamne. (Applaudissements a 1 ex
trême gauche.)
m. pâté, rapporteur, répond :
M. Jaurès a rouvert, dit-il, une discussion géne
raie qu’on croyait close. (Très bien ! Tués bien )
Quelques-unes de ces observations portent sur
un article, mais c’est sur l’article 19. -
Sur l’incorporation à vingt ans, la Commission
ne s’est pas encore prononcée, on n'a pas le droit
de préjuger son vote sur ce point. La discussion
viendra naturellement à propos de l article 6.
M. DE LANESSAN : J’ai touiours voté jusqu ici
A LA CHAMBRE
' avec la Commission. Mais si vous voulez obtenu
un vote sur le principe de la loi de trois ans sand
avoir répondu aux objections qui vous ont ét
faites, nous nous y refusons. (Applaudissements
à l’extrême gauche et à gauche. — Mouvements
divers.)
m. daté : Relisez l’article 18 et dites-moi si
l’incorporation a vingt ans peut s’y poser. Elle
se posera sur d’autres articles, pas sur celui-là. Je
demande le voie de l’article 18. (Très bien I Très
bien ! au centre).
La c ôture est demandée.
m. Daniel Vincent, radical socialiste, parle
contre la clôture.
Il fait observer que deux questions sont soumi
ses à la Crambre : celle de la durée du service et
celle du principe d’égalité dans le service mili
taire. La seconde prime la première.
Pourquoi ne veut-on pas qu’on parle d’abord du
principe d’égalité, qui corrobore celui de l’obliga.
tion ?
L’orateur insiste pour que la Chambre discute
l’amendement qu’il a déposé à ce sujet
m. le hérissé, président de la Commission,
dit que la commission est a la disposition de la
Chambre ; mais il estime que la méthode propo
sée par ede est la plus simple et la plus logique.
En premier lieu il y aurait lieu de statuer sur le
service de trois ans. on examinerait ensuite les
modalités d’application.
Sur la question d égalité, la Commission n’a pas
varié d'opinion.
L’orateur insiste pour que la Chambre statue
sur l’article 18 et que l’amendement de M. Danie
Vincent vienne sur l’article 19. ((Très bien au cen
tre et sur divers bancs à gauche. Interruptions d
l’extrême gauche)
Vo
Le scrutin donne lieu au pointage.
Par 314 voix contre 856, la clôture est pronon
cée.
m. le président fait connaître que M Daniel
Vincent a déposé un amendement ainsi conçu :
« Tous les hommes reconnus aptes au service
militaire sont tenus d’accomplir effectivement la
même durée de service »
M. le hérissé, président de la Commission de
l’armée : La Commission, d’accord avec le gou
vernement. demande à la Chambre de se pronon-
cer sur l’amendement de M. Vincent qui pose un
principe qu’elle n’a .jamais contesté et qu’elle act
cepte.
M. ETIENNE, ministre de la guerre, déclare
qu’en adoptant ‘amendement de M. Vincent, la
Commission reprend le texte proposé par le Gou-
vérnement dans son projet.
Le Gouvernement ne fait pas opposition à l’adop
tion de l’amendement. (Très bien ! Très bien 8)
m daniel-vincent remercie la Commission
et le Ministre de la guerre d’avoir accepté son
amendement.
Il précise les termes de son amendement qus
vise a la fois la durée du service et la manière de
remplir cette durée.
Il coupe court aux libérations anticipées, aux
affectations spéciales et aux modalités indiquées
ailleurs qu’ici pour certaines catégories de militai
res (Applaudissements à l’extrême gauche et à
ailleurs qu’ici
gauche).
M. JOSEPH REINACH dit qu’il n’éprouve aucune
difficulté a voter l’amendement.
L’article 18 du projet fixe la durée du service de
l’armée active.
La Commission avait prévu, dans l’article 19,
une série de libérations anticipées. Pourquoi ?
Quand s’est posée la question du service de 3
ans, il a été entendu qu’on devait faire tout l’ef
fort nécessaire et rien que cela.
La Commission a demandé au Gouvernement
d’interroger le Conseil supérieur et de lui deman
der quels étaient les effectifs nécessaires.
Ces effectifs sont indiqués aux annexes de l’ar
ticle 2.
Par l’article 19, la Commission proposait de ren
voyer en congé le surnombre : familles nombreu
ses, soutiens de famille, après deux ans ou après
trente mois de service.
C’est l’ensemble des dispositions de l’article 19
qui vont tomber par le vote de l’amendement.
Au point de vue militaire, l’amendement aug
mente les effectifs d’une façon considérable. La-
Commission l’accepte.
Au point de vue économique et social, que la
Commission avait voulu sauvegarder, les avanta
ges prévus par l’article 19 tombent par le vote de
l’amendement.
Comme l’intérêt militaire domine la question,
les effectifs minima seront plus forts et l’orateur
s’en rejouit.
Mais, après le vote de l’amendement, M. Daniel-
Vincent et ses amis voteront-ils le service de trois
ans ? (Vifs applaudissements )
M LE PRÉSIDENT fait connaître qu’il a reçu
de M. J.-L Breton une disposition additionnelle à
l’amendement de M. Vincent.
« La présente disposition n’est pas applicab’e
aux mesures ayant pour objet exclusif de mainte
nir et de développer la population du pays. » (Ex
clamations sur divers bancs.)
m. le président met aux voix l’amendement
de M. Daniel Vincent auquel s’est rallié M. Cha-
nal.
Par 674 voix contre 2, cet
adopté? (Applaudissements).
m. breton insiste en faveur
ment.
amendement es)
de son amende-
COMMISSION dit
M. LE PRÉSIDENT DE LA
qu’après la manifestation faite par la Chambre sur
l’amendement de M. Daniel Vincent, d’accord avec
le gouvernement, il repousse ‘amendement.
(Très bien ! Très bien !)
M. LE MINISTRE DE LA GUERRE fait la même
déclaration. Le gouvernement repousse l’amende
ment de M. Breton dans son esprit comme dans
sa forme. (Applaudissements).
m AUGAGNEUR dit qu’il votera contre I amende
ment, quelle que soit son opinion sur le fond. Il
y a d’autres manières de venir en aide aux famil
les nombreuses, et il est prêt à voter les mesures
nécessaires. (Applaudissements à gauche.)
M. JAURÈS fait observer que si, par hasard. I8-
mendement de M. Breton était voté, il serait le
commencement d’une série. .
m. le président met aux voix la prise en con
sidération de l’amendement. , , —
Par 364 voix contra 210, 1 amendement n est pas
pris en considération.
m DELACHENAL soutient ‘amendement sui
vant • « La présente disposition n’exclut pas da
vantage les mesures ayant pour but de remédier à
la dépopulation des campagnes. »
M. LE PRÉSIDENT DE LA. COMMISSION : La
Commission, d’accord avec le gouvernement, re
pousse l’amendement. . . .
Par 428 voix contre 145, l’amendement n est par
pris en considération.
Les deux premiers paragraphes du projet sont
adoptés. . . n
m. de je ante a la parole sur le paragraphe 3
relatif au service de trois ans.
Comme ouvrier et représentant de la population
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.82%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.82%.
- Auteurs similaires Fénoux Hippolyte Fénoux Hippolyte /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Fénoux Hippolyte" or dc.contributor adj "Fénoux Hippolyte")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/6
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t52637759v/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t52637759v/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t52637759v/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t52637759v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t52637759v
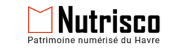


Facebook
Twitter