Titre : Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses
Auteur : Société havraise d'études diverses. Auteur du texte
Éditeur : Impr. Lepelletier (Hâvre)
Éditeur : Société havraise d'études diversesSociété havraise d'études diverses (Le Havre)
Date d'édition : 1917-07-01
Contributeur : Michaud, Charles (secrétaire de la Société havraise d'études diverses). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849663k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 37174 Nombre total de vues : 37174
Description : 01 juillet 1917 01 juillet 1917
Description : 1917/07/01 (A84)-1917/09/30. 1917/07/01 (A84)-1917/09/30.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5775515b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-157961
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
- 305 -
Fait symptomatique et qui en dit long sur l'attrait qu'exer-
çaient déjà les Antilles, c'est à partir de 1634 qu'apparaissent,
non seulement les colons venant en France recruter des
engagés, mais aussi les premiers départs libres pour Saint-
Christophe.
Au lieu de se mettre au service de la Compagnie ou de
maîtres, certains émigrants passaient d'eux-mêmes, assumant
les frais du voyage, désireux de tenter la chance aux îles.
Le prix de la traversée est légèrement variable. Il s'éloigne
peu, toutefois, de celui convenu, le 2 février 1634, entre
François Bacoin, François et Pierre Loquet frères, du Havre,
et Jean Le Perquier, capitaine de la Marie, soit 30 livres au
comptant par homme avant le départ, et 50 livres de petun
chacun huit jours après l'arrivée à Saint-Christophe.
Le capitaine devait les nourrir, pendant le voyage, de la
même façon que l'équipage ; au cas où ils ne s'embarqueraient
pas, l'argent versé restait sa propriété.
Ce navire, de cinquante tonneaux et dix-huit hommes d'é-
quipage, partait avec l'autorisation de la Compagnie. Le
capitaine s'obligeait envers Cavelet à séjourner trente jours à
Saint-Christophe et à y embarquer le petun. et les autres
marchandises qui lui seraient délivrés, pour le compte de la
Compagnie, après son chargement terminé (1).
D'autres engagements sont contractés avec des maîtres à
des conditions sensiblement équivalentes à celles précédem-
ment mentionnées, moyennant une certaine quantité de
(1) Cette stipulation trop imprécise et susceptible de donner lieu à des contesta-
tions, fut promptement remplacée par d'autres moins vagues. Les navires partant du
Havre devaient porter pour la Compagnie trois à quatre tonneaux de marchandises
ou de munitions et deux engagés, et charger aux Antilles, sans payer de fret, la
onzième partie de leur cargaison. A défaut d'engagés, les capitaines étaient tenus de
livrer huit mousquets bous à l'épreuve. (Convention du Grand-Henry, 18 juillet 1635).
Ces obligations survécurent aux causes qui les avaient fait imposer et se perpé-
tuèrent jusqu'à la Révolution. D'abord représentées par le transport de trois à six
engagés par navire, suivant le tonnage, et de quatre fusils boucaniers ou de chasse,
elles furent transformées par la suite en une imposition de 360 1. par navire et par
voyage. Le cahier des doléances du commerce du Havre, en 1789, en réclame encore
la suppression. Sous le Consulat, à la reprise des transactions coloniales pendant
l'éphémère paix d'Amiens, l'arrêté du 6 juin 1802 obligea simplement les armateurs
à embarquer deux passagers par cent tonneaux de port, avec exonération du prix des
voyages pour les places non utilisées.
Fait symptomatique et qui en dit long sur l'attrait qu'exer-
çaient déjà les Antilles, c'est à partir de 1634 qu'apparaissent,
non seulement les colons venant en France recruter des
engagés, mais aussi les premiers départs libres pour Saint-
Christophe.
Au lieu de se mettre au service de la Compagnie ou de
maîtres, certains émigrants passaient d'eux-mêmes, assumant
les frais du voyage, désireux de tenter la chance aux îles.
Le prix de la traversée est légèrement variable. Il s'éloigne
peu, toutefois, de celui convenu, le 2 février 1634, entre
François Bacoin, François et Pierre Loquet frères, du Havre,
et Jean Le Perquier, capitaine de la Marie, soit 30 livres au
comptant par homme avant le départ, et 50 livres de petun
chacun huit jours après l'arrivée à Saint-Christophe.
Le capitaine devait les nourrir, pendant le voyage, de la
même façon que l'équipage ; au cas où ils ne s'embarqueraient
pas, l'argent versé restait sa propriété.
Ce navire, de cinquante tonneaux et dix-huit hommes d'é-
quipage, partait avec l'autorisation de la Compagnie. Le
capitaine s'obligeait envers Cavelet à séjourner trente jours à
Saint-Christophe et à y embarquer le petun. et les autres
marchandises qui lui seraient délivrés, pour le compte de la
Compagnie, après son chargement terminé (1).
D'autres engagements sont contractés avec des maîtres à
des conditions sensiblement équivalentes à celles précédem-
ment mentionnées, moyennant une certaine quantité de
(1) Cette stipulation trop imprécise et susceptible de donner lieu à des contesta-
tions, fut promptement remplacée par d'autres moins vagues. Les navires partant du
Havre devaient porter pour la Compagnie trois à quatre tonneaux de marchandises
ou de munitions et deux engagés, et charger aux Antilles, sans payer de fret, la
onzième partie de leur cargaison. A défaut d'engagés, les capitaines étaient tenus de
livrer huit mousquets bous à l'épreuve. (Convention du Grand-Henry, 18 juillet 1635).
Ces obligations survécurent aux causes qui les avaient fait imposer et se perpé-
tuèrent jusqu'à la Révolution. D'abord représentées par le transport de trois à six
engagés par navire, suivant le tonnage, et de quatre fusils boucaniers ou de chasse,
elles furent transformées par la suite en une imposition de 360 1. par navire et par
voyage. Le cahier des doléances du commerce du Havre, en 1789, en réclame encore
la suppression. Sous le Consulat, à la reprise des transactions coloniales pendant
l'éphémère paix d'Amiens, l'arrêté du 6 juin 1802 obligea simplement les armateurs
à embarquer deux passagers par cent tonneaux de port, avec exonération du prix des
voyages pour les places non utilisées.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.98%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.98%.
- Auteurs similaires Société havraise d'études diverses Société havraise d'études diverses /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Société havraise d'études diverses" or dc.contributor adj "Société havraise d'études diverses")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 67/126
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k5775515b/f67.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k5775515b/f67.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k5775515b/f67.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k5775515b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k5775515b
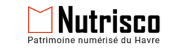


Facebook
Twitter