Titre : L'Universel : l'Évangile c'est la liberté ! / direction H. Huchet
Auteur : Mouvement pacifique chrétien de langue française. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Le Havre)
Date d'édition : 1924-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32885496v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 mai 1924 01 mai 1924
Description : 1924/05/01-1924/05/31. 1924/05/01-1924/05/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional :... Collection numérique : Fonds régional : Haute-Normandie
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k4565281b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-45090
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/09/2017
26* ANNÉE
MENSUEL
kkimjt llu vî^X
i f «>M{t U N
! &LJB76 ;
^ -i Q 9.
MAI i 924
L’URI VERSEL
Fondé en 1898, supprimé par la censure militaire pendant la Guerre mondiale
Mouoement Pacifique Chrétien
« l’internationale de l’amour »
Directeur-Fondateur : Henri HUCHET.
RÉDACTION :
D r M. DUMESNIL, Rédacteur en chef.
ERMENONVILLE, GRILLOT DE GIVRY, Colonel CONVERSET, Frédéric BONHOMME,
Mmes H. DUMESNIL-HUCHET, Claire GÉNIAUX,
Général PERCIN, Louis GUÉTANT, Joël THÉZARD,
M. J. ELLIOTT, Mme MARFURT-TORFS, Hermann KUTTER
Les articles n'engagent que leurs auteurs
ADMINISTRATION :
Abonnement :
Chèques postaux :
Un an 5 francs.
Dr DUMESNIL
Le numéro O fr. 25
PARIS n° 217.31
Souscriptions :
Membre adhérent 5 francs.
Membre actif 1 O francs.
Membre militant.... 20 francs.
COURBEVOIE (Seine)
PAR LA PAUVRETÉ
LE CAPITALISME ENGENDRE
LA GUERRE
L’ESPRIT ÉVANGÉLIQUE DE PAUVRETÉ
EST LE FONDEMENT DE LA PAIX.
Ce nous est un grand plaisir de pouvoir donner a
nos lecteurs le texte de la conférence si ardente de
sincérité, si nourrie de foi, si imprégnée d'esprit
chrétien, que l'abbé Demulier a faite à la réunion du
Mouvement Pacifique Chrétien à Paris, le 23 avril
dernier. Nous avons constaté une fois de plus combien
vaines étaient les barrières dogmatiques, ecclésiastiques
ou politiques édifiées par les hommes, et qu'il est un
terrain d'union — union profonde des âmes, union
mystique —où l’on se rencontre vraiment : c'est celui
de la sincérité totale, de la foi vivante, et de l'amour.
N. D. L. R.
Sommes-nous d’accord sur ce point fondamen
tal : la paix doit avoir pour base l’amour univer
sel du prochain et l’amour universel du prochain
n’est possible que s’il est fondé sur l’amour de
Dieu ?
Si oui, il vous sera facile d’être d’accord sur le
reste.
Pour que l’amour de Dieu se conserve dans
un cœur, pour qu’il y grandisse — il ne peut s’y
conserver qu’à la condition d’y grandir •—
il doit y être accompagné des vertus ordonnées
par l’Evangile.
Je suis venu sur la terre pour qu’ils aient la
vie avec surabondance a dit J. C. Je suis venu
apporter à la terre le feu de l’amour et ma vo
lonté c’est qu’il embrase l’humanité tout entière.
Voilà le but.
Et voici les moyens :
Venez à mon école, car je suis doux et humble
d e cœur.
Bienheureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté.
C’est la première des huit béatitudes du sermon
sur la montagne.
J. C. indique pour quels motifs nous devons
aimer la pauvreté. « Ton œil est la lampe de ton
corps ; si ton œil est net, ton corps tout entier
sera éclairé ; mais si ton œil est vicié, tout ton
corps sera dans l’obscurité. » Le reste du corps,
ne voyant pas clair par lui-même, ne pourra se
conduire, si l’œil, qui en est la lampe, est éteint
par la maladie ; de même l’homme deviendra
incapable de marcher vers sa fin, c’est-à-dire de
s’unir à Dieu par l’amour, si son cœur, qui doit
le guider, est vicié et aveuglé par l’amour des
biens terrestres. N’aimant pas Dieu il sera inca
pable d’aimer tout son prochain comme lui-
même ; il ne pourra pas être un bon ouvrier de
la paix.
« Personne ne peut servir deux maîtres, car ou
bien il détestera l’un et aimera l’autie, ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. Aussi
je vous dis : Soyez sans inquiétude sur la nourri
ture pour votre vie, et sur le vêtement pour votre
corps. Ne dites pas : Que mangerons-nous ? De
quoi nous vêtirons-nous ? Aux païens de s’enqué
rir de ces choses. Votre Père sait bien tout ce
dont vous avez besoin. »
Quoi de plus touchant que cette leçon de con
fiance filiale en la Providence ? L’homme, tout
en obéissant à la loi du travail, n’a qu’à s’en
remettre à elle. Celui qui donne la nourriture
aux passereaux et une si riche parure aux lis des
champs a pour l’homme bien d’autres trésors en
réserve. Il les lui départira d'autant plus libéra
lement que l’homme s’appliquera avec plus de
générosité à la recherche du royaume de Dieu,
de son amour.
Avant de passer aux autres béatitudes le Sau
veur commence donc par extirper du cœur de
l’homme l’amour de la richesse. C’est que l’amour
de l’argent, la cupidité, opposée au détachement,
est le principe, le fond, la racine de tous nos
•maux- ,, . .,
J’avais cru, me direz-vous, que c’était 1 orgueil
dont nous lisons « qu’ilest le commencement de
tout péché». Sans doute et je vous accorderais
même que l’orgueil en est la racine. Mais n’ya-
t-il pas quelque chose de plus profond encore,
de plus actif que la racine ? Le chevelu va saisir
les sucs de la terre pour en nourrir la racine, qui
elle-même en nourrira la plante ; or les richesses
sont ces sucs terrestres que la cupidité recherche,
absorbe, s’assimile pour les incorporer à la racine
de l’orgueil et pousser au dehors une végétation
viciée. Détruire l’amour de l’argent, le rem
placer par l’amour de la pauvreté c’est donc plus
que couper le mal dans sa racine.
Une tumeur s’est produite sur un membre ; elle
endolorit les nerfs, les articulations, le corps
entier. Sans doute c’est la tumeur qui est cause
occasionnelle du désordre ; mais un coup d’œil
habile découvre que la tumeur résulte d’un vice
dn sang, et une main exercée portera le remède
jusque dans les profondeurs de l’organisme. Or
la tumeur est aux douleurs qu’elle cause ce qu’est
l’orgueil aux péchés qu’il engendre, et le vice du
sang est à la tumeur ce qu’est l’amour de l’argent
à l’orgueil de la vie. C’est la pensée de St-Augus-
tin qui nous dit que le genre humain était un
grand malade gisant sur la terre, que ni la loi
naturelle, ni la loi mosaïque n’ont pu guérir, que
le grand médecin est venu, rectifiant nos idées
sur la nature du mal, portant le remède à sa
source.
Oui, J. C. atteint le mal dans sa source en dé
truisant le préjugé le plus inhérent au mal de
notre nature, préjugé de malheur attaché à la
pauvreté, préjugé de bonheur attaché à la fortune.
Voilà ce que détruit du premier coup cette parole :
heureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté !
Imaginez-vous l’impression que dut faire cette
sentence du Sauveur sur le peuple assemblé sur
la montagne. Figurez-vous l’effet de cette parole
ne bouleverse-t-elle pas encore toutes nos idées
et le désordre actuel qui règne en Europe, les
alliances que nos diplomates recherchent déjà en
vue de la prochaine guerre ne sont-ils pas les
effets de l’oubli de ce principe : le bonheur réside
dans l’esprit de pauvreté ? Le comité des Forges
veut les charbons de la Sarre et de la Ruhr et,
pour maintenir les armements, on fait appel à
l 'avarice du peuple français en lui disant : l'Alle
magne doit payer, l’Allemagne ne veut pas payer.
« Malheur à vous, riches, avait dit J. C. parce
que vous avezvotreconsolation ; malheur à vous
qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim ».
« Il est plus difficile à un riche d’entrer dans le
royaume des cieux qu’à un chameau de passer par
le trou d’une aiguille.
Le Psalmiste n’avait-il pas prophétisé que toute
la gloire de la sainte Eglise serait cachée et inté
rieure ?
Il faut relire à ce sujet une page de Bossuet
tirée de son célèbre sermon sur « l’éminente
dignité des pauvres dans l’Eglise ».
« Comme J. C. est venu au monde pour ren
verser l’ordre que l’orgueil y a établi ; de là vient
que sa politique est directement opposée à celle
du siècle : et je remarque cette opposition prin
cipalement en trois choses :
i° Dans le monde, les riches ont tout l’avantage
et tiennent les premiers rangs : dans le royaume
de J. C. la prééminence appartient aux pauvres
qui sont les premiers-nés de l’Eglise et ses véri
tables enfants.
2 ° Dans le monde les pauvres sont soumis aux
riches et ne semblent nés que pour les servir ;
au contraire, dans l’Eglise, les riches n’y sont
admis qu’à condition de servir les pauvres.
3° Dans le monde les grâces et les privilèges
sont pour les puissants et les riches ; les pauvres
n’ÿ ont de part que par leur appui : au lieu que
dans l’Eglise de J. C. les grâces et les bénédic
tions sont pour les pauvres, et les riches n’ont de
privilèges que par leur moyen.
Ainsi s’accomplit déjà dans la vie présente la
parole de l’Evangile : « Les derniers sont les
premiers, et les premiers sont les derniers »,
puisque les pauvres, qui sont les derniers dans le
monde, sont les premiers dans l’Eglise ; puisque
les riches, qui s’imaginent que tout leur est dû,
et qui foulent au pied les pauvres, ne sont dans
l’Eglise que pour les servir ; puisque les grâces
de la Nouvelle Loi appartiennent de droit aux
pauvres et que les riches ne les reçoivent que
par leurs mains. »
Vous me direz peut-être : j’admets que l’esprit
de détachement, l’abandon à la Providence est
une source de bonheur pour les individus, mais
la richesse n’est-elle pasla condition de la prospé
rité d’une nation ? Ce n’est pas l’avis de S.Chrysos-
tome. S. Chrysostome nous représente deux villes,
dont l’une ne soit composée que de riches, l’autre
de pauvres, et il examine laquelle des deux est la
plus puissante. Il conclut pour celle des pauvres,
et il se fonde sur cette raison que cette ville de
riches aurait beaucoup d’éclat et de pompe, mais
qu’elle serait sans force et sans fondement assuré.
L’abondance, ennemie du travail, incapable de
se contraindre, et par conséquent toujours em-
portéedansla recherche desvoluptés, corromprait
tous les esprits, et amollirait tous les courages par
le luxe, par l’orgueil, par l’oisiveté. Ainsi les arts
seraient négligés, la terre peu, cultivée ; les ou
vrages laborieux, par lesquels le genre humain
se conserve, entièrement délaissés ; et cette ville
pompeuse, sans avoir besoin d’autres ennemis,
tomberait enfin par elle-même, ruinée par son
opulence.
Au contraire, dans l’autre ville où il n’y aurait
que des pauvres, la nécessité, industrieuse appli
querait les esprits par le besoin, les aiguiserait
par l’étude, leur inspirerait une vigueur mâle par
l’exercice de la patience ; et, n’épargnant pas les
sueu.rs, elle activerait les grands ouvrages qui
exigent nécessairement un grand travail.
Aussi S. Chrys. adjuge la préférence à la pau
vreté, même pour les collectivités, même pour
les nations.
Les richesses et l’abondance étaient promises
à la synagogue. Il fallait cela à ces enfants pour
les amuser. Mais la souffrance est le pain des.forts.
J.-C. annonce à ses disciples les persécutions et
la pauvreté. Les pauvres deviennent les véritables
citoyens de l’Eglise. « Allez-vous en dans les
coins des rues et amenez-moi promptement, qui ?
les pauvres et les infirmes ; qui encore ? les aveu
gles et les impotents. C’est de quoi il prétend
remplir sa maison ; il n’y veut rien voir qui ne
soit faible, parce qu’il n’v veut rien voir qui n’y
porte son caractère, c’est-à-dire la croix et l’in
firmité.
C’est aux pauvres qu’il a été envoyé. « Voyez,
disait Saint Paul, il n’y a pas dans l’Eglise plu
sieurs sages selon le monde, il n’y a pas plusieurs
puissants, il n’y a pas plusieurs nobles ; mais
Dieu a voulu choisir ce qu’il y avait de méprisable.
L’Eglise primitive était une assemblée de
pauvres. Si les riches y étaient reçus, ce n’était
qu’à condition de se dépouiller de leurs biens.
Pendant près de trois siècles le christianisme fut
à Rome la religion des esclaves. Je lisais dans
une brochure pacifiste. Les Hontes de la guerre,
que l’Eglise n’a pas converti Constantin, que c’est
Constantin qui a converti l’Eglise. C’est une bou
tade. Mais toute exagération contient une part
de vérité. Plus l’Eglise a été pauvre, plus elle a
été fidèle à sa mission.
Si l’Eglise était restée pauvre, si ses ministres
avaient eu plus de foi, plus de confiance dans la
parole divine, aurait-elle eu pour le capitalisme,
qui a porté à son comble la poursuite des biens
matériels, l’appât de lucre, la soif de la richesse,
aurait-elle eu... la tolérance qu’elle a pour lui
depuis un siècle ?
« Si vous prêtez à ceux de qui vous espérer
recevoir, quel remerciement méritez-vous ? car
les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs pour en
recevoir pareil avantage. Mais vous, aimez vos
ennemis, faites-le bien et prêtez sans en rien es
pérer ».
Ce texte de l’Evangile a fait couler des flots
d’encre. Puisque l’Evangile défend d’espérer prêt
pour prêt, combien plus d’espérer quelque chose
de plus qu’on n’a prêté. C’est la question de
l’usure que la fameuse encyclique Vix pervenit
de Benoît XIV définit ainsi :
« L’espèce de péché qui se nomme usure con
siste en ce que celui qui prête veut qu’en raison de
ce prêt lui-même on lui rende plus qu’il n’a prêté,
et prétend ainsi qu’il lui est dû, outre le capital,
un certain profit. »
C’est le grave problème de capitalisme qui est
ainsi posé. Déjà l’antiquité païenneTavait résolu
d’une façon formelle. « De toutes les manières
d’acquérir, disait Aristote en parlant de prêt à
intérêt, c’est %.elle qui est le plus contre nature.
Cicéron {De ojficiis l. 2 ) et Sénèque [De benefi-
ciis) Papinien et d’autres condamnaient le prêt à
intérêt au même titre qu’ils condamnâien
l’homicide.
La loi juive n’était pas moins sévère ; je vous
ferai grâce des nombreux textes de l’A. T. qui
condamnent l’usure. Ce n’était pas une loi tem
poraire, mais bien une loi morale, basée sur la
justice, obligatoire pour les chrétiens puisque le
christianisme n’a fait qu’épurer et compléter la
loi de Moïse. La tradition des Pères de l’Eglise
et des conciles est unanime contre le prêt à inté
rêt. Le 3 e concile de Latran décide que les prê
teurs à intérêt seront privés de la communion et
même de la sépulture ecclésiastique.
S. J. Chrysostome veut retrancher « les enfan
tements monstrueux de Foret de l’argent », étouf
fer « cette exécrable fécondité ». S. Basile, Jé
rôme, Ambroise considèrent l’intérêt du prêt
comme une rapine.
Nous en sommes donc, au point de vue de
l’esprit de pauvreté non seulement au-dessous
des premiers siècles du christianisme, non seu
lement au-dessous des juifs, mais même au-des
sous des païens qui n’avaient, pour les éclairer
que la loi naturelle. Etonnez-vous, après cela,
que nous assistions au déchaînement de tous les
appétits, que les nations retournent à l’esclavage
par le service militaire obligatoire et que les sau
vages tueries collectives dont nous avons été les
témoins pendant d’interminables années nous
fassent rougir d’appartenir à l’humanité.
Cette question de capitalisme est tellement
actuelle, tellement aussi en rapport avec le sujet
que je traite ici, il est si urgent d’y apporter
remède — et aux grands maux les grands remè
des — si nous voulons que la paix règne enfin sur
la terre que je me permets d’insister sur ce point.
h La chose, ou le fonds fructifie à l’avantage de
son propriétaire ».
Ce principe a trouvé place dans les écrits et
l’enseignementdes théologiens, depuis lexv® siècle
seulement. On ne le rencontre pas alors que le
droit romain, exclu des chaires universitaires et
mis à l’index par les papes, n’avait pas encore pu
faire sentir son influence aux professeurs de droit
canon.
Un illustre écrivain, mort depuis quelques
années et dont les catholiques d’Allemagne et
d’Autriche ne sauraient assez vénérer la mémoire :
le baron de Vogelsang, a écrit ces lignes très
nettes, très énergiques, où il a condensé sa
doctrine : « l’Eglise a rejeté tout gain en
dehors du travail, comme résultant du seul
droit de- propriété. Elle regarda ce gain comme
un forfait contre la justice. L’ordre social chré
tien a rejeté par principe tout revenu autre que
j celui du travail ; ce revenu a été condamné sous
| toutes ses formes et c’est surtout sa forme la plus
i palpable, l’usure, qui a été frappée ».
; Le vieux droit allemand, si profondément
; chrétien, assurait au travail honneur et protection
et le considérait comme le seul mode d’acquisi-
! tion de la piopriété. Il posait, par exemple, en
principe, que celui dont les soins ont obtenu une
bonne récolte, a droit aux fruits de cette récolte,
quel que soit le propriétaire du terrain.
Ce principe s’introduisiten France au xn e siècle.
Peu à peu le droit précaire des serfs se convertit
en droit réel, et les fit passer à l’état de véritables
propriétaires. A qui sait pénétrer le sens de cette
évolution agraire, il apparaît clair comme le
jour qu’elle est la conséquence logique des prin
cipes que voici : il y a connexion intime entre le
droit de propriété et la loi du travail ; le droit de
propriété donne à cet axiome de justice écono-
miquè : « à chacun le produit de son travail »,
toute sa portée pratique ; ce qui défend les biens
appropriés contre toute agression étrangère, c’est
qu’ils contiennent quelque chose du propriétaire,
sa vie même, ses sueurs, le cachet de sa person
nalité.
Mais ce cachet de personnalité que l’ouvrier,
par son travail, imprime aux biens matériels et
qui est à la base du droit de propriété s’altère,
s’use, et Finit par disparaître. Sa ruine entraîne
forcément celle du droit de propriété.
Est-il besoin de rappeler la série des décrets
portés par les papes Clément IV, Sixte IV et
Jules II, relativement à l’exploitation des terres
j en friche ? Ces décrets autorisaient tout étranger
à s’emparer pour les mettre en culture, des
domaines que les propriétaires ne voulaient pas
cultiver.
Au xiri e siècle Saint Thomas d’Aquin définit la
propriété un fief prêté par Dieu, seul possesseur
de toutes choses. L’homme n’a que l’usage des
biens extérieurs qui sont destinés à toute la com
munauté humaine.
Ces principes sont-ils la condarnnation du sala
riat ? et le retour à l’esprit chrétien substituerait-
il la propriété collective des travailleurs à l’union
hybride du capital et du travail ? Je l’ignore ; je
ne défends pas ici un système économique, j’ai
voulu seulement montrer que le capitalisme est
opposé au christianisme parce qu’au lieu de faci
liter l’esprit de pauvreté nécessaire à l’amour de
Dieu et, par conséquent, à la paix, il est fondé
sur la puissance de la richesse, la négation des
devoirs de la propriété, la productivité de l’ar
gent et la poursuite effrénée du gain.
L’esprit surnaturel de pauvreté produit la mo
dération dans les désirs, permet àl’homme d’élever
plus facilement son âme vers Dieu, de l’aimer
davantage, et, comme l’amour du prochain est
inséparable de l’amour de Dieu, comme la vertu
de charité consiste à aimer Dieu dans le prochain
alors même que ce prochain serait le pire des
ennemis, il s’ensuit que l’esprit de pauvreté aug
mente l’amour de ce prochain, tue l’égoïsme
individuel et national et fait considérer la guerre,
guerre des individus, guerre des classes, guerre
des nations, comme le plus grand des crimes.
Pour réaliser cela, que faut-il ?
Pour nous faciliter son amour, Dieu s’est
revêtu de notre nature, il s’est fait l’un de nous,
plus petit que nous, le plus pauvre de nous tous,
naissant dans une étable, vivant du travail de ses
mains, à la sueur de son front, mourant dans
la plus profonde des humiliations, dans le plus
grand des dénûments. Il suffit, de croire en Lui
pour l'aimer, car, comment ne pas aimer un
Dieu qui nous a tant aimés ?
Et que faut-il pour que le monde croie en Lui?
Il faut que nous qui’croyons en Lui, nous soyons
plus unis. C’est en toutes lettres dans l’évangile
de St-Jean. Avant de donner sa vie pour nous,
Jésus adresse à son Père sa grande prière sacer
dotale et dit : « Père , qu'ils soient tous un afin
que le monde croie que vous maveq envoyé ».
C’est pour obéir à ce désir de Jésus que vous
avez fondé le Mouvement Pacifique Chrétien qui
se recrute surtout parmi les protestants, c’est
pour la même raison que j’ai pris l’initiative de
la Correspondance Catholique qui doit produire
l’unité de pensées et d’affections chez les catho
liques de France et d’Allemagne, si divisés. C’est
pour obéir à ce désir que vous m’avez invité à
prendre la parole parmi vous, afin que notre
union soit invincible et que le monde croie à la
divinité et à la mission de Jésus. A Lui seul
toute gloire, à Lui seul notre amour !
abbé Henri DEMULIER,
MENSUEL
kkimjt llu vî^X
i f «>M{t U N
! &LJB76 ;
^ -i Q 9.
MAI i 924
L’URI VERSEL
Fondé en 1898, supprimé par la censure militaire pendant la Guerre mondiale
Mouoement Pacifique Chrétien
« l’internationale de l’amour »
Directeur-Fondateur : Henri HUCHET.
RÉDACTION :
D r M. DUMESNIL, Rédacteur en chef.
ERMENONVILLE, GRILLOT DE GIVRY, Colonel CONVERSET, Frédéric BONHOMME,
Mmes H. DUMESNIL-HUCHET, Claire GÉNIAUX,
Général PERCIN, Louis GUÉTANT, Joël THÉZARD,
M. J. ELLIOTT, Mme MARFURT-TORFS, Hermann KUTTER
Les articles n'engagent que leurs auteurs
ADMINISTRATION :
Abonnement :
Chèques postaux :
Un an 5 francs.
Dr DUMESNIL
Le numéro O fr. 25
PARIS n° 217.31
Souscriptions :
Membre adhérent 5 francs.
Membre actif 1 O francs.
Membre militant.... 20 francs.
COURBEVOIE (Seine)
PAR LA PAUVRETÉ
LE CAPITALISME ENGENDRE
LA GUERRE
L’ESPRIT ÉVANGÉLIQUE DE PAUVRETÉ
EST LE FONDEMENT DE LA PAIX.
Ce nous est un grand plaisir de pouvoir donner a
nos lecteurs le texte de la conférence si ardente de
sincérité, si nourrie de foi, si imprégnée d'esprit
chrétien, que l'abbé Demulier a faite à la réunion du
Mouvement Pacifique Chrétien à Paris, le 23 avril
dernier. Nous avons constaté une fois de plus combien
vaines étaient les barrières dogmatiques, ecclésiastiques
ou politiques édifiées par les hommes, et qu'il est un
terrain d'union — union profonde des âmes, union
mystique —où l’on se rencontre vraiment : c'est celui
de la sincérité totale, de la foi vivante, et de l'amour.
N. D. L. R.
Sommes-nous d’accord sur ce point fondamen
tal : la paix doit avoir pour base l’amour univer
sel du prochain et l’amour universel du prochain
n’est possible que s’il est fondé sur l’amour de
Dieu ?
Si oui, il vous sera facile d’être d’accord sur le
reste.
Pour que l’amour de Dieu se conserve dans
un cœur, pour qu’il y grandisse — il ne peut s’y
conserver qu’à la condition d’y grandir •—
il doit y être accompagné des vertus ordonnées
par l’Evangile.
Je suis venu sur la terre pour qu’ils aient la
vie avec surabondance a dit J. C. Je suis venu
apporter à la terre le feu de l’amour et ma vo
lonté c’est qu’il embrase l’humanité tout entière.
Voilà le but.
Et voici les moyens :
Venez à mon école, car je suis doux et humble
d e cœur.
Bienheureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté.
C’est la première des huit béatitudes du sermon
sur la montagne.
J. C. indique pour quels motifs nous devons
aimer la pauvreté. « Ton œil est la lampe de ton
corps ; si ton œil est net, ton corps tout entier
sera éclairé ; mais si ton œil est vicié, tout ton
corps sera dans l’obscurité. » Le reste du corps,
ne voyant pas clair par lui-même, ne pourra se
conduire, si l’œil, qui en est la lampe, est éteint
par la maladie ; de même l’homme deviendra
incapable de marcher vers sa fin, c’est-à-dire de
s’unir à Dieu par l’amour, si son cœur, qui doit
le guider, est vicié et aveuglé par l’amour des
biens terrestres. N’aimant pas Dieu il sera inca
pable d’aimer tout son prochain comme lui-
même ; il ne pourra pas être un bon ouvrier de
la paix.
« Personne ne peut servir deux maîtres, car ou
bien il détestera l’un et aimera l’autie, ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. Aussi
je vous dis : Soyez sans inquiétude sur la nourri
ture pour votre vie, et sur le vêtement pour votre
corps. Ne dites pas : Que mangerons-nous ? De
quoi nous vêtirons-nous ? Aux païens de s’enqué
rir de ces choses. Votre Père sait bien tout ce
dont vous avez besoin. »
Quoi de plus touchant que cette leçon de con
fiance filiale en la Providence ? L’homme, tout
en obéissant à la loi du travail, n’a qu’à s’en
remettre à elle. Celui qui donne la nourriture
aux passereaux et une si riche parure aux lis des
champs a pour l’homme bien d’autres trésors en
réserve. Il les lui départira d'autant plus libéra
lement que l’homme s’appliquera avec plus de
générosité à la recherche du royaume de Dieu,
de son amour.
Avant de passer aux autres béatitudes le Sau
veur commence donc par extirper du cœur de
l’homme l’amour de la richesse. C’est que l’amour
de l’argent, la cupidité, opposée au détachement,
est le principe, le fond, la racine de tous nos
•maux- ,, . .,
J’avais cru, me direz-vous, que c’était 1 orgueil
dont nous lisons « qu’ilest le commencement de
tout péché». Sans doute et je vous accorderais
même que l’orgueil en est la racine. Mais n’ya-
t-il pas quelque chose de plus profond encore,
de plus actif que la racine ? Le chevelu va saisir
les sucs de la terre pour en nourrir la racine, qui
elle-même en nourrira la plante ; or les richesses
sont ces sucs terrestres que la cupidité recherche,
absorbe, s’assimile pour les incorporer à la racine
de l’orgueil et pousser au dehors une végétation
viciée. Détruire l’amour de l’argent, le rem
placer par l’amour de la pauvreté c’est donc plus
que couper le mal dans sa racine.
Une tumeur s’est produite sur un membre ; elle
endolorit les nerfs, les articulations, le corps
entier. Sans doute c’est la tumeur qui est cause
occasionnelle du désordre ; mais un coup d’œil
habile découvre que la tumeur résulte d’un vice
dn sang, et une main exercée portera le remède
jusque dans les profondeurs de l’organisme. Or
la tumeur est aux douleurs qu’elle cause ce qu’est
l’orgueil aux péchés qu’il engendre, et le vice du
sang est à la tumeur ce qu’est l’amour de l’argent
à l’orgueil de la vie. C’est la pensée de St-Augus-
tin qui nous dit que le genre humain était un
grand malade gisant sur la terre, que ni la loi
naturelle, ni la loi mosaïque n’ont pu guérir, que
le grand médecin est venu, rectifiant nos idées
sur la nature du mal, portant le remède à sa
source.
Oui, J. C. atteint le mal dans sa source en dé
truisant le préjugé le plus inhérent au mal de
notre nature, préjugé de malheur attaché à la
pauvreté, préjugé de bonheur attaché à la fortune.
Voilà ce que détruit du premier coup cette parole :
heureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté !
Imaginez-vous l’impression que dut faire cette
sentence du Sauveur sur le peuple assemblé sur
la montagne. Figurez-vous l’effet de cette parole
ne bouleverse-t-elle pas encore toutes nos idées
et le désordre actuel qui règne en Europe, les
alliances que nos diplomates recherchent déjà en
vue de la prochaine guerre ne sont-ils pas les
effets de l’oubli de ce principe : le bonheur réside
dans l’esprit de pauvreté ? Le comité des Forges
veut les charbons de la Sarre et de la Ruhr et,
pour maintenir les armements, on fait appel à
l 'avarice du peuple français en lui disant : l'Alle
magne doit payer, l’Allemagne ne veut pas payer.
« Malheur à vous, riches, avait dit J. C. parce
que vous avezvotreconsolation ; malheur à vous
qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim ».
« Il est plus difficile à un riche d’entrer dans le
royaume des cieux qu’à un chameau de passer par
le trou d’une aiguille.
Le Psalmiste n’avait-il pas prophétisé que toute
la gloire de la sainte Eglise serait cachée et inté
rieure ?
Il faut relire à ce sujet une page de Bossuet
tirée de son célèbre sermon sur « l’éminente
dignité des pauvres dans l’Eglise ».
« Comme J. C. est venu au monde pour ren
verser l’ordre que l’orgueil y a établi ; de là vient
que sa politique est directement opposée à celle
du siècle : et je remarque cette opposition prin
cipalement en trois choses :
i° Dans le monde, les riches ont tout l’avantage
et tiennent les premiers rangs : dans le royaume
de J. C. la prééminence appartient aux pauvres
qui sont les premiers-nés de l’Eglise et ses véri
tables enfants.
2 ° Dans le monde les pauvres sont soumis aux
riches et ne semblent nés que pour les servir ;
au contraire, dans l’Eglise, les riches n’y sont
admis qu’à condition de servir les pauvres.
3° Dans le monde les grâces et les privilèges
sont pour les puissants et les riches ; les pauvres
n’ÿ ont de part que par leur appui : au lieu que
dans l’Eglise de J. C. les grâces et les bénédic
tions sont pour les pauvres, et les riches n’ont de
privilèges que par leur moyen.
Ainsi s’accomplit déjà dans la vie présente la
parole de l’Evangile : « Les derniers sont les
premiers, et les premiers sont les derniers »,
puisque les pauvres, qui sont les derniers dans le
monde, sont les premiers dans l’Eglise ; puisque
les riches, qui s’imaginent que tout leur est dû,
et qui foulent au pied les pauvres, ne sont dans
l’Eglise que pour les servir ; puisque les grâces
de la Nouvelle Loi appartiennent de droit aux
pauvres et que les riches ne les reçoivent que
par leurs mains. »
Vous me direz peut-être : j’admets que l’esprit
de détachement, l’abandon à la Providence est
une source de bonheur pour les individus, mais
la richesse n’est-elle pasla condition de la prospé
rité d’une nation ? Ce n’est pas l’avis de S.Chrysos-
tome. S. Chrysostome nous représente deux villes,
dont l’une ne soit composée que de riches, l’autre
de pauvres, et il examine laquelle des deux est la
plus puissante. Il conclut pour celle des pauvres,
et il se fonde sur cette raison que cette ville de
riches aurait beaucoup d’éclat et de pompe, mais
qu’elle serait sans force et sans fondement assuré.
L’abondance, ennemie du travail, incapable de
se contraindre, et par conséquent toujours em-
portéedansla recherche desvoluptés, corromprait
tous les esprits, et amollirait tous les courages par
le luxe, par l’orgueil, par l’oisiveté. Ainsi les arts
seraient négligés, la terre peu, cultivée ; les ou
vrages laborieux, par lesquels le genre humain
se conserve, entièrement délaissés ; et cette ville
pompeuse, sans avoir besoin d’autres ennemis,
tomberait enfin par elle-même, ruinée par son
opulence.
Au contraire, dans l’autre ville où il n’y aurait
que des pauvres, la nécessité, industrieuse appli
querait les esprits par le besoin, les aiguiserait
par l’étude, leur inspirerait une vigueur mâle par
l’exercice de la patience ; et, n’épargnant pas les
sueu.rs, elle activerait les grands ouvrages qui
exigent nécessairement un grand travail.
Aussi S. Chrys. adjuge la préférence à la pau
vreté, même pour les collectivités, même pour
les nations.
Les richesses et l’abondance étaient promises
à la synagogue. Il fallait cela à ces enfants pour
les amuser. Mais la souffrance est le pain des.forts.
J.-C. annonce à ses disciples les persécutions et
la pauvreté. Les pauvres deviennent les véritables
citoyens de l’Eglise. « Allez-vous en dans les
coins des rues et amenez-moi promptement, qui ?
les pauvres et les infirmes ; qui encore ? les aveu
gles et les impotents. C’est de quoi il prétend
remplir sa maison ; il n’y veut rien voir qui ne
soit faible, parce qu’il n’v veut rien voir qui n’y
porte son caractère, c’est-à-dire la croix et l’in
firmité.
C’est aux pauvres qu’il a été envoyé. « Voyez,
disait Saint Paul, il n’y a pas dans l’Eglise plu
sieurs sages selon le monde, il n’y a pas plusieurs
puissants, il n’y a pas plusieurs nobles ; mais
Dieu a voulu choisir ce qu’il y avait de méprisable.
L’Eglise primitive était une assemblée de
pauvres. Si les riches y étaient reçus, ce n’était
qu’à condition de se dépouiller de leurs biens.
Pendant près de trois siècles le christianisme fut
à Rome la religion des esclaves. Je lisais dans
une brochure pacifiste. Les Hontes de la guerre,
que l’Eglise n’a pas converti Constantin, que c’est
Constantin qui a converti l’Eglise. C’est une bou
tade. Mais toute exagération contient une part
de vérité. Plus l’Eglise a été pauvre, plus elle a
été fidèle à sa mission.
Si l’Eglise était restée pauvre, si ses ministres
avaient eu plus de foi, plus de confiance dans la
parole divine, aurait-elle eu pour le capitalisme,
qui a porté à son comble la poursuite des biens
matériels, l’appât de lucre, la soif de la richesse,
aurait-elle eu... la tolérance qu’elle a pour lui
depuis un siècle ?
« Si vous prêtez à ceux de qui vous espérer
recevoir, quel remerciement méritez-vous ? car
les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs pour en
recevoir pareil avantage. Mais vous, aimez vos
ennemis, faites-le bien et prêtez sans en rien es
pérer ».
Ce texte de l’Evangile a fait couler des flots
d’encre. Puisque l’Evangile défend d’espérer prêt
pour prêt, combien plus d’espérer quelque chose
de plus qu’on n’a prêté. C’est la question de
l’usure que la fameuse encyclique Vix pervenit
de Benoît XIV définit ainsi :
« L’espèce de péché qui se nomme usure con
siste en ce que celui qui prête veut qu’en raison de
ce prêt lui-même on lui rende plus qu’il n’a prêté,
et prétend ainsi qu’il lui est dû, outre le capital,
un certain profit. »
C’est le grave problème de capitalisme qui est
ainsi posé. Déjà l’antiquité païenneTavait résolu
d’une façon formelle. « De toutes les manières
d’acquérir, disait Aristote en parlant de prêt à
intérêt, c’est %.elle qui est le plus contre nature.
Cicéron {De ojficiis l. 2 ) et Sénèque [De benefi-
ciis) Papinien et d’autres condamnaient le prêt à
intérêt au même titre qu’ils condamnâien
l’homicide.
La loi juive n’était pas moins sévère ; je vous
ferai grâce des nombreux textes de l’A. T. qui
condamnent l’usure. Ce n’était pas une loi tem
poraire, mais bien une loi morale, basée sur la
justice, obligatoire pour les chrétiens puisque le
christianisme n’a fait qu’épurer et compléter la
loi de Moïse. La tradition des Pères de l’Eglise
et des conciles est unanime contre le prêt à inté
rêt. Le 3 e concile de Latran décide que les prê
teurs à intérêt seront privés de la communion et
même de la sépulture ecclésiastique.
S. J. Chrysostome veut retrancher « les enfan
tements monstrueux de Foret de l’argent », étouf
fer « cette exécrable fécondité ». S. Basile, Jé
rôme, Ambroise considèrent l’intérêt du prêt
comme une rapine.
Nous en sommes donc, au point de vue de
l’esprit de pauvreté non seulement au-dessous
des premiers siècles du christianisme, non seu
lement au-dessous des juifs, mais même au-des
sous des païens qui n’avaient, pour les éclairer
que la loi naturelle. Etonnez-vous, après cela,
que nous assistions au déchaînement de tous les
appétits, que les nations retournent à l’esclavage
par le service militaire obligatoire et que les sau
vages tueries collectives dont nous avons été les
témoins pendant d’interminables années nous
fassent rougir d’appartenir à l’humanité.
Cette question de capitalisme est tellement
actuelle, tellement aussi en rapport avec le sujet
que je traite ici, il est si urgent d’y apporter
remède — et aux grands maux les grands remè
des — si nous voulons que la paix règne enfin sur
la terre que je me permets d’insister sur ce point.
h La chose, ou le fonds fructifie à l’avantage de
son propriétaire ».
Ce principe a trouvé place dans les écrits et
l’enseignementdes théologiens, depuis lexv® siècle
seulement. On ne le rencontre pas alors que le
droit romain, exclu des chaires universitaires et
mis à l’index par les papes, n’avait pas encore pu
faire sentir son influence aux professeurs de droit
canon.
Un illustre écrivain, mort depuis quelques
années et dont les catholiques d’Allemagne et
d’Autriche ne sauraient assez vénérer la mémoire :
le baron de Vogelsang, a écrit ces lignes très
nettes, très énergiques, où il a condensé sa
doctrine : « l’Eglise a rejeté tout gain en
dehors du travail, comme résultant du seul
droit de- propriété. Elle regarda ce gain comme
un forfait contre la justice. L’ordre social chré
tien a rejeté par principe tout revenu autre que
j celui du travail ; ce revenu a été condamné sous
| toutes ses formes et c’est surtout sa forme la plus
i palpable, l’usure, qui a été frappée ».
; Le vieux droit allemand, si profondément
; chrétien, assurait au travail honneur et protection
et le considérait comme le seul mode d’acquisi-
! tion de la piopriété. Il posait, par exemple, en
principe, que celui dont les soins ont obtenu une
bonne récolte, a droit aux fruits de cette récolte,
quel que soit le propriétaire du terrain.
Ce principe s’introduisiten France au xn e siècle.
Peu à peu le droit précaire des serfs se convertit
en droit réel, et les fit passer à l’état de véritables
propriétaires. A qui sait pénétrer le sens de cette
évolution agraire, il apparaît clair comme le
jour qu’elle est la conséquence logique des prin
cipes que voici : il y a connexion intime entre le
droit de propriété et la loi du travail ; le droit de
propriété donne à cet axiome de justice écono-
miquè : « à chacun le produit de son travail »,
toute sa portée pratique ; ce qui défend les biens
appropriés contre toute agression étrangère, c’est
qu’ils contiennent quelque chose du propriétaire,
sa vie même, ses sueurs, le cachet de sa person
nalité.
Mais ce cachet de personnalité que l’ouvrier,
par son travail, imprime aux biens matériels et
qui est à la base du droit de propriété s’altère,
s’use, et Finit par disparaître. Sa ruine entraîne
forcément celle du droit de propriété.
Est-il besoin de rappeler la série des décrets
portés par les papes Clément IV, Sixte IV et
Jules II, relativement à l’exploitation des terres
j en friche ? Ces décrets autorisaient tout étranger
à s’emparer pour les mettre en culture, des
domaines que les propriétaires ne voulaient pas
cultiver.
Au xiri e siècle Saint Thomas d’Aquin définit la
propriété un fief prêté par Dieu, seul possesseur
de toutes choses. L’homme n’a que l’usage des
biens extérieurs qui sont destinés à toute la com
munauté humaine.
Ces principes sont-ils la condarnnation du sala
riat ? et le retour à l’esprit chrétien substituerait-
il la propriété collective des travailleurs à l’union
hybride du capital et du travail ? Je l’ignore ; je
ne défends pas ici un système économique, j’ai
voulu seulement montrer que le capitalisme est
opposé au christianisme parce qu’au lieu de faci
liter l’esprit de pauvreté nécessaire à l’amour de
Dieu et, par conséquent, à la paix, il est fondé
sur la puissance de la richesse, la négation des
devoirs de la propriété, la productivité de l’ar
gent et la poursuite effrénée du gain.
L’esprit surnaturel de pauvreté produit la mo
dération dans les désirs, permet àl’homme d’élever
plus facilement son âme vers Dieu, de l’aimer
davantage, et, comme l’amour du prochain est
inséparable de l’amour de Dieu, comme la vertu
de charité consiste à aimer Dieu dans le prochain
alors même que ce prochain serait le pire des
ennemis, il s’ensuit que l’esprit de pauvreté aug
mente l’amour de ce prochain, tue l’égoïsme
individuel et national et fait considérer la guerre,
guerre des individus, guerre des classes, guerre
des nations, comme le plus grand des crimes.
Pour réaliser cela, que faut-il ?
Pour nous faciliter son amour, Dieu s’est
revêtu de notre nature, il s’est fait l’un de nous,
plus petit que nous, le plus pauvre de nous tous,
naissant dans une étable, vivant du travail de ses
mains, à la sueur de son front, mourant dans
la plus profonde des humiliations, dans le plus
grand des dénûments. Il suffit, de croire en Lui
pour l'aimer, car, comment ne pas aimer un
Dieu qui nous a tant aimés ?
Et que faut-il pour que le monde croie en Lui?
Il faut que nous qui’croyons en Lui, nous soyons
plus unis. C’est en toutes lettres dans l’évangile
de St-Jean. Avant de donner sa vie pour nous,
Jésus adresse à son Père sa grande prière sacer
dotale et dit : « Père , qu'ils soient tous un afin
que le monde croie que vous maveq envoyé ».
C’est pour obéir à ce désir de Jésus que vous
avez fondé le Mouvement Pacifique Chrétien qui
se recrute surtout parmi les protestants, c’est
pour la même raison que j’ai pris l’initiative de
la Correspondance Catholique qui doit produire
l’unité de pensées et d’affections chez les catho
liques de France et d’Allemagne, si divisés. C’est
pour obéir à ce désir que vous m’avez invité à
prendre la parole parmi vous, afin que notre
union soit invincible et que le monde croie à la
divinité et à la mission de Jésus. A Lui seul
toute gloire, à Lui seul notre amour !
abbé Henri DEMULIER,
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 88.28%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 88.28%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k4565281b/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k4565281b/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k4565281b/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k4565281b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k4565281b
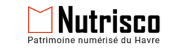


Facebook
Twitter