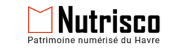Titre : Le Petit Havre : organe républicain, démocratique, socialiste ["puis" organe républicain démocratique "puis" bulletin d'informations locales]
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1913-12-01
Contributeur : Fénoux, Hippolyte (1842-1913). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836500g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 décembre 1913 01 décembre 1913
Description : 1913/12/01 (A33,N11805). 1913/12/01 (A33,N11805).
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t52638651h
Source : Bibliothèque municipale du Havre, PJ5
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/04/2023
133" Anne — T 11,805
5 Centimes — EDTTION DU MATIN — 5 Centimes (8 Pages)
lundi 1er Décembre 4993
Administrateur- Dôlégué
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Administratid
à M. O. RANDOLET
85, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havro
Administration, Impressions ot Annonces, TAL 10.47
Le Petit Havre
AU HAVRE
A PARIS
ereene ", = ee 1111 ====== ,-1--=====
AN NON CES
.. Bureau du Journal, 112, bout* de Strasbourg.
. ( L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
.. < seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le PETIT HA VHE est désigné pour les Annonces Jadlclalrss et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
ta
M
gooems o rr a
Rédaetou u Chel, Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
Adresser tout ce qui concerne la Redaction
a M. HIPPOLYTE fénoux
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE : Rédaction, N® 7.60
ABONNEMENTS
Le Ravre, la Seine-Inférieure, l’Eure,
l’Oise et la Somma
Autres Départements
Union Postale
TROIS Mois| Six Mois
4 KO
1 O F*.
10 »
» Fr.
19 se
ssæsese»
Un AN
is n.
es »
. - 20 Fr. 40 » 4
égalsmsnt, SANS FRidS, dans tous Iss Barsatx dt Posta fis g
AC »
ECM VENTE
h (
S
P"azt
itine e I
29
8
« xV Kl
- syii I S tisG ea Gln G KA
Paris, trois heures matin
LÈS INCIDENTS DE SAVERNE
T SAVERNE. — La ville était très animée hier
soir ; il ne s’est produit aucun incident dans
ta journée.
| On a aperçu de temps en temps des pa
trouilles militaires et de gendarmerie.
( À 4 heures de l’après-midi une patrouille
a arrêté, sur l’ordre d’un lieutenant un hom-
une d'Ottersiveiler qui avait, assure-t-on,
bousculé un officier.
' Le directeur du Cercle (Subdivision ad-
ministrative) est intervenu et a demandé la
puise en liberté, mais l’on ignore encore le
résultat de cette démarché.
CHEZ LES VIGNERONS DE L'AUBE
; TROYES. — Les délégués des communes et
des Associations vitico es de l’Aube, réunis à
Troyes, après un débat sur la portée de la
loi sur les appellations d'origine votés par
la Chambre, ont adopté un ordre du jour
&ans lequel ils déclarent renouveler leurs
yœux antérieurs en faveur du maintien de
la démission des Conseils municipaux des
communes vititoles et Gu-Yerus des vigne
rons de participer à aucun acte civique tant
|que leurs vins n’auront pas recouvert leur
appellation d’origine de « Champagne » sans
aucuns qualification.
MORT DE L’ÉVÊQUE CE LIMOGES
f. Limoges. — On annonce la mort de M. Re-
nouard, évêque de Limoges, dont l’état de
hanté s’etait aggravé depuis plusieurs se-
maines.
f Le défunt était âgé de 83 ans ; il était évê-
que depuis 25 ans.
HORRIBLE SUICIDE
EREMIRENONT. — Un nommé A..., âgé de
$7 ans, habitant Vecoux, s’est suicidé en ab-
sorbant un litre d’absinthe.
f La malheureux est mort au milieu d’atro-
ces souffrances.
[ On attribue cet acte de désespoir à des
chagrins mûmes.
PÉGOUD A BUCAREST
e BUCAntsT. — Le roi, le prince héritier et
de nombreuses personnalités militaires et
civiles ont assisté hier aux expériences de
l’aviateur Pégoud et ont vivement felioité
Ce dernier.
MACABRE DÉCOUVERTE
; RIVE-DE-GIER — La gendarmerie locale a
' enquêté au sujet de la découverte d’osse-
ments d’enfants faite à Lorette.
• Le docteur Lemençon, expert, a déclaré
qu’il s’agissait d’un crime commis il y a une
vingtaine d’années. L’enfant aurait été étran
glé.' Une cordelette adhérait encore aux osse-
ments du cou.
i L’enquête continue.
, , EXPLOSION DE DYNAMITE
/ Marseille.— Dans le quartier de l’Estaque,
Une baraque en bois abritant une cantine ou-
prière a été détruite par l’explosion d’une
cartouche de dynamite.
′ Il n’y a pas eu de blessés.
? LES RÉFORMES ARMÉNIENNES
Les délégués de l’Allemagne, de l’Antriche-
Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagae
et diirlande, de l’Italie, de la Rassie et de
la Suisse, réunis à Paris le dimanche 30 no
vembre pour examiner l’état présent de la
question des réformes arméniennes ont émis
le veu que les puissances ne donnent pas
satisfaction aux demandes financières de la
Turquie avant que la Sublime Porte ait for-
mellement adhéré au projet de réformes ar
méniennes qui donne le contrôle aux fonc
tionnaires européens et leur confère des
pouvoirs exécutifs.
; DERRIÈRE HEURE SPORTIVE
La Course des 24 heures
t PARIS. — Voici les résultats de la Course
les 24 heures courue à l’américaine :
| 4re équipe, Hourlier-Comès ; 2e équipe,
Oliveri-Lapize ; 3e équipe, Sergent-Cruppe-
landt ; 4 e équipe, Engel-de Ruyter.
La distance pa courue par la première
équipe a été de 873 kil. 490 mètres.
ON TROUVE
LE PETIT HAVRE à Paris
i la HIHMAIHIE ITAHHTTIOHALE
208, rue St-Lazare, 108
^(Iraiïiaubls de ma TEL TERMINUS)
===================================================
1914
sous la Troisième République ()
Par André SIEGFRIED
Samedi paraissait, chez A. Colin, à Paris,
l’ouvrage que nous avons. annoncé de
M. André Siegfried ; il a pour titre : Tableau
politique de la France de l'Ouest sous la
Troisième République. C’est une étude des
plus importantes, la première en ce genre
qui ait été entreprise et dont la portée his
torique et philosophique est appelée à un
retentissement certain dans le monde poli
tique.
Sous forme d’articles, M. André Siegfried
a déjà publié deux ou trois chapitres de
son ouvrage en ce journal. Et l’on n’a pas
oublié avec quelle précision, quelle finesse,
quelle franchise il a su déterminer l’esprit
politique de la région rouennaise ou de la
région caennaise ; comment il a su remon
ter aux causes de cet esprit particulier,
grâce à une étude minutieuse basée sur la
configuration des pays et la psychologie de
leurs habitants.
Cette même méthode, il l’a appliquée non
seulement à toute la Normandie, mais
encore à la Bretagne, au Maine, à l'Anjou,
à la Vendée. De là cet ouvrage qui forme
un tout complet, —- mais qui peut être aussi
considéré comme une partie dans un tout.
M. André Siegfried espère, en effet, me
ner à bien quelque jour, dans son ensem
ble, un Tableau politique de la France sous
la Troisième République. Tous nos vœux
l’accompagneront dans ce labeur considéra
ble d’où résultera une enquête extrême
ment documentée, une référence unique et
indispensable en ce qui concerne l'histoire
politique de la France à notre époque con
temporaine.
* *
Pour mieux souligner l’importance de
son ouvrage, nous voulons préciser ici la
méthode très scientifique de M. André
Siegfried. Nous le ferons d’après l’exposé
contenu dans l’Introduction qu’il a écrite à
son volume et qui est elle-même une véri
table étude de critique historique.
J’ai remarqué souvent dans les élections,
dit M. André Siegfried, que les opinions po
litiques sont sujettes à une répartition géo
graphique. Chaque parti ou plus exactement
chaque tendance a son domaine ; et avec un
peu d’attention l’on distingue qu’il y a des
régions po’itiques comme il y a des régions
géologiques ou économiques, et des climats
politiques comme il y a des climats natu
rels.
J’ai remarqué aussi,malgré des apparences
trompeuses, qu’il existe dans les manifesta-
lions de l’opinion une singulière continuité.
A condition de comparer des choses réelle
ment comparables entre elles, sans s’arrêter
à la fantaisie des épithètes, on aperçoit très
vite qu’à travers quarante ars de régime ré
publicain, ce sont les mêmes provinces, les
mêmes cantons, souvent jusqu’aux mêmes
communes qui restent politiquement orien
tés dans le sens des mêmes courants ou
fixés dans l’immobilité des mêmes résistan
ces. Et si l’on observe, dans un milieu
donné, la proportion des voix, on note que
fréquemment elle change fort peu, quelque
fois pas du tout.
Sous l’apparence mouvante des élections
se précisent donc des courants stables et se
dessinent des tempéraments politiques régio
naux. Il y a ainsi des tempéraments provin
ciaux, départementaux, cantonaux, commu
naux ; il y a plus exactement encore (car les
divisions administratives sont souvent fac
tices) des tempéraments politiques répondant
à ces profondes individualités naturelles qui
sont les « pays »-de France.
Quel est donc le secret de cette géo
graphie électorale où l’histoire a dessiné
des rivages, tracé des frontières et laissé
subsister des massifs résistants qu’aucune
tempête n’ébranle ? N’est-ce point que la
mentalité ancienne de chaque race se trouve
encore maintenue ou quelquefois modifiée
par l’influence du milieu qu’elle habite ?
Soumettre dès lors à une classification
géographique la France politique contem
poraine ; apprécier à l’épreuve de leur con
tinuité la réalité des opinions et des ten
dances ; sonder leur nature en voyant
comme elles « réagissent » sous l’action des
événements ; déterminer ainsi, en dressant
la topographie des partis, les liens intimes
qui les attachent au sol ou à certains sols ;
deviner par là les tempéraments politiques
divers des races et des classes, — telle est
la tâche minutieuse poursuivie par M. An
dré Siegfried.
Il fallait, pour cela, des connaissances
ethnographiques et historiques fort éten
dues, beaucoup de pénétration psycholo
gique, une faculté de démonstration abso
lument claire et limpide. A ces qualités,
M. André Siegfried joignait encore un
style sobre, alerte, souvent imagé, et, quand
il le fallait, très pittoresque. Et c’est ainsi
qu’il a pu, non seulement retrouver, mais
décrire, sur le Pays métaphysique des
idéologues, l’infinie variété des régions e
qu’il a pu éclairer merveilleusement, par
(1) Tableau politique de Ia France de l’Ouest
sous la Troisième République, par André
Siegfried. Ua volume in-80 raisin, avec 102
édites. et croquis dans le texte, et une carte
hors texte. (LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 103, Boule
vard Sain!-Michel. PARIS), broche 1% S.
I
une subtile analyse, la complexe person
nalité de la France de l’Ouest.
**
L’opinion politique d’un milieu trouve sa
manifestation la moins contestable dans les
élections diverses, encore bien que les in
dications qu’elles fournissent n’ajent ce
pendant rien d’absolu, pour les raisons que
l’on devine : abstentions, incompétence
de certains électeurs, pressions exer
cées. Puis, dans notre système politi
que, les électeurs ne votent pas sur des
choses, — comme ils feraient avec le refe
rendum, — mais sur des hommes. Enfin, il
faut compter avec la précision très relative
des programmes de certains candidats et
compter aussi avec l’exactitude très appro
ximative des épithètes dont ils se parent ;
avec la valeur réelle ou supposée de
ces épithètes, suivant les régions ou les
latitudes.
Il demeure, cependant, en dernière ana
lyse, que les élections,— et les élections
législatives surtout — restent les manifes
tations politiques les plus précises du suf
frage universel. Et c’est pourquoi M. An
dré Siegfried s’en est tenu presque exclu
sivement à l’étude des élections -législati
ves comme l’une des bases de son ouvrage.
Toutefois, deux conditions sont absolu
ment nécessaires pour tirer de ces observa
tions électorales un utile parti. Il convient
d’abord d’étudier avec grand détail la répar
tition géographique des voix, car les
chiffres d’ensemble du département ou
même de la circonscription couvrent le
plus souvent des diversités d’opinions
géographiquement localisées et qu’il faut
connaître. Il importe ensuite de s’imposer
l’observation de longues périodes, car un
scrutin pris isolément ne signifie pas grand
chose et peut prêter à de grossières erreurs.
Aussi M. André Siegfried a-t il eu soin
de ne se pas départir de ces rigoureux prin
cipes d’exégèse :
... Je me suis donc invariablement préoc
cupé, dit-il, de la répartition géographique
des votes. Le département,‘arrondissement,
la circonscription même m’ont paru être des
divisions trop étendues. Le département,
‘arrondissement sont sans doute devenus
pour les partis des cadres d’action, mais ce
ne sont pas des individualités politiques
homogènes. J’en dirai autant de la cir
conscription, dont la délimitation est uni
quement inspirée par l’intérêt électoral
du parti au pouvoir, et qui juxtapose sou
vent les éléments les plus hétérogènes dans
le seul but d’assurer le succès de tel ou tel
candidat.
C’est le canton qui m’a semblé être l’unité
poli ique la plus naturelle et la plus in
structive à observer : il est assez grand pour
ne pas entraîner à un détail excessif, et il
est en même temps assez restreint pour se
prêter à un dessin géographique très souple
des opinions politiques. Il arrive cependant
que, si petit qu’il soit, le canton lui-même
comprenne encore deux ou plusieurs ré
gions géographiques, sociales ou politiques :
par exemple, côte et intérienr, plaine et
bocage, vallée industrielle et platean agri
cole. Il devient nécessaire alors, surtout
lorsqu’on veut suivre avec soin une fron
tière d’opinions, de descendre jusqu’à la
commune.. »
Cependant, aucune tendance politique
d’une région n’a paru certaine à M. André
Siegfried que mise à l’épreuve de la du
rée. Et même, dans ce cas, lui a-t-il fallu
tenir compte de certaines circonstances
particulières.
... Chaque scrutin possède, en effet, son
atmosphère et sa situation propres. Quand
la question est bien posée, — comme en 4872
ou en 1902, — la réponse du corps électoral
prend une valeur particulière. Quand les
termes de la consultation sont confus, ou
simplement quand trop de problèmes sont
posés à la fois, —, com me en 1910 —, une
grande prudence d’interprétation s’impose...
L’élection de 1871 mise à part, toutes
les élections de la Troisième République
paraissent, à M. André Siegfried, pouvoir
se classer en deux groupes. Celles de 1877,
1883,1889,1902 et 1900 furent des élec
tions de combat où le régime républicain
fut menacé, sinon toujours dans son exis
tence, du moins dans son orientation dé
mocratique et anti-cléricale. On devra donc
considérer comme régions appartenant aux
partis de gauche, toutes celles qui leur
sont demeurées fidèles en ces heures diffi
ciles. Les élections de 1876,1881, 1893,
1898,1910 ne présentent point au même
degré ce caractère de lutte pour la vie. Ce
sont manifestement des élections d’apaise-
ment ou d’acceptation des faits accomplis.
Les régions qui demeurèrent alors fidèles
aux partis de droite, doivent être consi
dérées comme leur appartenant.
« Ainsi, dit M. André Siegfried, se déter
minent, dans l’Ouest, les deux pôles de la
vie politique. C’est de la même façon que,
sur les feuilles montrant l’évolution géolo
gique du globe, on voit les continents faire
surgir leur masse, l’affirmer ensuite et la
maintenir impérieusement contre les trans
gressions marines. »
#
* •
Telle est la méthode de M. André Sieg
fried. Il s’est préoccupé surtout de réalité;
il s’est moins attaché aux partis qu’aux ten
dances de fond. Il lui a semblé que, dans
l’Ouest du moins, la ligne de démarcation
entre les partis n’est pas entre royalistes et
républicains, entre radicaux et modérés,
mais entre la droite et la gauche — mieux
: encore, entre l’une et l’autre coalition, c’est-
à-dire « entre la tradition plus ou moins
déformée, mais toujours vivante de l’ancien
régime qui est hiérarchique, catholique et
conservatrice, —et la tradition républi
caine ou démocratique, qui est laïque, éga
litaire et d’avant-garde ».
Cette conclusion fut imposée à M. André
Siegfried par sa méthode d’investigations
entièrement objective. Il n’a eu qu’une
seule préoccupation : constater impartiale
ment la vérité. Il n’a prétendu à aucun mo
ment prouver la supériorité d'une doctrine
ou le mérite particulier d’un parti. « J’ai
voulu faire une étude politique, dit-il, nul
lement œuvre politique. »
Mais comment résister au désir de com-
prendre et d’expliquer ?
Ne semble-til pas qu’il existe des rela
tions entre le tempérament politique d’une
population et le milieu où elle vit ? Et si
elles existent, ces relations, quelles sont-
elles ? N'est-il pas vrai que certaines atmos
phères politiques localisées font penser à
certaines zones climatériques ? Pourquoi
donc tel parti prospère-t-il ici, et pourquoi
dépérit-il là-bas ?
Autant de questions auxquelles M. André
Siegfried a essayé de répondre. Il semble
bien qu’il y a pleinement réussi en ratta
chant la politique, non pas exactement à la
géographie dans le sens étroit de ce mot,
mais à ce que l’école de M. Vidal de la
Blache appelle aujourd’hui la géographie
humaine.
Le régime de la propriété, les systèmes
divers d’exploitation du sol, les modes de
groupement de 1§ population, la configura
tion même du pais, le degré de soumission
à l'autorité ecclésiastique, le caractère
même de la race, — autant d’éléments di
vers qui, par leur concours,peuvent fournir
des explications intéressantes et vraies,
mais dont œun d’eux ne serait suffisant à
lui seul pour nous donner une certitude
ou nous faire entrevoir seulement une pro
babilité.
Aussi bien faut-il rejeter cette opinion
courante suivant laquelle les élections ne
seraient qu’un domaine d’incohérence et de
fantaisie. Une étude sérieuse a conduit M.
André Siegfried à une conclusion tout à fait
contraire. Et, dit-il, si selon le mot de Gœ-
the « l’enfer a ses lois », pourquoi la poli
tique n’aurait-elle pas les siennes ?
Dans un prochain article nous montre
rons avec quelle délicatesse, quelle subti
lité d’observation, avec quelle élégance
d’expression M. André Siegfried a su pré
ciser ces lois dans la vaste région étudiée
en son présent ouvrage.
Th. Vallée.
LA MUTUALITÉ
Une Déclaration de M. Jules Siegfried
M. Anatole Weber, dans une série d’articles pu
bliés par le journal Le Temps et qui ont eu un
grand retentissement, a soumis la mutualité fran
çaise à une critique rigoureuse. Dans l’espoir,
comme il disait lui-même, « de contribuer à l’a
mélioration d’une œuvre dont on a le droit d’at-
tendre les plus grands services, à condition de
mieux coordonner les énormes efforts faits à
son profit», il s’efforçait de dissiper « quel
ques mirages y ; il s’attachait à démontrer que
les sociétés de secours ne reposent sur au
cune base scientifique : « Les plus élémenlai-
res prescriptions de la science acluarielle, très
justement ‘imposées aux moindres sociétés de
prévoyance, sont, disait-il, totalement inconnues
des groupes mutualistes ; l’effort personnel con
senti par les contractants étant notoirement insuf
fisant, l’œuvre ne peut vivre que par un apport,
de plus en plus considérable et de plus en plus
âprement sollicité, de la bienfaisance privée ou
publique ; les dépenses de gestion sont exagérées
et dépassent de beaucoup celles de la plupart des
entreprises d’assurances dites à forme mutuel-
le « »
À ces critiques, un éminent collaborateur du
même journal Le Temps, M. Paul Delombre, a dé
jà répondu dans un article où il faisait observer
tout d’abord que « la mutualité n’est pas une affai
re » et que « ses bilans ne sauraient être ni éta
blis ni jugés comme ceux d’une société ordinai
re ». En effet, ses apports consistent surtout en
hommes ; ses bénéfices sont encore plus d’ordre
moral que d’ordre matériel. « Par la mutualité
sont éveillés ou avivés le sentiment de la respon
sabilité personnelle, l’esprit de prévoyance, l’ef-
fort pour la garantie du travail libre et la sauve»
garde du foyer domestique. »
Mais, dit M. Charles Dulot, auteur de cette en
quête ouverte sur la mutualité, « ces observations
de notre collaborateur ne pouvaient nous dispen
ser de mettre en face des criliques de M. Anatole
Weber les réponses des mutualistes, ainsi que les
appréciations désintéressées des hommes qui ont
vu fonctionner les œuvres mutualistes. C’est en
effet une règle d’impartialité que nous nous im
posons dans toute controverse sociale ou écono
mique — surtout quand la controverse a été dé»
terminée par une enquête du Temps. »
M. Charles Dulot a donc demandé tout d’abord
son opinion dans ce débat à M. Jules Siegfried,
ancien ministre, président du Comité de direction
du Musée social, qui est particulièrement qualifié
pour apprécier le rôle social de la Mutualité.
Voici la réponse de M. Jules Siegfried:
M. Anatole Weber a étudié avec un zèle
redoutable la situation de la mutualité fran
çaise et l’a passée au crible d’une critique
impitoyable. Peut-être eût il été bien avisé
en tenant compte des différents points de
vue auxquels il convient de se placer pour
avoir une idée exacte de cette grande et belle
institution sociale.
M. Weber prend les chiffres d21910 concer
nant les Sociétés de secours mutuels approu
vées et montre qu’elles ont dépensé une
somme de 52 millions de francs. Le montant
des cotisations n’ayant été que de 39 mil-
lions — soit une moyenne de 12 fr. 40 par
membre —• l’insuffisance est de 13 millions,
comblée par les cotisations des membres
| honoraires et les subventions de l’Eat.
LES HYDRAVIONS AU HAVRE
-=== -
UN CANOT VOLANT
Nous donnons anjourd’hul la photographie du canot volant expérimenté récemment
dans l’avant-port par son constructeur M. Louis Brégnet et dont notre collaborateur
M. Hattenviile a donné la description dans le Petit Havre du 29 novembre.
4hete et caché Petit HaVri
M. Weber trouve cette situation fâcheuse
et il soutient qu’au principe les Sociétés de
secours mutuels devraient subvenir à leurs
dépenses par les seules recettes provenant
de leurs membres, sans avoir recours ni à
l’Etat ni à la bien.aisance privée.
En théorie pure, il est évident que cela
vaudrait mieux, personne ne le conteste.
De même, lorsque pour diminuer les frais
généraux des sociétés, gui sont proportion
nellement trop lourds, il demande l’augmen-
talion du nombre des membres de chaque
société. Tout cela est juste, mais n’y a-t-il
pas de sérieuses raisons qui s’y opposent ?
Chaque travailleur est-il en mesure de
verser une cotisa ion annuelle qui devrait
être d’au moins 24 francs ? Ceux qui ne ga
gnent qu’un salaire faible, extrêmement ré-
dait souvent, surtout à la campagne, et qui
ont une famille à nourrir, peuvent-ils faci
lement faire ce sacrifice ?
Et comment avoir des sociétés nombreu
ses dans les petites localités, où cependant
l’atilité d’une société de secours mutuels est
particulièrement indiquée ?
N’y a-t-il pas là des difficultés sérieuses
qui dépassent les forces de l’initiative indi
viduelle et qui justifient le concours des phi
lanthropes, de même que celui de la com
mune et de l’Etat?
Oui, en principe, il est désirable que de
plus en plus la mutualité se suffise à elle-
même, mais en attendant qu’elle soit en
mesure de le faire, que l’augmentation des
salaires et des traitements permette aux
travailleurs de consacrer à ce service social
une somme plus importante, n’est-il pas du
devoir de l’Eat d’encourager le développe
ment d’une institution qui, non seulement
au point de vue matériel mais encore au
point de vue moral, a une importance capi
tale ?
M. Weber lui-même le comprend, lorsque
dans ses conclusions il dit : « Qu’on ne s’y
trompe pas ; nonobstant toutes nos obser
vations, nous sommes profondément per
suadé que ces œuvres peuvent rendre d’im
menses services. Si nous jugeons défectueu
ses les méthodes suivies, nous sommes des
partisans résolus du principe. L’éducation
sociale de l’individu n'est pas encore assez
avancée pour que l’on ne doive pas encou
rager et aider puissamment toutes les insti
tutions destinées à parer aux conséquences
des crises inévitables : la maladie, la vieil
lesse et la mort. »
Et du reste les services rendus par la mu
tualité, qui s’est consacrée jusqu’ici presque
exclusivement au secours en cas de maladie
et dans une certaine mesure à la retraite ne
sont-ils pas susceptibles d’extension ? Ne
pourrait-elle pas notamment entreprendre
le secours en cas d’invalidité, et peut-on
soutenir que dans ces conditions le concours
des pouvoirs publics ne soit pas nécessaire ?
En ce qui concerne les retraites pour la
vieillesse, la plupart des grands pays ont re-
conuu la nécessité de les organiser avec le
concours de l’État, et notre Parlement —
par la loi du 5 avril 1910 — a pensé que la
charge de ce service social devait être parta-
gee pit tiers entre le travailleur, le patron et
l’Eut. . , '
N’est-il donc pas juste aussi que les char
ges de la maladie, qui sont si lourdes pour le
travailleur et sa famille, et aussi celles de
l’invalidité soient en partie supportées par
la collectivité, c’est-à-dire par les communes
et l’État ? . ,
il y a là un devoir social de premier ordre,
et j’ajoute, un intérêt général : car les œu
vres de prévoyance comme la mutualité,dont
les charges sont supportées par l’individu
aidé du concours de la collectivité, ont, pour
conséquence de diminuer les frais de i assis
tance, qui, eux, retombent en entier sur la
commune ou sur l’État.
Non, exiger de nos sociétés de secours mu
tuels qu’elles supportent elles-mêmes toutes
leurs dépenses serait exagéré ; elles rendent
un service considérable à 1 ensemble de la
nation, il est donc juse qu’elles soient en
couragées le plus largement possible par la
collectivité. . ,
il ne s’ensuit pas qu’elles soient à 1 abri de
toute critique et qu’elles ne soient pas sus
ceptibles d’amélioration.
L’un de mes collègues du Musée social, M.
Emile Cheysson, a éié parmi les premiers à
signaler aux mutualistes l’intérêt vital qu’il y
avait soit à s’entourer,quant à l’établissement
des barèmes de cotisations, des garanties ac
tuarielles, soit à faciliter le jeu de la loi dos
grands nombres en procédant, autant que
faire se peut, à une concentration toujours
plus grande des effectifs. Et ce.ne sont pas,
certes, des avis differents qui ont jamais été
! donnés par les dirigeants de la fédération
nationale ou des unions départementales de
la mutualité. On peut même affirmer qu’une
évolution dans le sens d’une réorganisation
technique se manifeste clairement, depuis
plusieurs années, dans le sein de la mutua
lité ; si cette évolution n’est pas plus rapide,
c’est qu’elle est susceptible de concerner plus
de 24,000 sociétés.
Ceci dit, ne sont-ils pas dignes de respect
et d’eloge ceux qui, poussés sans doute da
vantage par le cœur que par la science, ont
voulu les premiers échapper aux défaites hu
miliantes de l’existence et eux secours de
l'assistance ? Qni n’ont pas voulu cela seule
ment pour eux-mêmes, mais pour tous ceux
que leur prévoyance rendrait dignes de l'en-
tr’aide fraternelle ? Qui versent l’obole men
suelle non sans dures privations souvent, en
souhaitant, certes, de n’avoir pas à faire ap-
fiel à la protection sociale, mais heureux si
eur propre effort de prévoyance est de quel
que utilité, un jour, pour un ami moins for
tuné ?
Enfin, qui donnent partout l'exemple non
de l'egoïsme, mais de la dignité individuelle,
de la conscience et du respect de soi- même?
Ne voit-on pas quelle force de vie et d’éman
cipation sociale il y a là ? Quel esprit d’édu
cation réciproqne et de progrès moral, d’a
paisement et de conciliation d’homme à
homme et de frontière à frontière, préside
aux destinées de la mutualité ?
Sans doute, sages sont les personnes qui
prennent leurs garanties contre les accidents
de la vie dans une société d'assurances; mais
qu’on ne songe pas à faire un parallèle entre
cette préoccupation personnelle et les aspi
rations généreusement altruistes et solidaris-
tes de la mutualité.
Le T>mps t dans son article du 17 octobre, a
déjà fait ressortir tout cela de la façon la plus
heureuse, et je ne puis qu’applaudir à la pro
testation qu’il a énoncée.
La mutualité a accompli une œuvre im
mense : la preuve de l'utilité, de la nécessi é
de cette œuvre, je la trouve dans l’existence
de ces 24,000 sociétés qui groupent six mil
lions d’hommes, de femmes et d’enfants !
Comptez — et vous n’avez point besoin, pour
cela, de statistiques —combien cela fait cha
que année de blessures pansées, de malades
guéris, de vieillards entretenus, de veuves et
d'orphelins sauvés, de mères et de nouveau-
nés arrachés à la mort ; comptez cela,et vous
pourrez dire, sans plus ample informé, que
la mutualité a réalisé jusqu’ici une œuvra
magnifique et qu’elle a devant elle un avenir
illimité de fraternité et de solidarité.
M. Chéron à Lille
.Le ministre du travail a présidé hier l
Lille l’assemblée générale de la Société de
secours mutuels des voyageurs et des em
ployés de commerce du Nord et le binquet
organisé à l’occasion du cinquantenaire de
cette importante société.
Au banquet, M. Henry Chéron a prononcé
un discours sur « la politique sociale du
gouvernement»; et il a développé cette
thèse que « c’est un devoir primordial pour
les pouvoirs publics de ne négliger aucuns
mesure capable de sauvegarder l’individu, à
la fois dans son milieu de travail et dans
son milieu social. »
Il a rappelé les divers projets déposés par
le gouvernement, notamment sur linsaisis-
sabilité des petits salaires et des petits traite
ments, l’insaisissabilité absolue pour dettes
de cabaret, le placement des travailleurs,
l’extension de la capacité des Syndicats pro
fessionnels, la création de Sociétés à partici-
pation ouvrière, les coopératives de produc
tion, l’institution du crédit au travail, la ten
tative de conciliation obligatoire en matière
de grève, etc.
Nous sommes, sjoule M. Chéron, loin d’avoir
triomphé des difficultés que devait nécessairement
présenter l’application d’une loi aussi considéra
ble que la loi des retraites ouvrières et paysans
nes. Elle ne peut produire tous ses-effets que si
elle devient vraiment obligatoire pour les salariés
et leurs employeurs. ′ .
En attendant que nous obtenions du Pariemen.
les textes nécessaires, nous sommes allés au plus
pressé en assurant à près de cinq cent n no
avants droit le paiement de leur pension, “
accordant, par l’institution du mandal-retnal...
la suppression des avances, de nouvelles
aux Caisses d’assurances. . .
Voulant mettre, au surplus, à la disposition des
citoyens prévoyants, un moyen de CO mneD‘-“
tes avantages de la loi des retraites, ceux do 4 a0—
5 Centimes — EDTTION DU MATIN — 5 Centimes (8 Pages)
lundi 1er Décembre 4993
Administrateur- Dôlégué
O. RANDOLET
Adresser tout ce qui concerne l’Administratid
à M. O. RANDOLET
85, Rue Fontenelle, 35
Adresse Télégraphique : RANDOLET Havro
Administration, Impressions ot Annonces, TAL 10.47
Le Petit Havre
AU HAVRE
A PARIS
ereene ", = ee 1111 ====== ,-1--=====
AN NON CES
.. Bureau du Journal, 112, bout* de Strasbourg.
. ( L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
.. < seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le PETIT HA VHE est désigné pour les Annonces Jadlclalrss et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
ta
M
gooems o rr a
Rédaetou u Chel, Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
Adresser tout ce qui concerne la Redaction
a M. HIPPOLYTE fénoux
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE : Rédaction, N® 7.60
ABONNEMENTS
Le Ravre, la Seine-Inférieure, l’Eure,
l’Oise et la Somma
Autres Départements
Union Postale
TROIS Mois| Six Mois
4 KO
1 O F*.
10 »
» Fr.
19 se
ssæsese»
Un AN
is n.
es »
. - 20 Fr. 40 » 4
égalsmsnt, SANS FRidS, dans tous Iss Barsatx dt Posta fis g
AC »
ECM VENTE
h (
S
P"azt
itine e I
29
8
« xV Kl
- syii I S tisG ea Gln G KA
Paris, trois heures matin
LÈS INCIDENTS DE SAVERNE
T SAVERNE. — La ville était très animée hier
soir ; il ne s’est produit aucun incident dans
ta journée.
| On a aperçu de temps en temps des pa
trouilles militaires et de gendarmerie.
( À 4 heures de l’après-midi une patrouille
a arrêté, sur l’ordre d’un lieutenant un hom-
une d'Ottersiveiler qui avait, assure-t-on,
bousculé un officier.
' Le directeur du Cercle (Subdivision ad-
ministrative) est intervenu et a demandé la
puise en liberté, mais l’on ignore encore le
résultat de cette démarché.
CHEZ LES VIGNERONS DE L'AUBE
; TROYES. — Les délégués des communes et
des Associations vitico es de l’Aube, réunis à
Troyes, après un débat sur la portée de la
loi sur les appellations d'origine votés par
la Chambre, ont adopté un ordre du jour
&ans lequel ils déclarent renouveler leurs
yœux antérieurs en faveur du maintien de
la démission des Conseils municipaux des
communes vititoles et Gu-Yerus des vigne
rons de participer à aucun acte civique tant
|que leurs vins n’auront pas recouvert leur
appellation d’origine de « Champagne » sans
aucuns qualification.
MORT DE L’ÉVÊQUE CE LIMOGES
f. Limoges. — On annonce la mort de M. Re-
nouard, évêque de Limoges, dont l’état de
hanté s’etait aggravé depuis plusieurs se-
maines.
f Le défunt était âgé de 83 ans ; il était évê-
que depuis 25 ans.
HORRIBLE SUICIDE
EREMIRENONT. — Un nommé A..., âgé de
$7 ans, habitant Vecoux, s’est suicidé en ab-
sorbant un litre d’absinthe.
f La malheureux est mort au milieu d’atro-
ces souffrances.
[ On attribue cet acte de désespoir à des
chagrins mûmes.
PÉGOUD A BUCAREST
e BUCAntsT. — Le roi, le prince héritier et
de nombreuses personnalités militaires et
civiles ont assisté hier aux expériences de
l’aviateur Pégoud et ont vivement felioité
Ce dernier.
MACABRE DÉCOUVERTE
; RIVE-DE-GIER — La gendarmerie locale a
' enquêté au sujet de la découverte d’osse-
ments d’enfants faite à Lorette.
• Le docteur Lemençon, expert, a déclaré
qu’il s’agissait d’un crime commis il y a une
vingtaine d’années. L’enfant aurait été étran
glé.' Une cordelette adhérait encore aux osse-
ments du cou.
i L’enquête continue.
, , EXPLOSION DE DYNAMITE
/ Marseille.— Dans le quartier de l’Estaque,
Une baraque en bois abritant une cantine ou-
prière a été détruite par l’explosion d’une
cartouche de dynamite.
′ Il n’y a pas eu de blessés.
? LES RÉFORMES ARMÉNIENNES
Les délégués de l’Allemagne, de l’Antriche-
Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagae
et diirlande, de l’Italie, de la Rassie et de
la Suisse, réunis à Paris le dimanche 30 no
vembre pour examiner l’état présent de la
question des réformes arméniennes ont émis
le veu que les puissances ne donnent pas
satisfaction aux demandes financières de la
Turquie avant que la Sublime Porte ait for-
mellement adhéré au projet de réformes ar
méniennes qui donne le contrôle aux fonc
tionnaires européens et leur confère des
pouvoirs exécutifs.
; DERRIÈRE HEURE SPORTIVE
La Course des 24 heures
t PARIS. — Voici les résultats de la Course
les 24 heures courue à l’américaine :
| 4re équipe, Hourlier-Comès ; 2e équipe,
Oliveri-Lapize ; 3e équipe, Sergent-Cruppe-
landt ; 4 e équipe, Engel-de Ruyter.
La distance pa courue par la première
équipe a été de 873 kil. 490 mètres.
ON TROUVE
LE PETIT HAVRE à Paris
i la HIHMAIHIE ITAHHTTIOHALE
208, rue St-Lazare, 108
^(Iraiïiaubls de ma TEL TERMINUS)
===================================================
1914
sous la Troisième République ()
Par André SIEGFRIED
Samedi paraissait, chez A. Colin, à Paris,
l’ouvrage que nous avons. annoncé de
M. André Siegfried ; il a pour titre : Tableau
politique de la France de l'Ouest sous la
Troisième République. C’est une étude des
plus importantes, la première en ce genre
qui ait été entreprise et dont la portée his
torique et philosophique est appelée à un
retentissement certain dans le monde poli
tique.
Sous forme d’articles, M. André Siegfried
a déjà publié deux ou trois chapitres de
son ouvrage en ce journal. Et l’on n’a pas
oublié avec quelle précision, quelle finesse,
quelle franchise il a su déterminer l’esprit
politique de la région rouennaise ou de la
région caennaise ; comment il a su remon
ter aux causes de cet esprit particulier,
grâce à une étude minutieuse basée sur la
configuration des pays et la psychologie de
leurs habitants.
Cette même méthode, il l’a appliquée non
seulement à toute la Normandie, mais
encore à la Bretagne, au Maine, à l'Anjou,
à la Vendée. De là cet ouvrage qui forme
un tout complet, —- mais qui peut être aussi
considéré comme une partie dans un tout.
M. André Siegfried espère, en effet, me
ner à bien quelque jour, dans son ensem
ble, un Tableau politique de la France sous
la Troisième République. Tous nos vœux
l’accompagneront dans ce labeur considéra
ble d’où résultera une enquête extrême
ment documentée, une référence unique et
indispensable en ce qui concerne l'histoire
politique de la France à notre époque con
temporaine.
* *
Pour mieux souligner l’importance de
son ouvrage, nous voulons préciser ici la
méthode très scientifique de M. André
Siegfried. Nous le ferons d’après l’exposé
contenu dans l’Introduction qu’il a écrite à
son volume et qui est elle-même une véri
table étude de critique historique.
J’ai remarqué souvent dans les élections,
dit M. André Siegfried, que les opinions po
litiques sont sujettes à une répartition géo
graphique. Chaque parti ou plus exactement
chaque tendance a son domaine ; et avec un
peu d’attention l’on distingue qu’il y a des
régions po’itiques comme il y a des régions
géologiques ou économiques, et des climats
politiques comme il y a des climats natu
rels.
J’ai remarqué aussi,malgré des apparences
trompeuses, qu’il existe dans les manifesta-
lions de l’opinion une singulière continuité.
A condition de comparer des choses réelle
ment comparables entre elles, sans s’arrêter
à la fantaisie des épithètes, on aperçoit très
vite qu’à travers quarante ars de régime ré
publicain, ce sont les mêmes provinces, les
mêmes cantons, souvent jusqu’aux mêmes
communes qui restent politiquement orien
tés dans le sens des mêmes courants ou
fixés dans l’immobilité des mêmes résistan
ces. Et si l’on observe, dans un milieu
donné, la proportion des voix, on note que
fréquemment elle change fort peu, quelque
fois pas du tout.
Sous l’apparence mouvante des élections
se précisent donc des courants stables et se
dessinent des tempéraments politiques régio
naux. Il y a ainsi des tempéraments provin
ciaux, départementaux, cantonaux, commu
naux ; il y a plus exactement encore (car les
divisions administratives sont souvent fac
tices) des tempéraments politiques répondant
à ces profondes individualités naturelles qui
sont les « pays »-de France.
Quel est donc le secret de cette géo
graphie électorale où l’histoire a dessiné
des rivages, tracé des frontières et laissé
subsister des massifs résistants qu’aucune
tempête n’ébranle ? N’est-ce point que la
mentalité ancienne de chaque race se trouve
encore maintenue ou quelquefois modifiée
par l’influence du milieu qu’elle habite ?
Soumettre dès lors à une classification
géographique la France politique contem
poraine ; apprécier à l’épreuve de leur con
tinuité la réalité des opinions et des ten
dances ; sonder leur nature en voyant
comme elles « réagissent » sous l’action des
événements ; déterminer ainsi, en dressant
la topographie des partis, les liens intimes
qui les attachent au sol ou à certains sols ;
deviner par là les tempéraments politiques
divers des races et des classes, — telle est
la tâche minutieuse poursuivie par M. An
dré Siegfried.
Il fallait, pour cela, des connaissances
ethnographiques et historiques fort éten
dues, beaucoup de pénétration psycholo
gique, une faculté de démonstration abso
lument claire et limpide. A ces qualités,
M. André Siegfried joignait encore un
style sobre, alerte, souvent imagé, et, quand
il le fallait, très pittoresque. Et c’est ainsi
qu’il a pu, non seulement retrouver, mais
décrire, sur le Pays métaphysique des
idéologues, l’infinie variété des régions e
qu’il a pu éclairer merveilleusement, par
(1) Tableau politique de Ia France de l’Ouest
sous la Troisième République, par André
Siegfried. Ua volume in-80 raisin, avec 102
édites. et croquis dans le texte, et une carte
hors texte. (LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 103, Boule
vard Sain!-Michel. PARIS), broche 1% S.
I
une subtile analyse, la complexe person
nalité de la France de l’Ouest.
**
L’opinion politique d’un milieu trouve sa
manifestation la moins contestable dans les
élections diverses, encore bien que les in
dications qu’elles fournissent n’ajent ce
pendant rien d’absolu, pour les raisons que
l’on devine : abstentions, incompétence
de certains électeurs, pressions exer
cées. Puis, dans notre système politi
que, les électeurs ne votent pas sur des
choses, — comme ils feraient avec le refe
rendum, — mais sur des hommes. Enfin, il
faut compter avec la précision très relative
des programmes de certains candidats et
compter aussi avec l’exactitude très appro
ximative des épithètes dont ils se parent ;
avec la valeur réelle ou supposée de
ces épithètes, suivant les régions ou les
latitudes.
Il demeure, cependant, en dernière ana
lyse, que les élections,— et les élections
législatives surtout — restent les manifes
tations politiques les plus précises du suf
frage universel. Et c’est pourquoi M. An
dré Siegfried s’en est tenu presque exclu
sivement à l’étude des élections -législati
ves comme l’une des bases de son ouvrage.
Toutefois, deux conditions sont absolu
ment nécessaires pour tirer de ces observa
tions électorales un utile parti. Il convient
d’abord d’étudier avec grand détail la répar
tition géographique des voix, car les
chiffres d’ensemble du département ou
même de la circonscription couvrent le
plus souvent des diversités d’opinions
géographiquement localisées et qu’il faut
connaître. Il importe ensuite de s’imposer
l’observation de longues périodes, car un
scrutin pris isolément ne signifie pas grand
chose et peut prêter à de grossières erreurs.
Aussi M. André Siegfried a-t il eu soin
de ne se pas départir de ces rigoureux prin
cipes d’exégèse :
... Je me suis donc invariablement préoc
cupé, dit-il, de la répartition géographique
des votes. Le département,‘arrondissement,
la circonscription même m’ont paru être des
divisions trop étendues. Le département,
‘arrondissement sont sans doute devenus
pour les partis des cadres d’action, mais ce
ne sont pas des individualités politiques
homogènes. J’en dirai autant de la cir
conscription, dont la délimitation est uni
quement inspirée par l’intérêt électoral
du parti au pouvoir, et qui juxtapose sou
vent les éléments les plus hétérogènes dans
le seul but d’assurer le succès de tel ou tel
candidat.
C’est le canton qui m’a semblé être l’unité
poli ique la plus naturelle et la plus in
structive à observer : il est assez grand pour
ne pas entraîner à un détail excessif, et il
est en même temps assez restreint pour se
prêter à un dessin géographique très souple
des opinions politiques. Il arrive cependant
que, si petit qu’il soit, le canton lui-même
comprenne encore deux ou plusieurs ré
gions géographiques, sociales ou politiques :
par exemple, côte et intérienr, plaine et
bocage, vallée industrielle et platean agri
cole. Il devient nécessaire alors, surtout
lorsqu’on veut suivre avec soin une fron
tière d’opinions, de descendre jusqu’à la
commune.. »
Cependant, aucune tendance politique
d’une région n’a paru certaine à M. André
Siegfried que mise à l’épreuve de la du
rée. Et même, dans ce cas, lui a-t-il fallu
tenir compte de certaines circonstances
particulières.
... Chaque scrutin possède, en effet, son
atmosphère et sa situation propres. Quand
la question est bien posée, — comme en 4872
ou en 1902, — la réponse du corps électoral
prend une valeur particulière. Quand les
termes de la consultation sont confus, ou
simplement quand trop de problèmes sont
posés à la fois, —, com me en 1910 —, une
grande prudence d’interprétation s’impose...
L’élection de 1871 mise à part, toutes
les élections de la Troisième République
paraissent, à M. André Siegfried, pouvoir
se classer en deux groupes. Celles de 1877,
1883,1889,1902 et 1900 furent des élec
tions de combat où le régime républicain
fut menacé, sinon toujours dans son exis
tence, du moins dans son orientation dé
mocratique et anti-cléricale. On devra donc
considérer comme régions appartenant aux
partis de gauche, toutes celles qui leur
sont demeurées fidèles en ces heures diffi
ciles. Les élections de 1876,1881, 1893,
1898,1910 ne présentent point au même
degré ce caractère de lutte pour la vie. Ce
sont manifestement des élections d’apaise-
ment ou d’acceptation des faits accomplis.
Les régions qui demeurèrent alors fidèles
aux partis de droite, doivent être consi
dérées comme leur appartenant.
« Ainsi, dit M. André Siegfried, se déter
minent, dans l’Ouest, les deux pôles de la
vie politique. C’est de la même façon que,
sur les feuilles montrant l’évolution géolo
gique du globe, on voit les continents faire
surgir leur masse, l’affirmer ensuite et la
maintenir impérieusement contre les trans
gressions marines. »
#
* •
Telle est la méthode de M. André Sieg
fried. Il s’est préoccupé surtout de réalité;
il s’est moins attaché aux partis qu’aux ten
dances de fond. Il lui a semblé que, dans
l’Ouest du moins, la ligne de démarcation
entre les partis n’est pas entre royalistes et
républicains, entre radicaux et modérés,
mais entre la droite et la gauche — mieux
: encore, entre l’une et l’autre coalition, c’est-
à-dire « entre la tradition plus ou moins
déformée, mais toujours vivante de l’ancien
régime qui est hiérarchique, catholique et
conservatrice, —et la tradition républi
caine ou démocratique, qui est laïque, éga
litaire et d’avant-garde ».
Cette conclusion fut imposée à M. André
Siegfried par sa méthode d’investigations
entièrement objective. Il n’a eu qu’une
seule préoccupation : constater impartiale
ment la vérité. Il n’a prétendu à aucun mo
ment prouver la supériorité d'une doctrine
ou le mérite particulier d’un parti. « J’ai
voulu faire une étude politique, dit-il, nul
lement œuvre politique. »
Mais comment résister au désir de com-
prendre et d’expliquer ?
Ne semble-til pas qu’il existe des rela
tions entre le tempérament politique d’une
population et le milieu où elle vit ? Et si
elles existent, ces relations, quelles sont-
elles ? N'est-il pas vrai que certaines atmos
phères politiques localisées font penser à
certaines zones climatériques ? Pourquoi
donc tel parti prospère-t-il ici, et pourquoi
dépérit-il là-bas ?
Autant de questions auxquelles M. André
Siegfried a essayé de répondre. Il semble
bien qu’il y a pleinement réussi en ratta
chant la politique, non pas exactement à la
géographie dans le sens étroit de ce mot,
mais à ce que l’école de M. Vidal de la
Blache appelle aujourd’hui la géographie
humaine.
Le régime de la propriété, les systèmes
divers d’exploitation du sol, les modes de
groupement de 1§ population, la configura
tion même du pais, le degré de soumission
à l'autorité ecclésiastique, le caractère
même de la race, — autant d’éléments di
vers qui, par leur concours,peuvent fournir
des explications intéressantes et vraies,
mais dont œun d’eux ne serait suffisant à
lui seul pour nous donner une certitude
ou nous faire entrevoir seulement une pro
babilité.
Aussi bien faut-il rejeter cette opinion
courante suivant laquelle les élections ne
seraient qu’un domaine d’incohérence et de
fantaisie. Une étude sérieuse a conduit M.
André Siegfried à une conclusion tout à fait
contraire. Et, dit-il, si selon le mot de Gœ-
the « l’enfer a ses lois », pourquoi la poli
tique n’aurait-elle pas les siennes ?
Dans un prochain article nous montre
rons avec quelle délicatesse, quelle subti
lité d’observation, avec quelle élégance
d’expression M. André Siegfried a su pré
ciser ces lois dans la vaste région étudiée
en son présent ouvrage.
Th. Vallée.
LA MUTUALITÉ
Une Déclaration de M. Jules Siegfried
M. Anatole Weber, dans une série d’articles pu
bliés par le journal Le Temps et qui ont eu un
grand retentissement, a soumis la mutualité fran
çaise à une critique rigoureuse. Dans l’espoir,
comme il disait lui-même, « de contribuer à l’a
mélioration d’une œuvre dont on a le droit d’at-
tendre les plus grands services, à condition de
mieux coordonner les énormes efforts faits à
son profit», il s’efforçait de dissiper « quel
ques mirages y ; il s’attachait à démontrer que
les sociétés de secours ne reposent sur au
cune base scientifique : « Les plus élémenlai-
res prescriptions de la science acluarielle, très
justement ‘imposées aux moindres sociétés de
prévoyance, sont, disait-il, totalement inconnues
des groupes mutualistes ; l’effort personnel con
senti par les contractants étant notoirement insuf
fisant, l’œuvre ne peut vivre que par un apport,
de plus en plus considérable et de plus en plus
âprement sollicité, de la bienfaisance privée ou
publique ; les dépenses de gestion sont exagérées
et dépassent de beaucoup celles de la plupart des
entreprises d’assurances dites à forme mutuel-
le « »
À ces critiques, un éminent collaborateur du
même journal Le Temps, M. Paul Delombre, a dé
jà répondu dans un article où il faisait observer
tout d’abord que « la mutualité n’est pas une affai
re » et que « ses bilans ne sauraient être ni éta
blis ni jugés comme ceux d’une société ordinai
re ». En effet, ses apports consistent surtout en
hommes ; ses bénéfices sont encore plus d’ordre
moral que d’ordre matériel. « Par la mutualité
sont éveillés ou avivés le sentiment de la respon
sabilité personnelle, l’esprit de prévoyance, l’ef-
fort pour la garantie du travail libre et la sauve»
garde du foyer domestique. »
Mais, dit M. Charles Dulot, auteur de cette en
quête ouverte sur la mutualité, « ces observations
de notre collaborateur ne pouvaient nous dispen
ser de mettre en face des criliques de M. Anatole
Weber les réponses des mutualistes, ainsi que les
appréciations désintéressées des hommes qui ont
vu fonctionner les œuvres mutualistes. C’est en
effet une règle d’impartialité que nous nous im
posons dans toute controverse sociale ou écono
mique — surtout quand la controverse a été dé»
terminée par une enquête du Temps. »
M. Charles Dulot a donc demandé tout d’abord
son opinion dans ce débat à M. Jules Siegfried,
ancien ministre, président du Comité de direction
du Musée social, qui est particulièrement qualifié
pour apprécier le rôle social de la Mutualité.
Voici la réponse de M. Jules Siegfried:
M. Anatole Weber a étudié avec un zèle
redoutable la situation de la mutualité fran
çaise et l’a passée au crible d’une critique
impitoyable. Peut-être eût il été bien avisé
en tenant compte des différents points de
vue auxquels il convient de se placer pour
avoir une idée exacte de cette grande et belle
institution sociale.
M. Weber prend les chiffres d21910 concer
nant les Sociétés de secours mutuels approu
vées et montre qu’elles ont dépensé une
somme de 52 millions de francs. Le montant
des cotisations n’ayant été que de 39 mil-
lions — soit une moyenne de 12 fr. 40 par
membre —• l’insuffisance est de 13 millions,
comblée par les cotisations des membres
| honoraires et les subventions de l’Eat.
LES HYDRAVIONS AU HAVRE
-=== -
UN CANOT VOLANT
Nous donnons anjourd’hul la photographie du canot volant expérimenté récemment
dans l’avant-port par son constructeur M. Louis Brégnet et dont notre collaborateur
M. Hattenviile a donné la description dans le Petit Havre du 29 novembre.
4hete et caché Petit HaVri
M. Weber trouve cette situation fâcheuse
et il soutient qu’au principe les Sociétés de
secours mutuels devraient subvenir à leurs
dépenses par les seules recettes provenant
de leurs membres, sans avoir recours ni à
l’Etat ni à la bien.aisance privée.
En théorie pure, il est évident que cela
vaudrait mieux, personne ne le conteste.
De même, lorsque pour diminuer les frais
généraux des sociétés, gui sont proportion
nellement trop lourds, il demande l’augmen-
talion du nombre des membres de chaque
société. Tout cela est juste, mais n’y a-t-il
pas de sérieuses raisons qui s’y opposent ?
Chaque travailleur est-il en mesure de
verser une cotisa ion annuelle qui devrait
être d’au moins 24 francs ? Ceux qui ne ga
gnent qu’un salaire faible, extrêmement ré-
dait souvent, surtout à la campagne, et qui
ont une famille à nourrir, peuvent-ils faci
lement faire ce sacrifice ?
Et comment avoir des sociétés nombreu
ses dans les petites localités, où cependant
l’atilité d’une société de secours mutuels est
particulièrement indiquée ?
N’y a-t-il pas là des difficultés sérieuses
qui dépassent les forces de l’initiative indi
viduelle et qui justifient le concours des phi
lanthropes, de même que celui de la com
mune et de l’Etat?
Oui, en principe, il est désirable que de
plus en plus la mutualité se suffise à elle-
même, mais en attendant qu’elle soit en
mesure de le faire, que l’augmentation des
salaires et des traitements permette aux
travailleurs de consacrer à ce service social
une somme plus importante, n’est-il pas du
devoir de l’Eat d’encourager le développe
ment d’une institution qui, non seulement
au point de vue matériel mais encore au
point de vue moral, a une importance capi
tale ?
M. Weber lui-même le comprend, lorsque
dans ses conclusions il dit : « Qu’on ne s’y
trompe pas ; nonobstant toutes nos obser
vations, nous sommes profondément per
suadé que ces œuvres peuvent rendre d’im
menses services. Si nous jugeons défectueu
ses les méthodes suivies, nous sommes des
partisans résolus du principe. L’éducation
sociale de l’individu n'est pas encore assez
avancée pour que l’on ne doive pas encou
rager et aider puissamment toutes les insti
tutions destinées à parer aux conséquences
des crises inévitables : la maladie, la vieil
lesse et la mort. »
Et du reste les services rendus par la mu
tualité, qui s’est consacrée jusqu’ici presque
exclusivement au secours en cas de maladie
et dans une certaine mesure à la retraite ne
sont-ils pas susceptibles d’extension ? Ne
pourrait-elle pas notamment entreprendre
le secours en cas d’invalidité, et peut-on
soutenir que dans ces conditions le concours
des pouvoirs publics ne soit pas nécessaire ?
En ce qui concerne les retraites pour la
vieillesse, la plupart des grands pays ont re-
conuu la nécessité de les organiser avec le
concours de l’État, et notre Parlement —
par la loi du 5 avril 1910 — a pensé que la
charge de ce service social devait être parta-
gee pit tiers entre le travailleur, le patron et
l’Eut. . , '
N’est-il donc pas juste aussi que les char
ges de la maladie, qui sont si lourdes pour le
travailleur et sa famille, et aussi celles de
l’invalidité soient en partie supportées par
la collectivité, c’est-à-dire par les communes
et l’État ? . ,
il y a là un devoir social de premier ordre,
et j’ajoute, un intérêt général : car les œu
vres de prévoyance comme la mutualité,dont
les charges sont supportées par l’individu
aidé du concours de la collectivité, ont, pour
conséquence de diminuer les frais de i assis
tance, qui, eux, retombent en entier sur la
commune ou sur l’État.
Non, exiger de nos sociétés de secours mu
tuels qu’elles supportent elles-mêmes toutes
leurs dépenses serait exagéré ; elles rendent
un service considérable à 1 ensemble de la
nation, il est donc juse qu’elles soient en
couragées le plus largement possible par la
collectivité. . ,
il ne s’ensuit pas qu’elles soient à 1 abri de
toute critique et qu’elles ne soient pas sus
ceptibles d’amélioration.
L’un de mes collègues du Musée social, M.
Emile Cheysson, a éié parmi les premiers à
signaler aux mutualistes l’intérêt vital qu’il y
avait soit à s’entourer,quant à l’établissement
des barèmes de cotisations, des garanties ac
tuarielles, soit à faciliter le jeu de la loi dos
grands nombres en procédant, autant que
faire se peut, à une concentration toujours
plus grande des effectifs. Et ce.ne sont pas,
certes, des avis differents qui ont jamais été
! donnés par les dirigeants de la fédération
nationale ou des unions départementales de
la mutualité. On peut même affirmer qu’une
évolution dans le sens d’une réorganisation
technique se manifeste clairement, depuis
plusieurs années, dans le sein de la mutua
lité ; si cette évolution n’est pas plus rapide,
c’est qu’elle est susceptible de concerner plus
de 24,000 sociétés.
Ceci dit, ne sont-ils pas dignes de respect
et d’eloge ceux qui, poussés sans doute da
vantage par le cœur que par la science, ont
voulu les premiers échapper aux défaites hu
miliantes de l’existence et eux secours de
l'assistance ? Qni n’ont pas voulu cela seule
ment pour eux-mêmes, mais pour tous ceux
que leur prévoyance rendrait dignes de l'en-
tr’aide fraternelle ? Qui versent l’obole men
suelle non sans dures privations souvent, en
souhaitant, certes, de n’avoir pas à faire ap-
fiel à la protection sociale, mais heureux si
eur propre effort de prévoyance est de quel
que utilité, un jour, pour un ami moins for
tuné ?
Enfin, qui donnent partout l'exemple non
de l'egoïsme, mais de la dignité individuelle,
de la conscience et du respect de soi- même?
Ne voit-on pas quelle force de vie et d’éman
cipation sociale il y a là ? Quel esprit d’édu
cation réciproqne et de progrès moral, d’a
paisement et de conciliation d’homme à
homme et de frontière à frontière, préside
aux destinées de la mutualité ?
Sans doute, sages sont les personnes qui
prennent leurs garanties contre les accidents
de la vie dans une société d'assurances; mais
qu’on ne songe pas à faire un parallèle entre
cette préoccupation personnelle et les aspi
rations généreusement altruistes et solidaris-
tes de la mutualité.
Le T>mps t dans son article du 17 octobre, a
déjà fait ressortir tout cela de la façon la plus
heureuse, et je ne puis qu’applaudir à la pro
testation qu’il a énoncée.
La mutualité a accompli une œuvre im
mense : la preuve de l'utilité, de la nécessi é
de cette œuvre, je la trouve dans l’existence
de ces 24,000 sociétés qui groupent six mil
lions d’hommes, de femmes et d’enfants !
Comptez — et vous n’avez point besoin, pour
cela, de statistiques —combien cela fait cha
que année de blessures pansées, de malades
guéris, de vieillards entretenus, de veuves et
d'orphelins sauvés, de mères et de nouveau-
nés arrachés à la mort ; comptez cela,et vous
pourrez dire, sans plus ample informé, que
la mutualité a réalisé jusqu’ici une œuvra
magnifique et qu’elle a devant elle un avenir
illimité de fraternité et de solidarité.
M. Chéron à Lille
.Le ministre du travail a présidé hier l
Lille l’assemblée générale de la Société de
secours mutuels des voyageurs et des em
ployés de commerce du Nord et le binquet
organisé à l’occasion du cinquantenaire de
cette importante société.
Au banquet, M. Henry Chéron a prononcé
un discours sur « la politique sociale du
gouvernement»; et il a développé cette
thèse que « c’est un devoir primordial pour
les pouvoirs publics de ne négliger aucuns
mesure capable de sauvegarder l’individu, à
la fois dans son milieu de travail et dans
son milieu social. »
Il a rappelé les divers projets déposés par
le gouvernement, notamment sur linsaisis-
sabilité des petits salaires et des petits traite
ments, l’insaisissabilité absolue pour dettes
de cabaret, le placement des travailleurs,
l’extension de la capacité des Syndicats pro
fessionnels, la création de Sociétés à partici-
pation ouvrière, les coopératives de produc
tion, l’institution du crédit au travail, la ten
tative de conciliation obligatoire en matière
de grève, etc.
Nous sommes, sjoule M. Chéron, loin d’avoir
triomphé des difficultés que devait nécessairement
présenter l’application d’une loi aussi considéra
ble que la loi des retraites ouvrières et paysans
nes. Elle ne peut produire tous ses-effets que si
elle devient vraiment obligatoire pour les salariés
et leurs employeurs. ′ .
En attendant que nous obtenions du Pariemen.
les textes nécessaires, nous sommes allés au plus
pressé en assurant à près de cinq cent n no
avants droit le paiement de leur pension, “
accordant, par l’institution du mandal-retnal...
la suppression des avances, de nouvelles
aux Caisses d’assurances. . .
Voulant mettre, au surplus, à la disposition des
citoyens prévoyants, un moyen de CO mneD‘-“
tes avantages de la loi des retraites, ceux do 4 a0—
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.73%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 85.73%.
- Auteurs similaires Fénoux Hippolyte Fénoux Hippolyte /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Fénoux Hippolyte" or dc.contributor adj "Fénoux Hippolyte")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t52638651h/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t52638651h/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t52638651h/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t52638651h
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t52638651h