Titre : Le Petit Havre : organe républicain, démocratique, socialiste ["puis" organe républicain démocratique "puis" bulletin d'informations locales]
Éditeur : [s.n.] (Havre)
Date d'édition : 1913-11-27
Contributeur : Fénoux, Hippolyte (1842-1913). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836500g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 27 novembre 1913 27 novembre 1913
Description : 1913/11/27 (A33,N11819). 1913/11/27 (A33,N11819).
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : BIPFPIG76 Collection numérique : BIPFPIG76
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t52638647m
Source : Bibliothèque municipale du Havre, PJ5
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/04/2023
P 90,819
(6 Pages) 5 Centimes — EDITEON DU MATIN — 5 Centimes
NBs
08
Administrateur-Balégue
Jeudi M Novembre 1913
Adresser tout ce qui concerne l'Administration
e M. O. RAMDOLET
85, Rue Fontenelle, SB
Adresse Télégraphique: PANDOLET Havre
Administration, Impressions II Annonces. TEL. 10.47
Le Petit Havre
wbeOr
Aédaetew en Chef. Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
haresser tout ce qui concerne la Rédaction
t M. HIPPOLYTE FÉNOUX
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE: Rédaction, No 7.60
AU HAVRE
A PARIS
ANNONCES
BUREAU DU JOURNAL, 112, bon! 4 de Strasbourg.
! L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le PETIT HA THE est désigné pour les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, lEure,
l’Oise et la Somme (
" Autres Départements...... ... ..........
g Union Postale
20
Tnors Moisi Six Mois
sO
• Fr.
P-
fi il se
»
20 Fr.
a® w.<
== » |
Un An
4ey s
e
M996358
- 2 a 25 41. , ; J— 0
9 également, S ANS FR^IS, Hans tous les Baree^s dn Pons A regxs 3
—============== rrsrgcssg
Paris, trois heures matin
DÉPÊCHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 26 Novembre. Dépêche de 4 h. 30
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
CUIVRE
Comptant.. i
ferme
£ 67 18/-
27/6
-/-
3 mois ’
£ 66 7/6
20/-
-/-
ETAIN
:
Comptant .
t 480 15/-
35/-
3 mois
, fermez
e 181 15/-
35/-
-I-
FER
Comptant ..
ferme
4 49/4 %
V-
3 mois.....
£ 50/1 %
-1-
-i-
Prix comparés avec ceux de la deuxième Bourse
du 25 novembre 1913.
NEW-YORK, 26 NOVEMBRE
Cetons x décembre, baisse 6 points; jan
vier, baisse 7 points ; mars, baisse 6 points ;
mai, baisse 7 points. — Soutenu.
Calés t hausse 19 à 23 points.
NEW-YORK, 26 NOVEMBRE
Cuivre Standard disp.:
— janvier
Amalgasat. Cep...
Fer
C. 00 100
14 37
14 37
70 1/8
15 37
4. mawxT
14 37
14 37
70 3 8
15 37
CHICAGO, 26 NOVEMBRE
F !
C. DU JOUR
c. PRECED
Blé sur
Décembre;
87 1/8
87 1/2
Mai.
91 1/8
91 3 8
Mais sur
Décembre.
70 5/8
70 5 8
Mai
70 1,2
70 5 8
Saindoux sar.
Janvier...
10 87
10 90
—
Mai
11 12
11 15
clos. _
NOTA. — Demain Marché
3
DEUX AVIATEURS MILITAIRES
SONT CARBONISÉS
Reims. — Un biplan militaire venant de
Mourmelon et monté par deux sapeurs avia
teurs est tombé hier après-midi entre Be-
thon et Chantemerle.
Les deux aviateurs sont morts carbonisés.
L’accident serait dû à l’explosion du réser
voir d’essence.
EPERNAY. — L’accident s’est produit à qua
tre kilomètres de tout lieu habité.
On croit qu’un choc s’est produit au mo
ment de l’atterrissage. Le réseruoir aurait
explosé et le feu aurait pris, réduisant l’ap
pareil en cendres.
Les cadavres des aviateurs sont tellement
carbonisés qu’il est impossible de les iden
tifier.
On n’a retrouvé qu’un mouchoir matricu-
lé et un soulier intacts parmi les débris de
l’appareil.
EPERNAY. — Il résulte des renseignements
recueillis que quelques personnes ont aper
çu vers trois heures de l’après-midi, un bi-
Jan atterrissant sur le lieu où s’est produit
accident. L’appareil ayant buté, capota et
des flammes jaillirent immédiatement.
Les témoins accoururent pour porter se
cours aux aviateurs, mais ne trouvèrent à
leur arrivée que des débris informes finis-
sant de se consumer.
Les deux aviateurs avaient été entièrement
sarbonisés.
PROTESTATION DES OUVRIERS DE
L'ARSENAL DE BREST
Brest. — Deux mille ouvriers de l’Arsenal
ont voté hier un ordre du jour de protesta
tion contre les punitions infligées à deux de
leurs camarades ayant commis des fautes
graves contre la discipline.
Voici la fin de cet ordre du jour :
« Les ouvriers adressent leur salut frater
nel aux militants emprisonnés pour le « Sou
du Soldat » et protestent contre leur incar
cération ;
» Se quittent en se promettant de rejoin
dre en grand nombre le syndicat,seul moyen
de lutte efficace.
» Vive l’organisation syndicale ! Vive
C. G. T. »
la
Il ne s’est produit aucun incident
sortie du meeting.
o@p s en== -c==
GRÈVE DE TYPOGRAPHES
à
la
sont
Lille. — A Roubaix, les typographes
en grève dans 33 maisons sur 35 ; à Tour
coing, 7 maisons sur 12 sont touchees par la
grève ; à Croix, une seule imprimerie tra
vaille avec des « jaunes ».
Lille. — a la suite du vote de la grève gé
nérale des typographes, huit maisons ont
chômé.
Le mouvement ne s’est pas étendu aux
maisons ayant accepté le tarif syndical.
L’AVIATEUR DAUCOURT EN PANNE
Constantinople. — L » ministre de l'inté-
rieur a transmis le télégramme suivant signé
» Daucourt » à l’ambassade de France :
« J’ai été surpris dans les monts Taurus
par une violente tempête. J’ai fait une chute
terrible ; heureusement, je suis indemne,
mais mon appareil est brisé. Veuillez en in
former l'ambassade de France. Mon passager
Roux, pour alléger l’appareil, a pris le che
min de fer. »
COLLISION DE NAVIRES
Hong Kong. — Le steamer japonais Sohu-
Maru est entré en collision, dans la rade,
avec une chaloupe transportant cinquante
voyageurs chinois.
La chaloupe a coulé. Trente Chinois se
sont noyés ; les autres ont été sauvés.
CONDAMNATION DU LIEUTENANT TIEGS
Metz. — Le Conseil de guerre vient de
condamner le lieutenant Tlegs, pour homi-
cide, à 10 ans de travaux forcés et privation
de ses droits civils ; il sera en outre exclu de
l’armée.
L’Evolution Politique de Gaen
SOUS LA TROISIEME RÉPUBLIQUE
La plaine et la ville de Caen constituent,
en Basse-Normandie, un milieu politique
original, qui, bien qu’essentiellement nor
mand par la race, le ton, le tempérament,
rappelle en même temps à certains égards
la démagogie nationaliste parisienne et ses
entraînements quasi méridionaux. A de
longues périodes d’indifférence, d’atonie,
d’inexistence politique succèdent tout à
coup des marées d’opinion imprévues qui,
groupant dans un même élan des masses
inorganisées et politiquement amorphes,
balaient les partis officiels. Ce sont des
manifestations de l’ordre éruptif, presque
toujours cristallisées autour d’un homme
populaire, et qui appartiennent à l’essence
classique de tous les plébiscites et de tous
les a boulangismes ». Chez ces véritables
méridionaux de la Normandie, quelle dif
férence avec la réserve froide et sans pas
sion que nous décrivions précédemment
chez les Rouennais ! (2)
Caen est une ville de basoche, d'étu-
diants, de rentiers, de moyen et de petit
commerce, de cheminots et de déchargeurs
de navires. Ce sera prochainement un grand
centre industriel, avec ses hauts fourneaux
de Colombel et l’exportation de ses mine
rais. Mais c’est surtout la métropole histo
rique bas-normande, cité des cathédrales
romanes et des grands palais administratifs
évoquant les unes comme les autres la même
idée de stabilité, de richesse assise et d’or
dre si traditionnel qu’il en devient harmo
nieux. Sous un ciel bleu, avec ses pierres
éclatantes et la campagne nue qui l’entou
re, Caen semble une autre Salamanque ; et
sous un ciel humide et bas, avec ses cloî
tres et ses clochers normands, une autre
Oxford. C’est enfin — et par là combien
différente de Rouen la réservée — une cité
sans mélancolie, capable d’expansion dans
l’entraînement parfois bruyant de ses em
ballements populaires, où derrière la fa-
cade bourgeoise se révèle à certains mo
ments je ne sais quelle inquiétante gros
sièreté de plèbe.
L’esprit politique caennais est un mé
lange singulier de républicanisme sincère,
de conservatisme étroit et d’inconsciente
démagogie se mettant éventuellement au
service des plus violentes réactions. C’est
surtout chez les modestes rentiers, les
fonctionnaires retraités du quartier Saint-
Julien ou de la Maladrerie, et encore chez
les boutiquiers, les moyens commerçants
de la rue Saint Jean, qu’on le rencontre à
l’état pur et qu’en réalité il prend nais
sance. Tout ce petit monde est égalitaire
d’instinct, routinier et méfiant de nature,
républicain du reste, mais volontiers mé
content de tout, patriote et même patrio-
tard, ami des fanfares guerrières et des
glorioles du coq gaulois. Sous un autre
ciel, il fournit une réplique du nationa
lisme parisien. A côté de lui, la classe ou
vrière, plus avancée à ses heures, est si
possible aussi fuyante. Les nombreux em
ployés et travailleurs du chemin de fer (la
gare en occupe 1,200) sont susceptibles
d’apprécier les réformes sociales, encore
qu’ils soient peu socialistes ; mais on les a
vus boulangistes et nationalistes, et ils n’of
frent en somme de garantie sérieuse à aucun
parti. Quant aux ouvriers des quais, il se
rait naïf de leur chercher une opinion : les
petits verres, l’argent même sont argu
ments qu’ils comprennent, et cependant je
n’omettrai pas de dire qu’une campagne
personnelle, faite par un candidat sympa
thique, familier, bel homme et du reste de
n’importe quel parti, pourra soulever parmi
eux d’étranges enthousiasmes. Encadrant
ce milieu amorphe, sans du reste le diri
ger, les classes bourgeoises révèlent des
tendances mieux dessinées. Les vieilles fa
milles — à l’exception d’un groupe protes-
lant autochtone — demeurent hostiles au
présent. L’université se range socialement
avec les forces organisées et n’est point un
foyer démocratique. Le monde de la baso
che fournit à la Gauche comme à la Droite
l’essentiel de leurs états-majors, mais c’est
aux conservateurs ou du moins aux mo
dérés que va le poids de sa sympathie,
l’autorité morale de son appui. Somme
toute, il existe des cadres aux partis : mais
la masse est instable, et nul ne peut se
flatter de la fixer sans retour. Caen est une
de ces villes populaires — telles Paris —
qui semblent invariablement attirer sur
elles ces fièvres démagogiques dont le bou
langisme est le type.
En dehors de ces fièvres éruptives et du
reste passagères, Caen est une ville répu
blicaine comme une autre, nettement hos
tile à l’esprit du passé. Elle ne répond ni à
l’appel réactionnaire du 16 Mai, ni à celui
de la coalition de 1885. A une exception
près, ses maires sont républicains. De mê
me ses députés, sauf quand l’appoint des
cantons ruraux fait passer des opposants ;
mais même alors, la gauche conserve dans
(1) On trouvera une étude plus détaillée de la
région caennaise et de la politique normande dans
te livre que M. André Siegfried va faire paraître
(le 29 nov.) chez A. Colin Tableau politique de
la France de l’Ouest sous la T olsième République.
(2) Voir le Petit Havre des 22 et 29 octobre
1913.
la ville une majorité, qui va de 36 à 47 p.
100 des inscrits, contre 22 à 33 p. 100 (1).
En temps ordinaire, c’est donc, semble-t-il,
un terrain électoral de tout repos pour les
républicains.
Or il n’en est rien ; cette sécurité recou
vre des précipices. Voici qu’en 1889 le
mouvement boulangiste s’épanouit dans la
capitale normande, réunissant en un vi
goureux faisceau de mécontents les bona
partistes, la Droite et nombre de républi
cains. Ce n’est pas seulement le fait d’une
activité de Comités, c’est en un sens un
élan spontané. Aux élections cantonales de
juillet 1889, le général Boulanger, qui se
fait plébisciter, obtient dans le canton de
Caen (Est) 1,578 voix contre 1,831 : il a
failli réussir. Deux mois plus tard, son
candidat, M. Engerand, triomphe, grâce à
l’appoint rural sans doute, mais non sans
avoir réuni dans la partie urbaine une im
posante minorité de 2,996 voix contre 3.423,
31 p. 100 des inscrits contre 36. Caen a
vibré à l’appel du « parti national » î
Plus révélatrice encore du tréfonds de
l’esprit politique caennais est la crise du
nationalisme. Dès le début, la ville a été
profondément antidreyfusarde : travaillée
par le parti nationaliste, elle se donne pas
sionnément à lui. Le 17 mars 1902, le géné
ral Mercier y reçoit un enthousiaste accueil.
Un mois après, le comte Delarbre, candidat
de la « Patrie Française », balaie au pre
mier tour opportunistes, radicaux et socia
listes, qui eu vain s’opposent a lui. Dans la
ville même, il obtient 38 p. 100 des inscrits,
contre 33 à ses trois concurrents de gauche
réunis. C’est, portant l’homme populaire,
riche et séduisant, une sorte de marée trou
ble, où des eaux de toute sorte se mêlent :
plèbe campagnarde bonapartiste, plèbe ur
baine entraînée, cléricaux irréconciliables,
républicains mécontents, tous se coalisant
au nom de la République nationale contre la
République parlementaire de Waideck-Rous-
seau. Mouvement au fond plus nationaliste
que spécifiquement clérical, plus protesta
taire qu’antirépublicain ; mouvement popu
laire surtout, car il touche tous les quartiers
et toutes les classes, les soulevant dans une
passion commune ! Et cette victoire n’est
pas superficielle, ni sans lendemain. Aux
élections cantonales partielles du 17 jan
vier 1904, le maire républicain de Gaen est
battu dans le canton Est de la ville par un
nationaliste ; et, sous ce coup, la munici
palité succombe. Aux élections municipa
les de mai 1904, la moyenne des voix répu
blicaines tombe à 26 p. 100 des inscrits
contre 39 p. 100 aux nationalistes. C’est le
point culminant de la vague : des cléricaux
en ont profité, mais elle n’était point exclu
sivement cléricale ; des réactionnaires s’en
sont servi, mais elle n’était point propre
ment réactionnaire ; Boulanger y eût re
connu le mouvement populaire qui le por
tait à ses débuts.
C’est le caractère de semblables emballe
ments que de passer comme ils sont nés.
Deux ans plus tard, en 1906, il semble que
toute cette ardeur nationaliste n’appartien
ne plus qu’au passé. M. Delarbre, désabu
sé, renonce à la lutte et se rallie au parti
républicain. C’est le moment où M. Chéron,
dont le tempérament plaît aux Caennais
par de secrètes ressemblances, ranime,
mais cette fois au profil de la République,
un enthousiasme dont celle-ci n’avait, à
Caen, jamais bénéficié. L’opinion à nou
veau s’émeut, dans une direction diamétra
lement opposée, mais avec le même élan :
il semble qu’on ait simplement renversé la
vapeur. Cette fois, la victoire est triom
phale. Sur le nom acclamé de M. Chéron, la
proportion des voix de gauche monte à 46
p. 100 des inscrits (contre 34 p. 100 à la
Droite) en 1906, à 50 p. 100 en 1910. L’ob
servateur méfiant est tenté de dire en ho
chant la tête : Que de républicains ! Mais il
s’explique mieux les choses, si, regardant
en arrière, il réalise que les Caennais se
sont offert un nouveau plébiscite.
Conçoit-on maintenant la personnalité
politique de la région caennaise ? Ni dans
la Haute, ni dans la Basse-Normandie, je
ne vois rien d’analogue. Il est en France
des milieux, où le mélange et le choc con
fus, dans les mêmes cerveaux, d’instincts à
la fois démocratiques, autoritaires et con
servateurs produit, à certaines heures, une
atmosphère fiévreuse et grosse d’orages.
Par tempérament, ces milieux (que nous
pourrions énumérer) s’abandonnent inva
riablement et s’abandonneront toujours à
tous les « boulangismes » : c’est parmi eux
qu’il faut politiquement classer Caen et la
Plaine de Caen.
André SIEGFRIED.
(4) Les députés républicains sont MM. Houyvet
(1876), Henry (1881), Lebret (1893-1992), Chéron
(1900-4913) ; ce dernier passe au Sénat en juillet
1913, sans avoir perdu la confiance de ses élec
teurs caennais. Le général de Vendeuvre, conser
vateur (1877) et M. Esgerand, boulangiste (1889) ne
réussissent que grâce aux voix de la campagne.
M. Delarbre, nationaliste (1902), est le seul député
de la droite qui ait recueilli la majorité dans la
ville même de Caen.
ON TROUVE
LE PETIT HAVRE à Paris
à h HIBRATRIE ITEHMITYTTOHRLE
10s, rue Saint-Lazare, 108
(immeuble de P HOTEL TE B # INUS
AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance clu 26 Novembre 191=
LE MODE DE RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Les Secours m nature aux Enfants indigents des Ecoles privées
Les Subventions aux Sociétés Havraises
La séance du Conseil Municipal, tenue
hier soir, a été particulièrement intéressante
en ce que, pour la première fois, les mem
bres de l’Assemblée qui appartiennent au
parti de l’Action Libérale ont posé la ques
tion des « Secours en nature aux enfants in
digents des Ecoles privées » — c’est-à-dire
que, d’une façon détournée, ils demandaient
aux finances municipales une subvention en
faveur des écoles confessionnelles opposées
aux écoles laïques où la neutralité scolaire
est de règle.
On trouvera plus loin une analyse du dé
bat, par instant assez passionné, qui s’est
produit à ce sujet, — et qui s’est terminé par
le rejet de la proposition formulée par M. de
Grandmaison et ses amis.
L’appel nominal fait constater la présence
de M. Génestal, maire ; MM. Morgand, Ser-
rurier, Dr Vigné, Jennequin, Badoureiu et
Valentin, adjoints ; MM. Dero, Coty, Bas
set, Bricka, Gripois, Le Chapelain, Langlois,
Grenier - Lemarchand , Begouen - Demeaux,
Lang, Lenormand, Maillart, Schoux, Déliot,
Masquelier, Auger, de Grandmaison, Du-
rand-Viel, Allan, Brot, Beurrier, Masselin,
Conion, Meyer, Salacrou, Cherfils.
Sont absents et excusés : MM. Combes,
Windesheim et Encontre.
Le procès-verbal de la précédente séance
ayant été adopté, l’Administration fait au
Conseil un certain nombre de Communica
tions dont les principales sont les sui
vantes :
Communications
Questions diverses.— Renvoi à Commissions.
— M. Genestal, maire, propose le renvoi aux
Commissions compétentes d’un certain nom
bre de pétitions concernant notamment :
l’indemnité de logement des instituteurs et
institutrices des Ecoles primaires supérieu
res ; la Caisse des Ecoles ; les voitures auto
mobiles du Service de nettoiement.
Vilje du Havre ; classement parmi les stations
climatiques. — Aux termes de l’article 1 er
du projet de loi sur les Jeux, actuellement
pendant devant le Sénat, après son adoption
par la Chambre des députés, les jeux ne se
ront autorisés que dans les stations qui au
ront été reconnues climatiques ou hydromi-
nérales par application de la loi du 13 avril
1910.
La ville du Havre a intérêt à solliciter cette
reconnaissance ; l’Administration demande
au Conseil l’autorisation de faire toutes dé
marches utiles en ce sens, puisque d’ailleurs
notre plage est de plus en plus fréquentée et
qu’elle offre toutes garanties désirables au
point de vue de l’hygiène. Cette demande de
classement de la Ville parmi les stations cli-
manques donnera lieu à une enquête sui
vant les termes prescrits par la loi.
La proposition est votée. M. Begouen-De-
meaux s’abstient.
Chemin de Communication no 34 (Boulevard
d’Harfleuc). Avant-Projet de c assement
avec largeur de 30 mètres. Subvention
départementale.
Le Cons-il, dans sa séance du 21 mai der
nier, a approuvé le projet de mise en état de
viabilité du chemin de grande Communica
tion no 34, dit Boulevard d’Harfleur (entre le
quai de Suède et la rue de Fleurus) ; il a de
mandé le classement à 30 m.et sollicité l’aide
du departement. C’est une dépense de
123,500 fr., déduction faite d’une somme de
10,000 fr. qui semble pouvoir être écono
misée.
Le Conseil général a pris en considération
la demande formée par les représentants du
Hivre et a decidé en principe qu’une sub
vention de 60,000 fr. sera versée à la Ville du
Havre, sur les fonds des chemins de grande
communication, en cinq annuités.
Cette décision, ajoute M. Morgand, adjoint,
est particulièrement avantageuse pour le
Havra puisque, en plus de l’importante sub
vention qui nous est attribuée, le classement
à 30 mètres entraînera, pour le département,
l’obligation d’assurer, dans l’avenir, l’entre
tien de la totalité de la voie.
Le Conseil prend acte de cette communi
cation.
Kiosque à journaux rue Ed.-Corbière. — La
locataire de ce kiosque demande le renouvel
lement de cette location pour une année.
M. Morgand, au nom de l’Administration de
mande une location limitée à ce temps, parce
que, en vertu d’une convention passée, la
Société des Colonnes à réclames mobiles et
lumineuses peut, en 1915, réclamer cet em
placement. — Voté.
Rue Jean-Rameau et Impasse Suvigny. —
Eclairage. — M. Albert Lamare a pris renga
gement, en son nom et au nom de ses héri-
tiers, pour une période de dix ans, de payer
150 francs pour l’entretien de trois becs de
gaz rue Jean-Rameau. L’Administration prie
le Conseil de voter une somme égale en par
ticipation de dépenses.
Même demande en ce qui concerne un en
gagement pris par M. A. Guérard de verser
chaque année une somme de 100 francs pour
l’éclairage de l’impasse Suvigny.
Le Conseil émet des avis favorables.
École Primaire Supérieure de Garçons. — M.
le Ministre de l’Instruction publique, sur la
proposition de M. Lefebvre, inspecteur gé
néral, a concéda à l’Ecole primaire supérieure
de garçons du Havre le matériel ci-après :
Appareils de mesures électriques ; Installa-
tion des fournitures d’uneplate-formed’essai;
3 tableaux marbre blanc, etc., etc.
Le Conseil donne acte à M. Serrurier, ad
joint, de cette communication et décide d‘a-
dresser ses remerciements à M. le Ministre
de l’Instruction publique.
Forêt de Montgeon. — Foule de Bois. — M.
l’Inspecteur des Eaux et forêts envisage cer-
tains travaux de nettoyage et d’aération à
exécuter dans la partie S.-O. de la Forêt. M.
Panel, boulanger à Graville-Sainte-Honorine,
s’offre à faire les coupes reconnues nécessai
res à raison de 20 fr, par 104 bourrees.
Après un échange d'observations entre
MM. Déliot, Durand-Viel et Jennequin, adjoint,
le Conseil donne un avis favorable à l’accep
tation du marché proposé.
Bibliothèque Municipale. — Aux termes
d’un testament olographe déposé chez Me
Le Roux, Mme veuve Lebrun a légué à la
Bibliothèque de la ville du Havre un certain
nombre d’ouvrages, entre autres : L’Histoire
des Ducs de Bourgogne ; le Protectorat de
Cromwell ; les Œuvres de Voltaire ; les
Œuvres de Condillac; L’Histoire de Dix Ans,
de Louis Blanc ; les Mémoires de Sully, de
Fouché, du Cardinal de Retz, du Chevalier de
Grammont, etc., etc., au total 122 volumes.
L’Administration,dit M. Jennequin,adjoint,
propose au Conseil d’accepter ce legs et de
charger M. Millot, conservateur de la biblio-
thèque, de prendre livraison des livres dont
il s’agit et d’en donner décharge.
Le Conseil vote cette proposition.
École rue Desmallières. — Indemnité d’assu
rances. — Une explosion de gaz s’est produi
te, en octobre dernier, dans l’appartement
de la directrice de l’Ecole Maternelle rue
Desmallières. Les dégâts ont été évalués à
75 fr. Sur la proposition de l’Administration,
le Conseil approuve le règlement dîndemni-
té et autorise l’encaissement de ladite
somme.
Cimetière. — Sur la proposition de M.Jen-
nequin, adjoint, le Conseil accepte une sou
mission présentée pour l’abatage des peu
pliers dans la partie Nord du cimetière Sainte-
Marie.
* «
L’Ordre du Jour
Dépenses imprévues. — M. Bricka, rappor
teur de la Commission des Finances, de
mande le vote d'une somme de 3.080 fr.,
pour dépenses imprévues. Le crédit inscrit
au budget était de 16.737 fr. Déjà des dépen
ses dont l’ensemble s’élèvent à 7.984 fr. ont
été régularisées. Une somme de 5.672 fr. res
tera disponible.
Les conclusions du rapport sont adoptées.
* *
Sociétés de Secours Mutuels
Mode de répartition des Subventions
annuelles. Subventions, Supplément de
Crédit.
M. Coty, rapporteur, rappelle que les So
ciétés de Secours Mutuels de notre Ville re
çoivent une subvention municipale annuelle
calculée à raison de2 fr. pour chacun de leurs
membres. Cette subvention fut créée en
1892. Le crédit qui s’élevait alors à 6,500 fr.,
atteint aujourd’hui 23 ou 24,000 fr. Nous
sommes donc l’une des grandes villes qui
font le plus en faveur de la Mutualité et au
cune n’accorde aux sociétés mutuelles une
subvention totale qui, proportionnellement,
égale celle consentie par la Ville du Havre.
Faut-il d’ailleurs s’étonner de cet état de
choses favorable, quand nous savons que
l’un des plus vieux et des plus fervents mu
tualistes se trouve précisément à la tête de
notre municipalité ?
Mais continue M. Coty, lorsque fut fixée
cette allocation commune de 2 fr. par tête,
toutes les sociétés mutuelles suivaient une
règle à peu près identique ; elles avaient
toutes pour objet d’assurer les secours mé
dicaux et pharmaceutiques, en cas de mala
dies, et des allocations de convalescence.
Aujourd’hui, entre les cinquante sociétés
de secours mutuels subventionnées, les sta
tuts sont bien différents. Il en est dont les
cotisations sont absolument infimes ; il en
est même où les cotisations ne sont pas
payées. Par les unes et les autres, la sub
vention de 2 fr. par membre n’en est pas
moins acceptée. Or, il semble bien qu’il fau
drait en venir à une répartition plus ration
nelle et plus efficace. Il y a vraiment dispro
portion et illogisme dans cette façon de
traiter également des Sociétés mutuelles qui
s’imposent de réels sacrifices et accomplis
sent des actes véritables de solidarité, et
d’autres Sociétés qui fonctionnent d’une
manière simplement fictive. Il serait dési
rable que la subvention fût proportionnelle
non pas à l’effectif réel ou supposé de chaque
Société, mais proportionnelle au chiffre des
cotisations encaissées.
Suivant cette théorie, les Sociétés de se
cours mutuels recevraient désormais de la
Ville : une subvention de 5 0/0 des cotisa
tions encaissées de leurs sociétaires habitant
Le Havre ; elles recevraient en plus 2 0/0
quand leurs statuts donneraient droit à une
indemnité de maladie de 2 mois ; elles rece
vraient enfin de 3 à 5 0/0 suivant qu’elles
procureraient à leurs adhérents les secours
«médicaux ou pharmaceutiques.
En suite de cette nouvelle méthode de ré
partition,deux Sociétés notamment verraient
leur subvention diminuée : l’Amicale des
Employés de l’Octroi et celle de la Police.
L’une, en effet, ne donne pas les secours mé
dicaux, et l’autre ne donne pas d’indemni
tés. Mais ces Sociétés se trouvent en des con
ditions spéciales vis-à-vis de l’Administration
municipale qui devra leur accorder une al
location spéciale.
M. Meyer combat les conclusions du rap
port en ce qui concerne la répartition nou
velle de la subvention ; il maintient que Ion
doit subventionner les Sociétés mutuelles
en raison du noubre de leurs membres et
non d’après l’encaisse.
M. Coty défend ses conclusions. Il précise
que certaines Sociétés mutuelles ne. sont
mutualistes que de nom. Et commeM. Meye
l'interrompt en disant que l'on veut réduire
le nombre des mutualités, que ceux qui ton
dent des mutualités nouvelles ne le font pat
pour le plaisir de les présider, M. Coty re
vendique le droit de se faire entendre et dit
que si M. Meyer avait vraiment étudié h
nestion, il ne pourrait être, en principe,
‘un avis différent de celui expose dans li
rapport, au nom de la Commission.
que ceux qui ton
lies ne le font pat
. M. Meyer se prononce en faveur des pe
tites mutualités corporatives, de preféreno
aux grandes sociétés de secours mutuels.
M. Allan est d’an avis contraire.
Sur une nouvelle interruption de M. Meyer
M Coty fait connaître nominativement ton
tes les sociétés qui ne perçoivent qu’une eu
tisation infime et qui touchent cependant h
subvention municipale, ce qui est véritable
ment abusif.
M. de Grandmaison : Il faut distinguer en.
tre l’assistance et la mutualité. Envers let
pauvres, les malades, les blessés un devoir
d’assistance s’impose à la collectivité. Mais la
mutualité a pour objet de développer le
goût de l’épargne et l’aide mutuelie clair
voyante. C’est ce que nous voulons subven
tionner. De là l’idée de proportionner notre
subvention à l’effort ; de là la gradation pro
posée dans la subvention, soit que ta mutua-
lité distribue des secours m dicaux et phar-
maceutiques, ou qu’elle y ajoute une indem
nité journalière. Peut-être l’expérience,
comme le dit le rapport, nous fera-t-elle
apporter certaines modifications au mode
nouveau de répartition proposé. Mais le prin
cipe qui l’inspire est absolument juste et
équitable.
M. Coty précise à nouveau les catégories
d’efforts que l’on entend encourager ; M.
Génestal, maire, résume le débat et met aun
voix les conclusions du rapport.
Ces conclusions sont adoptées à l’unani
mité des membres présents, moins six voix.
MM. Meyer, Brot, Lang, Déliot et Masselis
votent contre ; M. Langlois s’abtient.
Quatre nouvelles Sociétés demandent de,
subventions et, au nom de la Commission
compétente, M. Coty, rapporteur, demande
qu’elles soient accordées sur les bases qui
viennent d’être adoptées.
M. Meyer demande ce qu’est la Société
« Les Amis de la Jeunesse », l’une des péti
tionnaires.
M. Coty : Une Société de mutualité scolaire
intéressant à la fois les élèves et les maîtres.
M. Meyer : Mais de quelles écoles s’agit-il ?
M. Coty : Aucune école n’est nommément
spécifiée dans les statuts; toutes peuvent
participer à cette Mutualité : écoles laïques
ou écoles libres...
M. Déliot : C’est ainsi que vous les ma
riez!
M. Coty : Ce n’est pas moi qui les marie
et en fait je crois qu’il s’agit surtout d’écoles
libres. Mais il s’agit encore une fois d’une
question de Mutualité.
M. Meyer : Il est évident que nous ne pou
vons refuser la subvention.
La proposition mise aux voix est adoptée
à l’unanimité.
Secours en Nature aux Enfants des
Ecoles Privées
Au nom des Commissions des Finances 6
de l’Assistance publique. M. René Coty donne
lecture du rapport suivant sur cette ques
tion :
« Messieurs,
» MM. de Grandmaison, Begouen De-
meaux, Durand-Viel, Masquelier et Grenier-
Lemarchand, en leur nom et au nom de
leur collègue M. Auger, ont, l’an dernier,
lors de la discussion du budget de l'exercics
courant, soumis à la Commission des Finan
ces la proposition suivante :
Libeller ainsi l’article 200 du budget ordinairs
(Dépenses) :
« Dépenses de la Caisse des Ecoles et Secours ex
» nature aux élèves indigents des écoles publiques
» et privées. »
Et augmenter le crédit de 1.000 francs, qui s’a
jouteront aux sous-crédits concernant les fourni*
nitures de chaussures (pour 730 fr.) et de vêl&
ments (pour 250 fr.) aux élèves des écoles primai
res ou des écoles susalernelles, en indiquant, à It
note sous ce même article, qu‘ « à concurrence de
ladite somme, les chussures et vêtements
pourront être distribués, par l’intermédiaire du
Bureau de Bienfaisance, ou par l'Administration
municipale, aux élèves indigents des écoles pri
vées, les distributions aux écoles publiques
continuant d'être faites par l'intermédiaire de la
Caisse des Ecoles, conformément aux statuts de
»
»
» cale-ci. •
Ou bien, si la Commission n’accepte pas la pro
position sous cette forme : maintenir l'article 206
avec son libellé et le chiffre proposé, et créer ui
article 200 bis, ainsi libellé :
« Secours en nature aux élèves indigents des
» écoles privées, comme complément de ceul
» distribués, par l’intermédiaire de la Caisse de.
» Ecoles, aux élèves des écoles publiques. fr. 1.000.
avec les indications suivantes :
» Chaussures : 750 fr.
» Vêtements : 250fr.»
Ces secours seront distribués par l’intermédiaire
du Bureau de Bienfaisance ou par l'Administra-
tion Municipale.
» Cette proposition a été renvoyée aux
Commissions des Finances et de l'Assis-
tance publique ; elle est anjourd'hui sou
mise au Conseil.
» Tout d’abord, nous avons le devoir de
faire observer que la proposition sur la
quelle vous êtes ainsi appelés à statuer est
d'une légalité indiscutable ; ainsi en a
décidé à plusieurs reprises le Conseil d’État.
» Il demeure bien entendu que si la loi
laisse aux Communes la faculté d’adopter
une telle mesure, elle ne leur en impose ad-
cunement l’obligation (Cons. d’Etat 22 mai
1903). . ,
» Mais, à défaut d’une obligation légale,
n’est-ce pas pour nous un devoir de justice
et d’humanité que de répartir également les
mêmes secours entre tous les enfants indi
gents, quelles que soient les écoles qu’ils
fréquentent? . ,
» Telle est fidèlement transcrite la ques-
tion qui nous est posée par nos honorablei
collègues de l’Action libérale. .
» Cette question, nous l’avons envisagée
comme nous croyons avoir toujours envi
sagé les questions de cet ordre : avec il
ferme volonté de ne manquer à l’équité en
vers aucune catégorie de citoyens, quelle
que soient leurs opinions ou leurs croyan
ces. — .
» Si la question qui est aujourd’hui sou-
mise au Conseil était vraiment, comme le
disait en Commission l’honorable M. de
Grandmaison, une simple question d’assis:
tance publique, la proposition qui nous es»
présentée serait pleinement justifiée a nos
yeux et nous n'hésiterions pas à vous en re
commander l’adoption. .
» Mais tel n’est pas le Cas. L’Assistance
publique est donnes à tousa aux enianto
(6 Pages) 5 Centimes — EDITEON DU MATIN — 5 Centimes
NBs
08
Administrateur-Balégue
Jeudi M Novembre 1913
Adresser tout ce qui concerne l'Administration
e M. O. RAMDOLET
85, Rue Fontenelle, SB
Adresse Télégraphique: PANDOLET Havre
Administration, Impressions II Annonces. TEL. 10.47
Le Petit Havre
wbeOr
Aédaetew en Chef. Gérant
HIPPOLYTE FÉNOUX
haresser tout ce qui concerne la Rédaction
t M. HIPPOLYTE FÉNOUX
85, Rue Fontenelle, 35
TÉLÉPHONE: Rédaction, No 7.60
AU HAVRE
A PARIS
ANNONCES
BUREAU DU JOURNAL, 112, bon! 4 de Strasbourg.
! L’AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le PETIT HA THE est désigné pour les Annonces judiciaires et légales
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région
ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, lEure,
l’Oise et la Somme (
" Autres Départements...... ... ..........
g Union Postale
20
Tnors Moisi Six Mois
sO
• Fr.
P-
fi il se
»
20 Fr.
a® w.<
== » |
Un An
4ey s
e
M996358
- 2 a 25 41. , ; J— 0
9 également, S ANS FR^IS, Hans tous les Baree^s dn Pons A regxs 3
—============== rrsrgcssg
Paris, trois heures matin
DÉPÊCHES COMMERCIALES
METAUX
LONDRES, 26 Novembre. Dépêche de 4 h. 30
TON
COURS
HAUSSE
BAISSE
CUIVRE
Comptant.. i
ferme
£ 67 18/-
27/6
-/-
3 mois ’
£ 66 7/6
20/-
-/-
ETAIN
:
Comptant .
t 480 15/-
35/-
3 mois
, fermez
e 181 15/-
35/-
-I-
FER
Comptant ..
ferme
4 49/4 %
V-
3 mois.....
£ 50/1 %
-1-
-i-
Prix comparés avec ceux de la deuxième Bourse
du 25 novembre 1913.
NEW-YORK, 26 NOVEMBRE
Cetons x décembre, baisse 6 points; jan
vier, baisse 7 points ; mars, baisse 6 points ;
mai, baisse 7 points. — Soutenu.
Calés t hausse 19 à 23 points.
NEW-YORK, 26 NOVEMBRE
Cuivre Standard disp.:
— janvier
Amalgasat. Cep...
Fer
C. 00 100
14 37
14 37
70 1/8
15 37
4. mawxT
14 37
14 37
70 3 8
15 37
CHICAGO, 26 NOVEMBRE
F !
C. DU JOUR
c. PRECED
Blé sur
Décembre;
87 1/8
87 1/2
Mai.
91 1/8
91 3 8
Mais sur
Décembre.
70 5/8
70 5 8
Mai
70 1,2
70 5 8
Saindoux sar.
Janvier...
10 87
10 90
—
Mai
11 12
11 15
clos. _
NOTA. — Demain Marché
3
DEUX AVIATEURS MILITAIRES
SONT CARBONISÉS
Reims. — Un biplan militaire venant de
Mourmelon et monté par deux sapeurs avia
teurs est tombé hier après-midi entre Be-
thon et Chantemerle.
Les deux aviateurs sont morts carbonisés.
L’accident serait dû à l’explosion du réser
voir d’essence.
EPERNAY. — L’accident s’est produit à qua
tre kilomètres de tout lieu habité.
On croit qu’un choc s’est produit au mo
ment de l’atterrissage. Le réseruoir aurait
explosé et le feu aurait pris, réduisant l’ap
pareil en cendres.
Les cadavres des aviateurs sont tellement
carbonisés qu’il est impossible de les iden
tifier.
On n’a retrouvé qu’un mouchoir matricu-
lé et un soulier intacts parmi les débris de
l’appareil.
EPERNAY. — Il résulte des renseignements
recueillis que quelques personnes ont aper
çu vers trois heures de l’après-midi, un bi-
Jan atterrissant sur le lieu où s’est produit
accident. L’appareil ayant buté, capota et
des flammes jaillirent immédiatement.
Les témoins accoururent pour porter se
cours aux aviateurs, mais ne trouvèrent à
leur arrivée que des débris informes finis-
sant de se consumer.
Les deux aviateurs avaient été entièrement
sarbonisés.
PROTESTATION DES OUVRIERS DE
L'ARSENAL DE BREST
Brest. — Deux mille ouvriers de l’Arsenal
ont voté hier un ordre du jour de protesta
tion contre les punitions infligées à deux de
leurs camarades ayant commis des fautes
graves contre la discipline.
Voici la fin de cet ordre du jour :
« Les ouvriers adressent leur salut frater
nel aux militants emprisonnés pour le « Sou
du Soldat » et protestent contre leur incar
cération ;
» Se quittent en se promettant de rejoin
dre en grand nombre le syndicat,seul moyen
de lutte efficace.
» Vive l’organisation syndicale ! Vive
C. G. T. »
la
Il ne s’est produit aucun incident
sortie du meeting.
o@p s en== -c==
GRÈVE DE TYPOGRAPHES
à
la
sont
Lille. — A Roubaix, les typographes
en grève dans 33 maisons sur 35 ; à Tour
coing, 7 maisons sur 12 sont touchees par la
grève ; à Croix, une seule imprimerie tra
vaille avec des « jaunes ».
Lille. — a la suite du vote de la grève gé
nérale des typographes, huit maisons ont
chômé.
Le mouvement ne s’est pas étendu aux
maisons ayant accepté le tarif syndical.
L’AVIATEUR DAUCOURT EN PANNE
Constantinople. — L » ministre de l'inté-
rieur a transmis le télégramme suivant signé
» Daucourt » à l’ambassade de France :
« J’ai été surpris dans les monts Taurus
par une violente tempête. J’ai fait une chute
terrible ; heureusement, je suis indemne,
mais mon appareil est brisé. Veuillez en in
former l'ambassade de France. Mon passager
Roux, pour alléger l’appareil, a pris le che
min de fer. »
COLLISION DE NAVIRES
Hong Kong. — Le steamer japonais Sohu-
Maru est entré en collision, dans la rade,
avec une chaloupe transportant cinquante
voyageurs chinois.
La chaloupe a coulé. Trente Chinois se
sont noyés ; les autres ont été sauvés.
CONDAMNATION DU LIEUTENANT TIEGS
Metz. — Le Conseil de guerre vient de
condamner le lieutenant Tlegs, pour homi-
cide, à 10 ans de travaux forcés et privation
de ses droits civils ; il sera en outre exclu de
l’armée.
L’Evolution Politique de Gaen
SOUS LA TROISIEME RÉPUBLIQUE
La plaine et la ville de Caen constituent,
en Basse-Normandie, un milieu politique
original, qui, bien qu’essentiellement nor
mand par la race, le ton, le tempérament,
rappelle en même temps à certains égards
la démagogie nationaliste parisienne et ses
entraînements quasi méridionaux. A de
longues périodes d’indifférence, d’atonie,
d’inexistence politique succèdent tout à
coup des marées d’opinion imprévues qui,
groupant dans un même élan des masses
inorganisées et politiquement amorphes,
balaient les partis officiels. Ce sont des
manifestations de l’ordre éruptif, presque
toujours cristallisées autour d’un homme
populaire, et qui appartiennent à l’essence
classique de tous les plébiscites et de tous
les a boulangismes ». Chez ces véritables
méridionaux de la Normandie, quelle dif
férence avec la réserve froide et sans pas
sion que nous décrivions précédemment
chez les Rouennais ! (2)
Caen est une ville de basoche, d'étu-
diants, de rentiers, de moyen et de petit
commerce, de cheminots et de déchargeurs
de navires. Ce sera prochainement un grand
centre industriel, avec ses hauts fourneaux
de Colombel et l’exportation de ses mine
rais. Mais c’est surtout la métropole histo
rique bas-normande, cité des cathédrales
romanes et des grands palais administratifs
évoquant les unes comme les autres la même
idée de stabilité, de richesse assise et d’or
dre si traditionnel qu’il en devient harmo
nieux. Sous un ciel bleu, avec ses pierres
éclatantes et la campagne nue qui l’entou
re, Caen semble une autre Salamanque ; et
sous un ciel humide et bas, avec ses cloî
tres et ses clochers normands, une autre
Oxford. C’est enfin — et par là combien
différente de Rouen la réservée — une cité
sans mélancolie, capable d’expansion dans
l’entraînement parfois bruyant de ses em
ballements populaires, où derrière la fa-
cade bourgeoise se révèle à certains mo
ments je ne sais quelle inquiétante gros
sièreté de plèbe.
L’esprit politique caennais est un mé
lange singulier de républicanisme sincère,
de conservatisme étroit et d’inconsciente
démagogie se mettant éventuellement au
service des plus violentes réactions. C’est
surtout chez les modestes rentiers, les
fonctionnaires retraités du quartier Saint-
Julien ou de la Maladrerie, et encore chez
les boutiquiers, les moyens commerçants
de la rue Saint Jean, qu’on le rencontre à
l’état pur et qu’en réalité il prend nais
sance. Tout ce petit monde est égalitaire
d’instinct, routinier et méfiant de nature,
républicain du reste, mais volontiers mé
content de tout, patriote et même patrio-
tard, ami des fanfares guerrières et des
glorioles du coq gaulois. Sous un autre
ciel, il fournit une réplique du nationa
lisme parisien. A côté de lui, la classe ou
vrière, plus avancée à ses heures, est si
possible aussi fuyante. Les nombreux em
ployés et travailleurs du chemin de fer (la
gare en occupe 1,200) sont susceptibles
d’apprécier les réformes sociales, encore
qu’ils soient peu socialistes ; mais on les a
vus boulangistes et nationalistes, et ils n’of
frent en somme de garantie sérieuse à aucun
parti. Quant aux ouvriers des quais, il se
rait naïf de leur chercher une opinion : les
petits verres, l’argent même sont argu
ments qu’ils comprennent, et cependant je
n’omettrai pas de dire qu’une campagne
personnelle, faite par un candidat sympa
thique, familier, bel homme et du reste de
n’importe quel parti, pourra soulever parmi
eux d’étranges enthousiasmes. Encadrant
ce milieu amorphe, sans du reste le diri
ger, les classes bourgeoises révèlent des
tendances mieux dessinées. Les vieilles fa
milles — à l’exception d’un groupe protes-
lant autochtone — demeurent hostiles au
présent. L’université se range socialement
avec les forces organisées et n’est point un
foyer démocratique. Le monde de la baso
che fournit à la Gauche comme à la Droite
l’essentiel de leurs états-majors, mais c’est
aux conservateurs ou du moins aux mo
dérés que va le poids de sa sympathie,
l’autorité morale de son appui. Somme
toute, il existe des cadres aux partis : mais
la masse est instable, et nul ne peut se
flatter de la fixer sans retour. Caen est une
de ces villes populaires — telles Paris —
qui semblent invariablement attirer sur
elles ces fièvres démagogiques dont le bou
langisme est le type.
En dehors de ces fièvres éruptives et du
reste passagères, Caen est une ville répu
blicaine comme une autre, nettement hos
tile à l’esprit du passé. Elle ne répond ni à
l’appel réactionnaire du 16 Mai, ni à celui
de la coalition de 1885. A une exception
près, ses maires sont républicains. De mê
me ses députés, sauf quand l’appoint des
cantons ruraux fait passer des opposants ;
mais même alors, la gauche conserve dans
(1) On trouvera une étude plus détaillée de la
région caennaise et de la politique normande dans
te livre que M. André Siegfried va faire paraître
(le 29 nov.) chez A. Colin Tableau politique de
la France de l’Ouest sous la T olsième République.
(2) Voir le Petit Havre des 22 et 29 octobre
1913.
la ville une majorité, qui va de 36 à 47 p.
100 des inscrits, contre 22 à 33 p. 100 (1).
En temps ordinaire, c’est donc, semble-t-il,
un terrain électoral de tout repos pour les
républicains.
Or il n’en est rien ; cette sécurité recou
vre des précipices. Voici qu’en 1889 le
mouvement boulangiste s’épanouit dans la
capitale normande, réunissant en un vi
goureux faisceau de mécontents les bona
partistes, la Droite et nombre de républi
cains. Ce n’est pas seulement le fait d’une
activité de Comités, c’est en un sens un
élan spontané. Aux élections cantonales de
juillet 1889, le général Boulanger, qui se
fait plébisciter, obtient dans le canton de
Caen (Est) 1,578 voix contre 1,831 : il a
failli réussir. Deux mois plus tard, son
candidat, M. Engerand, triomphe, grâce à
l’appoint rural sans doute, mais non sans
avoir réuni dans la partie urbaine une im
posante minorité de 2,996 voix contre 3.423,
31 p. 100 des inscrits contre 36. Caen a
vibré à l’appel du « parti national » î
Plus révélatrice encore du tréfonds de
l’esprit politique caennais est la crise du
nationalisme. Dès le début, la ville a été
profondément antidreyfusarde : travaillée
par le parti nationaliste, elle se donne pas
sionnément à lui. Le 17 mars 1902, le géné
ral Mercier y reçoit un enthousiaste accueil.
Un mois après, le comte Delarbre, candidat
de la « Patrie Française », balaie au pre
mier tour opportunistes, radicaux et socia
listes, qui eu vain s’opposent a lui. Dans la
ville même, il obtient 38 p. 100 des inscrits,
contre 33 à ses trois concurrents de gauche
réunis. C’est, portant l’homme populaire,
riche et séduisant, une sorte de marée trou
ble, où des eaux de toute sorte se mêlent :
plèbe campagnarde bonapartiste, plèbe ur
baine entraînée, cléricaux irréconciliables,
républicains mécontents, tous se coalisant
au nom de la République nationale contre la
République parlementaire de Waideck-Rous-
seau. Mouvement au fond plus nationaliste
que spécifiquement clérical, plus protesta
taire qu’antirépublicain ; mouvement popu
laire surtout, car il touche tous les quartiers
et toutes les classes, les soulevant dans une
passion commune ! Et cette victoire n’est
pas superficielle, ni sans lendemain. Aux
élections cantonales partielles du 17 jan
vier 1904, le maire républicain de Gaen est
battu dans le canton Est de la ville par un
nationaliste ; et, sous ce coup, la munici
palité succombe. Aux élections municipa
les de mai 1904, la moyenne des voix répu
blicaines tombe à 26 p. 100 des inscrits
contre 39 p. 100 aux nationalistes. C’est le
point culminant de la vague : des cléricaux
en ont profité, mais elle n’était point exclu
sivement cléricale ; des réactionnaires s’en
sont servi, mais elle n’était point propre
ment réactionnaire ; Boulanger y eût re
connu le mouvement populaire qui le por
tait à ses débuts.
C’est le caractère de semblables emballe
ments que de passer comme ils sont nés.
Deux ans plus tard, en 1906, il semble que
toute cette ardeur nationaliste n’appartien
ne plus qu’au passé. M. Delarbre, désabu
sé, renonce à la lutte et se rallie au parti
républicain. C’est le moment où M. Chéron,
dont le tempérament plaît aux Caennais
par de secrètes ressemblances, ranime,
mais cette fois au profil de la République,
un enthousiasme dont celle-ci n’avait, à
Caen, jamais bénéficié. L’opinion à nou
veau s’émeut, dans une direction diamétra
lement opposée, mais avec le même élan :
il semble qu’on ait simplement renversé la
vapeur. Cette fois, la victoire est triom
phale. Sur le nom acclamé de M. Chéron, la
proportion des voix de gauche monte à 46
p. 100 des inscrits (contre 34 p. 100 à la
Droite) en 1906, à 50 p. 100 en 1910. L’ob
servateur méfiant est tenté de dire en ho
chant la tête : Que de républicains ! Mais il
s’explique mieux les choses, si, regardant
en arrière, il réalise que les Caennais se
sont offert un nouveau plébiscite.
Conçoit-on maintenant la personnalité
politique de la région caennaise ? Ni dans
la Haute, ni dans la Basse-Normandie, je
ne vois rien d’analogue. Il est en France
des milieux, où le mélange et le choc con
fus, dans les mêmes cerveaux, d’instincts à
la fois démocratiques, autoritaires et con
servateurs produit, à certaines heures, une
atmosphère fiévreuse et grosse d’orages.
Par tempérament, ces milieux (que nous
pourrions énumérer) s’abandonnent inva
riablement et s’abandonneront toujours à
tous les « boulangismes » : c’est parmi eux
qu’il faut politiquement classer Caen et la
Plaine de Caen.
André SIEGFRIED.
(4) Les députés républicains sont MM. Houyvet
(1876), Henry (1881), Lebret (1893-1992), Chéron
(1900-4913) ; ce dernier passe au Sénat en juillet
1913, sans avoir perdu la confiance de ses élec
teurs caennais. Le général de Vendeuvre, conser
vateur (1877) et M. Esgerand, boulangiste (1889) ne
réussissent que grâce aux voix de la campagne.
M. Delarbre, nationaliste (1902), est le seul député
de la droite qui ait recueilli la majorité dans la
ville même de Caen.
ON TROUVE
LE PETIT HAVRE à Paris
à h HIBRATRIE ITEHMITYTTOHRLE
10s, rue Saint-Lazare, 108
(immeuble de P HOTEL TE B # INUS
AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance clu 26 Novembre 191=
LE MODE DE RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Les Secours m nature aux Enfants indigents des Ecoles privées
Les Subventions aux Sociétés Havraises
La séance du Conseil Municipal, tenue
hier soir, a été particulièrement intéressante
en ce que, pour la première fois, les mem
bres de l’Assemblée qui appartiennent au
parti de l’Action Libérale ont posé la ques
tion des « Secours en nature aux enfants in
digents des Ecoles privées » — c’est-à-dire
que, d’une façon détournée, ils demandaient
aux finances municipales une subvention en
faveur des écoles confessionnelles opposées
aux écoles laïques où la neutralité scolaire
est de règle.
On trouvera plus loin une analyse du dé
bat, par instant assez passionné, qui s’est
produit à ce sujet, — et qui s’est terminé par
le rejet de la proposition formulée par M. de
Grandmaison et ses amis.
L’appel nominal fait constater la présence
de M. Génestal, maire ; MM. Morgand, Ser-
rurier, Dr Vigné, Jennequin, Badoureiu et
Valentin, adjoints ; MM. Dero, Coty, Bas
set, Bricka, Gripois, Le Chapelain, Langlois,
Grenier - Lemarchand , Begouen - Demeaux,
Lang, Lenormand, Maillart, Schoux, Déliot,
Masquelier, Auger, de Grandmaison, Du-
rand-Viel, Allan, Brot, Beurrier, Masselin,
Conion, Meyer, Salacrou, Cherfils.
Sont absents et excusés : MM. Combes,
Windesheim et Encontre.
Le procès-verbal de la précédente séance
ayant été adopté, l’Administration fait au
Conseil un certain nombre de Communica
tions dont les principales sont les sui
vantes :
Communications
Questions diverses.— Renvoi à Commissions.
— M. Genestal, maire, propose le renvoi aux
Commissions compétentes d’un certain nom
bre de pétitions concernant notamment :
l’indemnité de logement des instituteurs et
institutrices des Ecoles primaires supérieu
res ; la Caisse des Ecoles ; les voitures auto
mobiles du Service de nettoiement.
Vilje du Havre ; classement parmi les stations
climatiques. — Aux termes de l’article 1 er
du projet de loi sur les Jeux, actuellement
pendant devant le Sénat, après son adoption
par la Chambre des députés, les jeux ne se
ront autorisés que dans les stations qui au
ront été reconnues climatiques ou hydromi-
nérales par application de la loi du 13 avril
1910.
La ville du Havre a intérêt à solliciter cette
reconnaissance ; l’Administration demande
au Conseil l’autorisation de faire toutes dé
marches utiles en ce sens, puisque d’ailleurs
notre plage est de plus en plus fréquentée et
qu’elle offre toutes garanties désirables au
point de vue de l’hygiène. Cette demande de
classement de la Ville parmi les stations cli-
manques donnera lieu à une enquête sui
vant les termes prescrits par la loi.
La proposition est votée. M. Begouen-De-
meaux s’abstient.
Chemin de Communication no 34 (Boulevard
d’Harfleuc). Avant-Projet de c assement
avec largeur de 30 mètres. Subvention
départementale.
Le Cons-il, dans sa séance du 21 mai der
nier, a approuvé le projet de mise en état de
viabilité du chemin de grande Communica
tion no 34, dit Boulevard d’Harfleur (entre le
quai de Suède et la rue de Fleurus) ; il a de
mandé le classement à 30 m.et sollicité l’aide
du departement. C’est une dépense de
123,500 fr., déduction faite d’une somme de
10,000 fr. qui semble pouvoir être écono
misée.
Le Conseil général a pris en considération
la demande formée par les représentants du
Hivre et a decidé en principe qu’une sub
vention de 60,000 fr. sera versée à la Ville du
Havre, sur les fonds des chemins de grande
communication, en cinq annuités.
Cette décision, ajoute M. Morgand, adjoint,
est particulièrement avantageuse pour le
Havra puisque, en plus de l’importante sub
vention qui nous est attribuée, le classement
à 30 mètres entraînera, pour le département,
l’obligation d’assurer, dans l’avenir, l’entre
tien de la totalité de la voie.
Le Conseil prend acte de cette communi
cation.
Kiosque à journaux rue Ed.-Corbière. — La
locataire de ce kiosque demande le renouvel
lement de cette location pour une année.
M. Morgand, au nom de l’Administration de
mande une location limitée à ce temps, parce
que, en vertu d’une convention passée, la
Société des Colonnes à réclames mobiles et
lumineuses peut, en 1915, réclamer cet em
placement. — Voté.
Rue Jean-Rameau et Impasse Suvigny. —
Eclairage. — M. Albert Lamare a pris renga
gement, en son nom et au nom de ses héri-
tiers, pour une période de dix ans, de payer
150 francs pour l’entretien de trois becs de
gaz rue Jean-Rameau. L’Administration prie
le Conseil de voter une somme égale en par
ticipation de dépenses.
Même demande en ce qui concerne un en
gagement pris par M. A. Guérard de verser
chaque année une somme de 100 francs pour
l’éclairage de l’impasse Suvigny.
Le Conseil émet des avis favorables.
École Primaire Supérieure de Garçons. — M.
le Ministre de l’Instruction publique, sur la
proposition de M. Lefebvre, inspecteur gé
néral, a concéda à l’Ecole primaire supérieure
de garçons du Havre le matériel ci-après :
Appareils de mesures électriques ; Installa-
tion des fournitures d’uneplate-formed’essai;
3 tableaux marbre blanc, etc., etc.
Le Conseil donne acte à M. Serrurier, ad
joint, de cette communication et décide d‘a-
dresser ses remerciements à M. le Ministre
de l’Instruction publique.
Forêt de Montgeon. — Foule de Bois. — M.
l’Inspecteur des Eaux et forêts envisage cer-
tains travaux de nettoyage et d’aération à
exécuter dans la partie S.-O. de la Forêt. M.
Panel, boulanger à Graville-Sainte-Honorine,
s’offre à faire les coupes reconnues nécessai
res à raison de 20 fr, par 104 bourrees.
Après un échange d'observations entre
MM. Déliot, Durand-Viel et Jennequin, adjoint,
le Conseil donne un avis favorable à l’accep
tation du marché proposé.
Bibliothèque Municipale. — Aux termes
d’un testament olographe déposé chez Me
Le Roux, Mme veuve Lebrun a légué à la
Bibliothèque de la ville du Havre un certain
nombre d’ouvrages, entre autres : L’Histoire
des Ducs de Bourgogne ; le Protectorat de
Cromwell ; les Œuvres de Voltaire ; les
Œuvres de Condillac; L’Histoire de Dix Ans,
de Louis Blanc ; les Mémoires de Sully, de
Fouché, du Cardinal de Retz, du Chevalier de
Grammont, etc., etc., au total 122 volumes.
L’Administration,dit M. Jennequin,adjoint,
propose au Conseil d’accepter ce legs et de
charger M. Millot, conservateur de la biblio-
thèque, de prendre livraison des livres dont
il s’agit et d’en donner décharge.
Le Conseil vote cette proposition.
École rue Desmallières. — Indemnité d’assu
rances. — Une explosion de gaz s’est produi
te, en octobre dernier, dans l’appartement
de la directrice de l’Ecole Maternelle rue
Desmallières. Les dégâts ont été évalués à
75 fr. Sur la proposition de l’Administration,
le Conseil approuve le règlement dîndemni-
té et autorise l’encaissement de ladite
somme.
Cimetière. — Sur la proposition de M.Jen-
nequin, adjoint, le Conseil accepte une sou
mission présentée pour l’abatage des peu
pliers dans la partie Nord du cimetière Sainte-
Marie.
* «
L’Ordre du Jour
Dépenses imprévues. — M. Bricka, rappor
teur de la Commission des Finances, de
mande le vote d'une somme de 3.080 fr.,
pour dépenses imprévues. Le crédit inscrit
au budget était de 16.737 fr. Déjà des dépen
ses dont l’ensemble s’élèvent à 7.984 fr. ont
été régularisées. Une somme de 5.672 fr. res
tera disponible.
Les conclusions du rapport sont adoptées.
* *
Sociétés de Secours Mutuels
Mode de répartition des Subventions
annuelles. Subventions, Supplément de
Crédit.
M. Coty, rapporteur, rappelle que les So
ciétés de Secours Mutuels de notre Ville re
çoivent une subvention municipale annuelle
calculée à raison de2 fr. pour chacun de leurs
membres. Cette subvention fut créée en
1892. Le crédit qui s’élevait alors à 6,500 fr.,
atteint aujourd’hui 23 ou 24,000 fr. Nous
sommes donc l’une des grandes villes qui
font le plus en faveur de la Mutualité et au
cune n’accorde aux sociétés mutuelles une
subvention totale qui, proportionnellement,
égale celle consentie par la Ville du Havre.
Faut-il d’ailleurs s’étonner de cet état de
choses favorable, quand nous savons que
l’un des plus vieux et des plus fervents mu
tualistes se trouve précisément à la tête de
notre municipalité ?
Mais continue M. Coty, lorsque fut fixée
cette allocation commune de 2 fr. par tête,
toutes les sociétés mutuelles suivaient une
règle à peu près identique ; elles avaient
toutes pour objet d’assurer les secours mé
dicaux et pharmaceutiques, en cas de mala
dies, et des allocations de convalescence.
Aujourd’hui, entre les cinquante sociétés
de secours mutuels subventionnées, les sta
tuts sont bien différents. Il en est dont les
cotisations sont absolument infimes ; il en
est même où les cotisations ne sont pas
payées. Par les unes et les autres, la sub
vention de 2 fr. par membre n’en est pas
moins acceptée. Or, il semble bien qu’il fau
drait en venir à une répartition plus ration
nelle et plus efficace. Il y a vraiment dispro
portion et illogisme dans cette façon de
traiter également des Sociétés mutuelles qui
s’imposent de réels sacrifices et accomplis
sent des actes véritables de solidarité, et
d’autres Sociétés qui fonctionnent d’une
manière simplement fictive. Il serait dési
rable que la subvention fût proportionnelle
non pas à l’effectif réel ou supposé de chaque
Société, mais proportionnelle au chiffre des
cotisations encaissées.
Suivant cette théorie, les Sociétés de se
cours mutuels recevraient désormais de la
Ville : une subvention de 5 0/0 des cotisa
tions encaissées de leurs sociétaires habitant
Le Havre ; elles recevraient en plus 2 0/0
quand leurs statuts donneraient droit à une
indemnité de maladie de 2 mois ; elles rece
vraient enfin de 3 à 5 0/0 suivant qu’elles
procureraient à leurs adhérents les secours
«médicaux ou pharmaceutiques.
En suite de cette nouvelle méthode de ré
partition,deux Sociétés notamment verraient
leur subvention diminuée : l’Amicale des
Employés de l’Octroi et celle de la Police.
L’une, en effet, ne donne pas les secours mé
dicaux, et l’autre ne donne pas d’indemni
tés. Mais ces Sociétés se trouvent en des con
ditions spéciales vis-à-vis de l’Administration
municipale qui devra leur accorder une al
location spéciale.
M. Meyer combat les conclusions du rap
port en ce qui concerne la répartition nou
velle de la subvention ; il maintient que Ion
doit subventionner les Sociétés mutuelles
en raison du noubre de leurs membres et
non d’après l’encaisse.
M. Coty défend ses conclusions. Il précise
que certaines Sociétés mutuelles ne. sont
mutualistes que de nom. Et commeM. Meye
l'interrompt en disant que l'on veut réduire
le nombre des mutualités, que ceux qui ton
dent des mutualités nouvelles ne le font pat
pour le plaisir de les présider, M. Coty re
vendique le droit de se faire entendre et dit
que si M. Meyer avait vraiment étudié h
nestion, il ne pourrait être, en principe,
‘un avis différent de celui expose dans li
rapport, au nom de la Commission.
que ceux qui ton
lies ne le font pat
. M. Meyer se prononce en faveur des pe
tites mutualités corporatives, de preféreno
aux grandes sociétés de secours mutuels.
M. Allan est d’an avis contraire.
Sur une nouvelle interruption de M. Meyer
M Coty fait connaître nominativement ton
tes les sociétés qui ne perçoivent qu’une eu
tisation infime et qui touchent cependant h
subvention municipale, ce qui est véritable
ment abusif.
M. de Grandmaison : Il faut distinguer en.
tre l’assistance et la mutualité. Envers let
pauvres, les malades, les blessés un devoir
d’assistance s’impose à la collectivité. Mais la
mutualité a pour objet de développer le
goût de l’épargne et l’aide mutuelie clair
voyante. C’est ce que nous voulons subven
tionner. De là l’idée de proportionner notre
subvention à l’effort ; de là la gradation pro
posée dans la subvention, soit que ta mutua-
lité distribue des secours m dicaux et phar-
maceutiques, ou qu’elle y ajoute une indem
nité journalière. Peut-être l’expérience,
comme le dit le rapport, nous fera-t-elle
apporter certaines modifications au mode
nouveau de répartition proposé. Mais le prin
cipe qui l’inspire est absolument juste et
équitable.
M. Coty précise à nouveau les catégories
d’efforts que l’on entend encourager ; M.
Génestal, maire, résume le débat et met aun
voix les conclusions du rapport.
Ces conclusions sont adoptées à l’unani
mité des membres présents, moins six voix.
MM. Meyer, Brot, Lang, Déliot et Masselis
votent contre ; M. Langlois s’abtient.
Quatre nouvelles Sociétés demandent de,
subventions et, au nom de la Commission
compétente, M. Coty, rapporteur, demande
qu’elles soient accordées sur les bases qui
viennent d’être adoptées.
M. Meyer demande ce qu’est la Société
« Les Amis de la Jeunesse », l’une des péti
tionnaires.
M. Coty : Une Société de mutualité scolaire
intéressant à la fois les élèves et les maîtres.
M. Meyer : Mais de quelles écoles s’agit-il ?
M. Coty : Aucune école n’est nommément
spécifiée dans les statuts; toutes peuvent
participer à cette Mutualité : écoles laïques
ou écoles libres...
M. Déliot : C’est ainsi que vous les ma
riez!
M. Coty : Ce n’est pas moi qui les marie
et en fait je crois qu’il s’agit surtout d’écoles
libres. Mais il s’agit encore une fois d’une
question de Mutualité.
M. Meyer : Il est évident que nous ne pou
vons refuser la subvention.
La proposition mise aux voix est adoptée
à l’unanimité.
Secours en Nature aux Enfants des
Ecoles Privées
Au nom des Commissions des Finances 6
de l’Assistance publique. M. René Coty donne
lecture du rapport suivant sur cette ques
tion :
« Messieurs,
» MM. de Grandmaison, Begouen De-
meaux, Durand-Viel, Masquelier et Grenier-
Lemarchand, en leur nom et au nom de
leur collègue M. Auger, ont, l’an dernier,
lors de la discussion du budget de l'exercics
courant, soumis à la Commission des Finan
ces la proposition suivante :
Libeller ainsi l’article 200 du budget ordinairs
(Dépenses) :
« Dépenses de la Caisse des Ecoles et Secours ex
» nature aux élèves indigents des écoles publiques
» et privées. »
Et augmenter le crédit de 1.000 francs, qui s’a
jouteront aux sous-crédits concernant les fourni*
nitures de chaussures (pour 730 fr.) et de vêl&
ments (pour 250 fr.) aux élèves des écoles primai
res ou des écoles susalernelles, en indiquant, à It
note sous ce même article, qu‘ « à concurrence de
ladite somme, les chussures et vêtements
pourront être distribués, par l’intermédiaire du
Bureau de Bienfaisance, ou par l'Administration
municipale, aux élèves indigents des écoles pri
vées, les distributions aux écoles publiques
continuant d'être faites par l'intermédiaire de la
Caisse des Ecoles, conformément aux statuts de
»
»
» cale-ci. •
Ou bien, si la Commission n’accepte pas la pro
position sous cette forme : maintenir l'article 206
avec son libellé et le chiffre proposé, et créer ui
article 200 bis, ainsi libellé :
« Secours en nature aux élèves indigents des
» écoles privées, comme complément de ceul
» distribués, par l’intermédiaire de la Caisse de.
» Ecoles, aux élèves des écoles publiques. fr. 1.000.
avec les indications suivantes :
» Chaussures : 750 fr.
» Vêtements : 250fr.»
Ces secours seront distribués par l’intermédiaire
du Bureau de Bienfaisance ou par l'Administra-
tion Municipale.
» Cette proposition a été renvoyée aux
Commissions des Finances et de l'Assis-
tance publique ; elle est anjourd'hui sou
mise au Conseil.
» Tout d’abord, nous avons le devoir de
faire observer que la proposition sur la
quelle vous êtes ainsi appelés à statuer est
d'une légalité indiscutable ; ainsi en a
décidé à plusieurs reprises le Conseil d’État.
» Il demeure bien entendu que si la loi
laisse aux Communes la faculté d’adopter
une telle mesure, elle ne leur en impose ad-
cunement l’obligation (Cons. d’Etat 22 mai
1903). . ,
» Mais, à défaut d’une obligation légale,
n’est-ce pas pour nous un devoir de justice
et d’humanité que de répartir également les
mêmes secours entre tous les enfants indi
gents, quelles que soient les écoles qu’ils
fréquentent? . ,
» Telle est fidèlement transcrite la ques-
tion qui nous est posée par nos honorablei
collègues de l’Action libérale. .
» Cette question, nous l’avons envisagée
comme nous croyons avoir toujours envi
sagé les questions de cet ordre : avec il
ferme volonté de ne manquer à l’équité en
vers aucune catégorie de citoyens, quelle
que soient leurs opinions ou leurs croyan
ces. — .
» Si la question qui est aujourd’hui sou-
mise au Conseil était vraiment, comme le
disait en Commission l’honorable M. de
Grandmaison, une simple question d’assis:
tance publique, la proposition qui nous es»
présentée serait pleinement justifiée a nos
yeux et nous n'hésiterions pas à vous en re
commander l’adoption. .
» Mais tel n’est pas le Cas. L’Assistance
publique est donnes à tousa aux enianto
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.0%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86.0%.
- Auteurs similaires Fénoux Hippolyte Fénoux Hippolyte /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Fénoux Hippolyte" or dc.contributor adj "Fénoux Hippolyte")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/6
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t52638647m/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t52638647m/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t52638647m/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t52638647m
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t52638647m
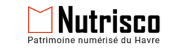


Facebook
Twitter